Ouvrage
désormais entièrement en ligne :
Otto Lueger
Naundorff et Naundorffisme
Religion, Mysticisme,
Prophéties, Légitimité

Editions du
Naundorffisme
Introduction
Plus de 3 000 ouvrages ont déjà été écrits sur Louis XVII, dont une bonne partie sur Naundorff. Cependant, concernant cette grande énigme de l’Histoire, certains sujets sont peu abordés ou tabous, que ce soit par les partisans ou les adversaires de Naundorff.
Nous sommes intimement persuadés que Naundorff est Louis XVII. Malheureusement, pour ne pas surcharger cette étude, nous n’abordons pas ici les preuves de cette identification, car il faudrait y rajouter des milliers de pages.
Nous invitons les lecteurs à se rendre sur le site internet :
http://naundorffisme.free.fr, où nous mettons pleins de textes sur ces preuves et témoignages comme quoi Naundorff est bien Louis XVII. Textes que nous rajoutons petit à petit, au fur et à mesure.
Voici également deux sites très bien sur Louis XVII :
www.louis-xvii.com (Le site de l’Institut Louis XVII, qui soutient le descendant actuel de la branche aînée des Naundorff.)
Pour ceux qui n’auraient pas internet, et comme rien ne vaut un bon livre, voici ci-dessous les principaux bons ouvrages récents sur Louis XVII-Naundorff :
_ Xavier de Roche, Louis XVII, Editions de Paris, 1986 (et une seconde édition en 1987), 918 pages !!! Une bible ! Tout y est !
_ Xavier de Roche, Louis XVII, le livre du bicentenaire, Editions de Paris, 1995, 140 pages. Un résumé de son gros livre. A lire absolument, l’essentiel y est.
_ Charles-Louis-Edmond de Bourbon, La survivance de Louis XVII, les preuves, 1999. 50 pages + 50 pages d’annexes. Tout l’essentiel y est également. (Disponible chez Chiré).
_ Philippe Boiry, Naundorff-Louis XVII. Le secret des Etats, Editions Presse de Valmy, Paris, 2001, 176 pages.) De très bonnes preuves.
_ Philippe Boiry, Louis XVII avait-il deux cœurs ?, Editions de Paris, 2004, 420 pages. En grande partie sur le cœur de Louis XVII, l’ADN, etc. (Disponible chez Chiré.)
Certains de ces livres ne sont trouvables qu’en librairies d’anciens et d’occasions.
Voici une liste de bons sites internet pour trouver et acheter des ouvrages anciens et d’occasions :
Les sujets que nous abordons sont peu connus, mais ils doivent sortir de l’ombre, car ils constituent en quelque sorte des preuves (d’un genre différent…)
Cette présente étude a donc pour ambition d’exposer et de rassembler tous ces sujets, permettant ainsi de comprendre deux siècles passés, mais surtout de nous guider pour l’Avenir…
Elle constitue en même temps une fresque de l’histoire du naundorffisme et des naundorffistes.
Mais voici d’abord, avant de commencer, en quelques lignes, les principaux arguments qui nous permettent d’affirmer que Naundorff était bien Louis XVII, puis une petite biographie de Louis XVII-Naundorff :
Naundorff est Louis XVII :
1° Parce que Naundorff avait la mémoire personnelle du Dauphin. Vingt serviteurs de Louis XVI, témoins compétents de l’enfance du Prince, l’ont constaté dans leurs fréquentes relations avec le dit « Naundorff » au cours des années 1833, 34, 35, 36 et 40, et nous en ont laissé témoignage oral, écrit, assermenté, notarié, judiciaire ;
2° Parce que Naundorff avait les mêmes cicatrices accidentelles que la Dauphin ; les marques d’inoculation identiques ; le signalement identique des yeux, des cheveux, du front, du menton à fossette, de la poitrine, de tout le corps ; la double ressemblance des traits, du geste, de la démarche, de la voix, avec les deux maisons de Bourbon et d’Autriche ; la position des dents identique, les rides si spéciales du cou identiques ; l’excroissance au sein identique ; et, sur la cuisse, le signe du « Saint-Esprit », c’est-à-dire une forme de pigeon essoré et plongeant, naturel et non tatoué, identique ;
3° Parce que Naundorff se croyait et, par conséquent, se savait le Dauphin. Il a prouvé ce fait d’intime conscience :
a) En se soumettant au jugement de tous ceux qui pouvaient démasquer l’imposture, les anciens serviteurs de Louis XVI, la duchesse d’Angoulême, les tribunaux français ;
b) Par une affirmation constante de son identité, sans jamais aucune faiblesse ni dans la persécution la plus odieuse et la détresse la plus cruelle causées par cette affirmation, ni dans la joie et dans l’intimité la plus stricte, ainsi que le démontre sa correspondance avec sa femme, publiée soixante ans après sa mort ;
4° Parce que les Gouvernements de Prusse, de France et de Hollande se sont convaincus de l’identité de Naundorff avec Louis XVII.
Donc « Naundorff » était Louis XVII.[1]
Voici un petit résumé de la vie de Louis XVII-Naundorff, emprunté au site de l’Institut Louis XVII :
Le Duc de Normandie, né le 27 mars 1785, Louis-Charles, devenu Dauphin à la mort de son frère aîné Louis le 2 juin 1789, est déclaré Roi de France, Louis XVII, par sa mère la Reine Marie-Antoinette, le 21 janvier 1793, jour de la décapitation de son père le Roi Louis XVI.
Il fut enfermé au Temple du 13 août 1792 au jour de sa « mort » officielle, le 8 juin 1795. En réalité, l’enfant enterré au cimetière Sainte Marguerite et qui correspond bien à celui autopsié au Temple, ne peut pas être Louis XVII : c'est un enfant ayant au moins quinze ans, dont le squelette aux membres trop longs et au thorax étroit est celui d’un scrofuleux (tuberculeux) depuis très longtemps. Or Louis XVII n’avait que 10 ans et sa mère disait qu’il ressemblait à un petit paysan plein de santé.
Il n’y a évidemment pas de trace de cette
sortie du Temple et de la (ou des) substitutions qui ont été nécessaires. Mais
si tous les royalistes ont échoué, par contre Barras, maître du Temple et le gardien Laurent étant
un homme à lui avaient toutes les facilités pour réussir. (Barras, le régicide,
qui fut pensionné par Louis XVIII !)
C’est seulement à partir 1810 que l'on peut
suivre avec certitude la vie de celui à qui les polices d’état ont imposé le
nom de Charles Guillaume Naundorff, réputé né à Weimar en l775, brun aux
cheveux noirs, alors, qu’il avait 10 ans de moins, et comme le Dauphin, était blond aux yeux bleus ! Jamais il
n’a pu être trouvé de lieu de naissance à Naundorff, pas plus à Weimar qu'en
Prusse ou ailleurs.
Il donne au chef de la Police de Berlin les
preuves de sa véritable identité - qui ne lui seront jamais rendues - et ce
Monsieur Lecoq lui remet un simple certificat de moralité qui lui suffira à
être admis bourgeois successivement dans les villes de Spandau, de Brandebourg
et de Crossen où il exercera le métier d’horloger, sans produire d'acte de
naissance, pas plus que pour son mariage en 1818 !
Ses lettres à Louis XVIII, à sa Sœur la duchesse d’Angoulême puis à Charles X et à tous les princes d’Europe restant sans réponse, il vient en France en 1833 et immédiatement cherche à rencontrer toutes les personnes qui l'ont connu enfant à la Cour. Plus de 53 personnes ont attesté qu’il était bien Louis XVII, dont Madame de Rambaud, qui fut sa femme de chambre de sa naissance à 1792, le ministre de la justice Joly de Fleury, le secrétaire de Louis XVI, Monsieur Bremond, le ministre des affaires étrangères de Monciel, Monsieur et Madame Marco De St Hilaire, etc.
Sa ressemblance d’attitudes avec Louis XVI en
frappante. La forme de sa tête est celle de Marie-Antoinette. Sa mémoire qui est remarquable est celle du
Dauphin, tant sur les personnes, les lieux, les
choses, que les événements.
Il attaque sa sœur, la duchesse d’Angoulême, en reconnaissance d’identité en 1836. Mais le gouvernement de Louis-Philippe, au lieu de le juger comme il le demande, le fait arrêter, fait saisir tous les documents qu'il a réunis pour ce procès - 202 documents, sans inventaire -, et après un mois de prison l'expulse en Angleterre… comme étranger !
De 1836 au début 1845, Louis XVII reste donc en Angleterre avec sa femme et ses huit enfants (dont deux y naissent), où il fait des recherches et met au point des inventions pyrotechniques. Il y subit une tentative d'assassinat au pistolet comme il en avait essuyé une en France, au poignard.
Refusant qu’il rentre en France pour la
démonstration de ses inventions, et ne voulant pas les vendre à l'Angleterre,
il pense les vendre à la Suisse, mais ne pouvant passer par la France, passe
par la Hollande où il débarque le 25 janvier 1845. L'avocat van Buren,
convaincu de son identité et de la valeur de ses inventions lui fait rencontrer
les ministres de la guerre et de la marine, et, avec l’accord du roi Guillaume
II de Hollande, un contrat mirifique lui est signé, achetant ses inventions et
le faisant directeur d’un atelier de pyrotechnie à Delft.
Malheureusement il est pris de vomissements
et après huit jours d’agonie où, dans son délire, il évoque son père Louis XVI mort
par la guillotine, il décède le 10 août 1845. Sa veuve ayant refusé une
autopsie, l'empoisonnement n’a pu être démontré. Toutefois, à la demande de ses
fils, un examen du corps est effectué par les médecins militaires qui l'ont
soigné. Ce qui révèle en particulier les traces d’inoculation au bras, en forme
de triangle, comme le Dauphin, la cicatrice de la lèvre, due à la morsure
d’un lapin blanc apprivoisé, les deux incisives inférieures qui avancent en
« dents de lapin », et surtout, une tache de mère, à l’intérieur de
la cuisse gauche, que l’on appelait chez le Dauphin « le signe du St
Esprit » car ressemblant à un oiseau plongeant tête en bas, les ailes
déployées. En plus de ces caractéristiques communes avec le Dauphin, on relève les
traces des deux attentats, sur les côtes et l'omoplate d'une part, et sur le
bras gauche d’autre part.
Tous ses descendants présentent des ressemblances étonnantes avec les Bourbon et les Habsbourg.
Enfin le Roi de Hollande Guillaume
II permet son inhumation sous le nom de « Duc de Normandie, Louis XVII, Roi de France et de Navarre », où sa
tombe est toujours visible, entretenue par la ville de Delft, et la Hollande
reconnaît à ses enfants le droit au nom de « de Bourbon » que tous
ses descendants portent légalement.
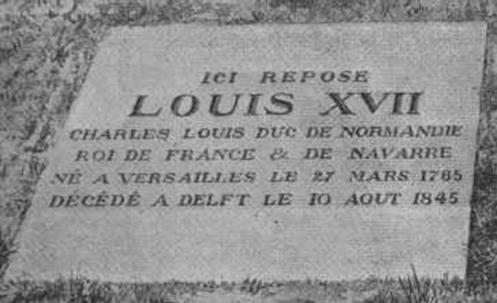
Diverses associations, revues et organismes se sont battus pour faire connaître cette vérité historique occultée et calomniée de la survie du Roi Louis XVII en la personne de Charles Guillaume Naundorff. Nous pouvons citer la revue la Légitimité fondée en 1883 par la princesse Amélie, fille aînée de Louis XVII, puis dirigée successivement par Albert Renard et Louis Champion jusqu’en 1940 ; la revue Flos Forum fondée en 1936 par Armand Le Corbeiller, et le baron Pacotte de Servignat, entre-autres.
Enfin, l'Institut Louis XVII a été fondé le 9 mars 1990, par Monsieur Henri Isle de Beauchaine.
I] Louis XVII et la Religion
1) Sa formation religieuse
Nous savons que Louis XVII a eu une formation religieuse très insuffisante, du fait des évènements révolutionnaires.
Le comte d’Artois, futur Charles X, et le comte de Provence, futur Louis XVIII, étaient indifférents en matière religieuse : le premier n’y reviendra qu’à la mort de sa maîtresse Mme de Polastron, le second, rongé par les remords, lorsque Martin de Gallardon lui aura révélé qu’il tenta un jour, en forêt de Saint-Hubert, de tirer sur son frère futur Louis XVI.
Madame Royale nota dans son « Journal » que sa mère « avait beaucoup de religion depuis qu’elle était à la Conciergerie », sous-entendant ainsi qu’elle en avait peu auparavant. Comment s’en étonner ? Son frère, l’empereur d’Autriche Joseph II, était connu pour son anticléricalisme.
Dès lors, on peut en conclure que le petit Louis XVII, à Versailles, aux Tuileries, à Saint-Cloud, n’eut jamais en matière religieuse qu’un climat d’indifférence, les messes protocolaires exceptées.
Un psychisme saccagé par un emmurement à neuf ans et demi dans le silence, la pénombre, l’isolement ; quatre années de cachot sans air et sans lumière dans les souterrains de Vincennes, à l’âge d’homme ; quatre années de prison dans les cellules de Brandebourg ; des mois de prison en Angleterre... Alors que ses oncles, la soeur et le beau-frère, et le fils de l’assassin de son père se prélassent dans les ors des Tuileries, et ne font rien d’autre par leur influence politique que lui susciter de nouveaux malheurs, à défaut d’assassinats réussis ! Que faut-il donc de plus ?
L’accumulation des persécutions, oeuvres de Bonaparte, de Louis XVIII, de Charles X, de Louis-Philippe, de sa soeur la triste duchesse d’Angoulême, lui firent rapidement comprendre que la pratique religieuse ne garantit aucunement de la malhonnêteté d’une âme.
Aussi, alors qu’en Suisse, se souvenant qu’il était de souche catholique, il n’avait jamais voulu participer au culte protestant et n’avait jamais pris part à la Cène de celui-ci, en Allemagne devint-il indifférent, voire hostile au catholicisme lui-même. A Crossen, au recteur Gaebel (protestant) il déclara un jour : « Mon ami, je vous montrerai la cause de mon incrédulité. Je hais la religion chrétienne, parce que les hommes les plus cruels la professent... »
Le recteur Gaebel prit la chose à coeur, et au printemps de 1830 entreprit de convertir Louis XVII aux beautés du christianisme. Il lui lut le Nouveau Testament, le commenta, et en ces échanges, Gaebel note que son interlocuteur avait un esprit clair et adonné au bien. Mais croire à la divinité de Jésus, à sa résurrection après sa mort, il ne le put pas... Et la suite des souvenirs du recteur Gaebel est fort intéressante :
« Son caractère, après les enseignements de sa naissance, fut plus pur, plus amical et plus humain que d’abord. Il guérit beaucoup d’hommes de leurs maladies ; il enseigna ses enfants soigneusement. Il eut une foi en Dieu qui était bien pure et puissante, et ses actions étaient des actions d’une salutaire activité de son âme. Auparavant il avait souvent joué de la vérité, mais à présent elle lui était sainte. Sur tout, sa volonté était bien idéale et parfaite... »[2]
En 1832, Naundorff vient faire pour la première fois une visite en France. Nous le savons par la propre fille d’un des personnalités qui l’invitèrent à cette date.
La famille Boucault de Mélient est une vieille famille noble d’Anjou. Son chef, sous la Restauration, était un officier de marine fort distingué et fut pendant quelques temps Préfet maritime de Lorient. Sa fille, Marie de Mélient, fondera plus tard le Couvent de l’Immaculée Conception à la Nogard, dans le Finistère.
Le 27 septembre 1873, elle écrivait la lettre suivante à la Princesse Amélie, fille aînée de Naundorff :
« Très bonne Princesse.
... Voici ce que j'ai appris… Il y a eu réellement à Nantes, pendant longtemps, une réunion de personnes qui sont restées fidèles à notre bon roi Louis XVII, et qui avaient formé un projet sérieux de le remettre sur le trône. Ils avaient concerté de le faire venir, et c'est d'après une demande qui lui fut adressée que votre vénérable père vint à Nantes. Là, comme je l'ai déjà dit à Votre Altesse, on le fit descendre dans un petit hôtel, ou plutôt dans une auberge tenue par de braves gens, afin de ne pas se compromettre. II y fut entretenu pendant quelques jours. On devait le faire connaître peu à peu à la noblesse de Bretagne et de Vendée ; et quand il aurait eu un parti sérieux, on aurait présenté au gouvernement une protestation signée d'un nombre considérable de noms honorables.
Malheureusement, on trouva que notre bon Prince avait des idées libérales trop prononcées, une certaine antipathie pour le clergé et une manière très fausse en matières religieuses, parce qu'il développa un nouveau mode de religion contraire absolument à la foi, et avec une tendance très prononcée pour la secte des Illuminés. Alors on craignit de ne pas réussir à lui ouvrir les yeux. La noblesse crut qu'elle allait se nommer un chef républicain. Le clergé eut peur de trouver un antagoniste à la religion catholique. On ne voulut pas se jeter dans toutes les difficultés d'une contre-révolution et peut-être d'une révolution ; et la conclusion fut ainsi portée : « C’est bien le fils de Louis XVI, mais il n'est pas ce qu'il faut à la France. Il est dans l'erreur, plus à plaindre qu'à blâmer, parce que le milieu dans lequel il a vécu en est la cause. Mais les circonstances nous prouvent que Dieu l'a rejeté. Laissons agir la Providence ; et si Dieu le change, il saura bien plus tard le remettre sur le trône de ses pères. »
C'est alors, comme vous le savez, très bonne Princesse, qu'on le fit partir pour Strasbourg. En cette circonstance deux partis se formèrent. Un de ces partis, croyant que Dieu n'avait plus de desseins sur la branche aînée des Bourbons, l'abandonna en s'attachant au Comte de Chambord. L'autre, très peu nombreux, demeura fidèle et pria toujours, espérant que Dieu lui changerait les idées et le ramènerait sur le trône de ses pères...
Marie de Mélient
La Nogard, 27 Septembre 1873. »
Comme le remarque fort justement Xavier de Roche, quand on lit ce texte, « on est confondu par l’aveuglement de la noblesse et du clergé réunis à cette occasion. Le malheureux Louis XVII avait connu dans les quarante premières années de sa vie une dizaine d’années d’emprisonnement dans différentes forteresses, et le reste du temps, à partir de 1795 avait toujours vécu en résidence plus ou moins surveillée. A partir du 3 juillet 1793, il n’a plus reçu aucune éducation religieuse, morale ou politique. Lui en faire grief était d’une inconscience absolue. Il convenait dans un premier temps d’assurer sa reconnaissance officielle, car c’était pour lui un atroce et perpétuel déchirement d’être « sans nom » ; de le mettre, avec sa famille, en sécurité et à l’abri définitif du besoin ; de l’entourer de conseillers capables de l’instruire de tout ce que la vie qu’il avait subie ne lui avait pas permis d’apprendre. Au lieu de cela, on l’a laissé retourner à sa vie de misère, sans plus s’occuper de lui ni de ses héritiers. »[3]
Quelques jours après son arrivée à Paris, Naundorff écrit à Mgr Hyacinthe-Louis de Quelen, Archevêque de Paris la déclaration suivante :
« A-t-on des inquiétudes sur la Foi que je professe ? Je suis membre de l’Eglise Catholique, Apostolique et Romaine. Je la regarde comme seule véritable et je suis prêt à prouver que je n’ai jamais appartenu à aucune autre. »[4]
Naundorff est élevé dans la religion catholique, grâce à l’abbé Appert, curé de Saint-Arnoult, puis il a été confirmé par Mgr Blanquart de Bailleul, évêque de Versailles, enfin son mariage avec Mlle Einert, protestante, a été validé.
Le port de la médaille miraculeuse (qui le sauva de la mort lors de l’attentat du Carrousel du 28 janvier 1834) confirme ce retour au catholicisme, mais le mysticisme de Louis XVII, manifesté plus tard comme nous allons le voir par ses publications hétérodoxes, démontre aussi sa sincérité ; il ne devint pas croyant par intérêt politique.
Les choses sont s’aggraver dans les années suivantes. Plusieurs prélats français, Mgr Forbin de Janson, évêque de Nancy, Mgr Blanquart de Bailleul (qui a confirmé le Prince) sont très méfiants à son égard. Il en souffre.
Après la mort du visionnaire Martin de Gallardon[5], il croit, lui aussi, recevoir la visite d’un ange.
2) Naundorff « prophète »
Naundorff affirme en effet avoir désormais en rêve des apparitions d'un ange, puis du Christ
Martin de Gallardon avait annoncé à Naundorff qu’il serait sujet à l’illusion et que l’esprit du mal chercherait à le perdre.
Bien qu'il n'adhère pas complètement au catholicisme, Naundorff incite sa femme restée en Saxe à s'y convertir avec ses enfants (sa fille Augusta-Maria-Theresa est baptisée catholique, 1835). Son ange lui communique (24 et 30.12.1834) une « croix de grâce »[6] que les prêtres peuvent donner aux catholiques ayant fait leur première communion. La dévotion est répandue (plus de mille croix en six mois) malgré la dénonciation de l'évêque de Versailles (1835). Expulsé de France pour ses revendications politiques (publication d'un journal, citations judiciaires de la duchesse d'Angoulême et adresses au Parlement), il s'installe à Londres (07.1836).
S’estimant persécuté par des évêques, il s’éloigne du catholicisme alors que sa femme en fait profession (1836). Il se présente comme Messie. Préservé des malheurs par Dieu, il va régénérer le monde dans la fidélité à l'Évangile de nouveau révélé. Instruit par son ange, il envoie l'abbé Laprade à Rome pour appeler Grégoire XVI à propager la croix de grâce sous peine de destruction : le pape reste sceptique (01.02.1837).
Naundorff, en 1836, annonce à l’Empereur d’Autriche que son Ange l’en a prévenu, Louis-Philippe a seulement une année à vivre : cet ange était un farceur, puisque Louis-Philippe devait régner encore 12 ans…
En 1838, il fait diffuser des avertissements successifs au clergé catholique : Rome sera détruite à moins qu'un concile ne soit convoqué au cours duquel Dieu parlera par Naundorff; la croix de grâce doit être propagée pour la réunification des Eglises ; le clergé français doit se réunir en conseil car une nouvelle Eglise doit s'établir en France. Ses prophéties non réalisées, il appelle les clergés anglais et irlandais à se joindre à lui et devient protecteur du Conseil d'une Eglise du Seigneur (24 et 31.10.1838), bientôt Eglise catholique évangélique.
Il publie ou fait publier (ses révélations, en allemand, sont traduites ensuite) la Partie préliminaire, ou Introduction à la Doctrine Céleste de Notre Seigneur Jésus-Christ publiée par Charles Louis, Duc de Normandie, fils de Louis XVI, roi de France et Doctrine céleste, ou l'Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ dans toute la pureté primitive, tel qu'il l'a prêché lui-même pendant sa carrière terrestre : Révélé de nouveau par trois Anges du Seigneur, et confirmé par Jésus-Christ lui-même, par la réprobation de la Papauté romaine ; avec toutes les preuves de Son imposture contre la doctrine de notre Sauveur (1839, traduits en anglais) et suscite le mensuel La Voix d'un proscrit, qui défend bientôt ses positions religieuses. Dénonçant les prêtres catholiques au ministre des Affaires ecclésiastiques du roi de Prusse, il lui donne l'ordre de réunir un conseil de dix membres luthériens dirigés par deux évêques catholiques pour se soumettre à la Doctrine Céleste à laquelle le peintre allemand Rudolf Mannl adhère ainsi qu'Emile Sauveur (Le véritable orphelin du Temple vivant en 1839, ou preuves de l'existence actuelle du fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, 1839).
Voyons quelle est la doctrine de Naundorff.
Voici l’extrait d’un article de César de
Vesme, dans le numéro 4 de la Revue
Métapsychique (juillet-août 1935), pages 328 et
suivantes :
« William Stead, dont le nom est hautement et justement
honoré par les spirites, a inséré dans sa revue Boderland (1895, p.
166), un article de Mr. W.-R. Tomlinson, intitulé : « Allan Kardec était-il disciple de Naundorff ? » L’auteur y cherche d’abord
quelle peut avoir été l’origine du désaccord entre les spirites néo-latins et
ceux anglo-saxons au sujet de la « Réincarnation » et se demande où
Léon Rivail (Allan Kardec) a puisé cette doctrine, que les
spirites anglais et américains n’ont pas reçue de leurs « esprits ».
Il pense qu’il est probable que, vers 1848, il ait été impressionné par la
lecture d’un livre publié en français et en anglais par le duc de Normandie
(Naundorff) en 1839, intitulé : La Doctrine Céleste de Notre Seigneur
Jésus-Christ dans toute sa pureté primitive, révélée par trois anges du
Seigneur. Promulguée par Charles-Louis, Duc de Normandie, fils de Louis XVI, Roi de France.
Mr. Tomlinson ne
cite pas, les ignorant peut-être, trois autres livres de Naundorff : Partie préliminaire de la
doctrine céleste (1839), Révélations sur les erreurs de l’Ancien
Testament (1840), Salomon le Sage (1841). Mais pour démontrer
brièvement que la doctrine développée en ces différents ouvrages est
foncièrement celle qu’Allan Kardec a
enseignée dans les siens, plus de vingt ans après, Tomlinson reproduit les
lignes suivantes dans lesquels un ami et disciple de Naundorff, le comte Gruau de
la Barre, a résumé la doctrine de son Maître dans
le journal la Légitimité du
12 décembre 1880 :
1° L’Eternel est le seul Dieu, et non pas
un Dieu en trois Personnes. [Doctrine de l’Eglise Chrétienne Unitaire, des
Sociniens, etc.]
2° Toutes les âmes ont été créés dans le
Ciel avant la fondation de la Terre ; ce sont elles qui composent
l’humanité en s’installant dans les corps nés des hommes. [Doctrine de la
Préexistence, au moins aussi ancienne qu’Origène, et que l’Eglise catholique
elle-même ne considère pas comme proprement hérétique, se bornant à l’ignorer.]
3° Tous les hommes sont « fils de
Dieu » comme Jésus-Christ, par l’esprit et l’âme qui constituent leur être
immortel, et « fils de l’homme » par leur corps mortel, qui revient à
la Terre ; tandis que leur personnalité spirituelle continue sa carrière terrestre
en d’autres corps humains, tant qu’ils ont accompli le vouloir de Dieu dans
cette planète.
4° Jésus-Christ fait Seigneur de ce monde
par l’Eternel, son Père Céleste, est notre frère du Ciel, d’où nous provenons
et où nous retournons conformément au mérite de nos œuvres, en remontant
successivement par tous les ciels…
5° Nous serons tous sauvés à une époque
donnée de l’Eternité. »
On retrouve également dans la Doctrine Céleste, l’influence Swedenborgienne. Naundorff avait lu un livre de Swedenborg, livre qu’on a trouvé, annoté par lui. La Doctrine Céleste demanda à l’auteur un très gros travail sur l’histoire des diverses Eglises. Osmond a eu entre les mains toutes les archives relatives à la Doctrine Céleste, retrouvées en 1884, à Bréda, par le marquis de Meckenheim. On y trouve des manuscrits (en deux exemplaires, l’un original, de la main de Naundorff, l’autre, une copie, de la main de Gruau de la Barre, corrigeant les fautes de style et d’orthographe), mais également des billets, notes, lettres tous de la main de Naundorff, relatifs à des apparitions, des rêves, des prédications.
II suscite un intérêt religieux chez certains anglais (Révérend M. W. Smith). Les éditeurs de La Doctrine céleste sont condamnés (12.1839) alors qu'en 1838 des plaintes de l'évêque de Châlons étaient restées sans effets. Il prophétise sur 1840 (mort du pape, malheurs publics), fait éditer les Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament publiée par le docteur Charles de Cosson (1840). Son ange donne (09.05.1840) à l'Eglise un Conseil de douze membres (frères Laprade, Gruau, Appert, Chabron de Jussac, Vidal, Albéra, Dussurgey, Morel de Saint-Didier, Roydor, Gozzoli, C. de Cosson) et invite les prêtres catholiques à se soumettre et à se réunir à son Conseil pour juger le pape. Mais les contradictions entre ses visions (l'Histoire de la Création diffère de La Doctrine céleste), les prophéties non réalisées, les tensions entre ses partisans et sa retraite (justifiée par son ange), suscitent une rupture. Certains conseillers demandant l'abandon de son système contradictoire et erroné (18.01.1841), il les laisse libres de rompre (19.01) puis provoque une altercation (21.01) scellant la scission. L’Histoire de la Création paraît cependant sous le titre de Salomon le Sage, .fils de David ; sa renaissance sur cette terre et Révélation céleste, publié par M. Gruau de La Barre, Ancien Procureur du Roi. Deuxième et Troisième parties, Faisant suite à la première, intitulée : Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament (1841).
Vintras[7], qui reconnaît en lui le Grand Monarque, réinterprète la croix de grâce qu'il a peut-être reçue, lui donne un nom angélique et essaie en vain de se l'attacher. Ils sont conjointement réprouvés par Grégoire XVI (02.1842), les Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament et Salomon le Sage sont mises à l'index (13.09.1842). L'abbé Charvoz le visite lors de son incarcération pour dettes pour le ramener à l'orthodoxie, sans succès (09.1843).[8]
3) Le Bref de
Grégoire XVI
Les anti-naundorffistes donnent souvent comme argument que le pape Grégoire XVI condamna Naundorff.
Qu’en est-il réellement ?
Il s’agit d’un bref de Grégoire XVI, bref qui concerne l’hérésiarque Vintras, mais dont un passage concerne Naundorff. Voici le passage de ce bref, publié dans l’Ami de la Religion, n° 3865, jeudi 8 février 1844 :
« Bref adressé par Sa Sainteté Grégoire XVI, à M. l’évêque de Bayeux :
A notre Vénérable Frère Louis-François, Evêque de Bayeux
[…] Les fictions et les extravagances impies de cette société sont tout à fait conformes aux idées de ce fils de perdition qui usurpe le titre de Duc de Normandie, et qui, déserteur de l’Eglise catholique, marche, au mépris de l’autorité du Siège apostolique, dans ses voies abominables, publie des doctrines perverses, professe, quoique sous une forme et avec des couleurs différentes, les mêmes erreurs, les mêmes sentiments, les mêmes intentions que cette exécrable société […]
Donné à Rome, à Saint Pierre, le 8 novembre de l’année 1843, le 13e de notre pontificat. »
Nous pouvons également lire ce bref dans les Acta gregorii papae XVI, Rome, 1902, Tome III, pages 298-299. Voici le passage qui nous intéresse, en latin : « Quae impia istius societatis commenta atque deliria plane congruunt cum mente illius perditi hominis, qui falso se Normandiae ducem iactat, quique a catholica Ecclesia iam descivit, atque huius Apostolicae Sedis auctoritate spreta. »
Certains naundorffistes font remarquer qu’il faudrait encore être certain que le mot « falso » se trouve bien dans le texte, dont nul n’a vu l’original… qu’on ne retrouve plus dans les archives du Vatican. On ne retrouve plus non plus la minute de ce bref qui devrait se trouver dans les archives de l’évêque de Bayeux qui ne l’a pas publié ; c’est à la suite d’une indiscrétion, dont l’évêché de Bayeux se défendit, que l’Ami de la Religion du 8 février 1844 a pu l’insérer dans ses colonnes.
La question « le mot falso s’y trouve-t-il ? » n’a jamais reçu de réponse de la part des autorités intéressées. Alors, figure-t-il vraiment sur le bref papal ?[9]
L’évêché de Bayeux n’en possède plus qu’une « copie privée » : ce sont là les propres termes de l’évêque de Bayeux écrivant au Comte de Cornulier-Lucinière le 24 février 1907 (Légitimité, 1907, page 64).
Le fameux bref de Grégoire XVI à l’évêque de Bayeux n’a pas été publié par ce prélat. Il a été publié seulement, par suite d’une indiscrétion, dans le numéro du 8 février 1844 de l’Ami de la Religion. D’après les vintrasiens[10], le bref fut rédigé au Gesu de Rome par les pères Rosaven et de Villefort, assistants de France auprès du général. Et c’est le père Vaur, avoué de l’Ambassade Française au Vatican, qui parvint à obtenir, après deux ans et demi, la signature de Grégoire XVI.
Quoi qu’il en soit, l’évêque de Bayeux a pris ce bref pour une lettre privée et non pour un acte officiel du Saint-Siège, puisqu’il ne l’a pas publié. Et il ne se trompait pas, puisque Rome n’a pas repris l’évêque de son silence. Sans l’indiscrétion d’un journal dont l’évêché de Bayeux se défendit, le bref n’aurait probablement pas vu le jour.[11]
Depuis 1843, l’abbé Charvoz, curé de Montlouis,
avait envoyé sa démission à son archevêque. Il avait vendu ses meubles et muni
ainsi de quelqu’argent, il était parti pour Londres en septembre de la même
année. Il avait résolu d’y opérer la conversion de Naundorff de plus en
plus hérétique. Charvoz avait été
bien reçu au début, puisqu’il venait avec un peu d’argent. Après quelques
temps, l’abbé était parti pour Rome. Il voulait éclaircir les conditions dans
lesquelles avait été rédigé le Bref de Grégoire XVI.
Il en avait rapporté, disait-il, l’assurance formelle qu’au lieu d’un Bref, c’était une simple lettre particulière qui avait été envoyée par le pape à l’évêque. Cette lettre, affirmait-il, voulait qu’on ne la considérat que comme un premier pas, dans l’information à venir. Il affirmait que le père Vaur, pénitencier français, lui avait dit : « la lettre n’a point été donnée en forme de Bref, et Sa Sainteté a blâmé vivement la publicité qui en a été faite en France… Elle n’emporte donc aucune obligation de conscience. »[12]
Toujours est-il que, dans tous les cas, le bref de Grégoire XVI n’est qu’un bref, et non pas une proclamation solennelle.
Or, le prodige de l’infaillibilité pontificale, dévolu au Souverain Pontife parlant ex cathedra, n’a rien à voir dans la circonstance.
D’ailleurs, lors même que la proposition eût figuré dans un décret public et solennel du Saint Père, elle n’en aurait pas pour cela plus de valeur quant au fond. Car si le pape ne peut errer quand il s’adresse ainsi à l’Eglise, en fait de dogme, de morale ou de discipline, il est, tout aussi bien que le commun des mortels, faillible dans les questions étrangères à la religion, du moment où il se trouve mal renseigné ou mal instruit.
La preuve, c’est que dans ce bref, il y a une erreur historique : contrairement à ce qu’il affirme, il n’y a jamais eu aucun rapport entre Naundorff et Vintras, dont le Prétendant n’a en aucune manière contribué à répandre les erreurs. Ce bref fut basé sur aucune documentation particulière. Il fut émis à une époque où l’on ne possédait qu’une information très incomplète.
Un prince peut, sans perdre cette qualité, avoir le malheur de tomber dans l’hérésie. Le dogme de l’infaillibilité papale ne s’étend pas aux simples questions d’Histoire.
Les erreurs religieuses de Louis XVII ne prouvent pas plus son origine royale que la lamentable chute du roi Salomon, qui cependant avait reçu de la Providence plus de dons naturels et surnaturels que l’infortuné proscrit de la royauté française.
Henri IV cessait-il d’être Bourbon, quoique huguenot ? Le voltairien Louis XVIII, qui ne croyait à rien du tout, n’était-il pas toujours le frère de Louis XVI ? Pour être devenu hérétique, Henri VIII d’Angleterre, cessa-t-il d’appartenir à la dynastie des Tudors ?
4) La fin de
Louis XVII-Naundorff
Après le bref adressé par Grégoire XVI à l’évêque de Bayeux, sept des amis du Prétendant l’abandonnèrent et publièrent contre lui, le 16 février 1841, une déclaration où ils se désolidarisaient de lui, protestant « contre les agissements religieux et les prétendues visions du personnage. ».
Il est bon de remarquer que, parmi les sept, il n’y avait pas un seul des anciens serviteurs de Louis XVI, témoins compétents de l’enfance du Dauphin.
Plus tard, la quasi-totalité des signataires de cette déclaration crurent devoir, en conscience, la rétracter, à commencer par les frères Laprade, qui proclamèrent ensuite jusqu’à leur mort qu’ils avaient voulu se démarquer des prises de position trop aventurées du Prétendant sur la plan religieux, mais qu’ils n’avaient jamais eu le moindre doute sur son identité royale.
Plus précisément, de ces sept partisans qui firent défection, deux (le chevalier A. de Cosson et Charles de Cosson) le renièrent définitivement ; un autre (Hugon Roydor) passa à Richemont ; les quatre autres ne cessèrent jamais de reconnaître en Naundorff le fils infortuné de Louis XVI : c’étaient A. Gozzoli, qui est mort en 1896 après avoir attesté une fois de plus (à l’encontre des affirmations mensongères de P. Veuillot), sa foi constante et inébranlable à l’identité royale de Naundorff, M. Chabron de Jussac, l’abbé J.-B. Laprade et son frère Xavier, dont on a les protestations de 1851, 1872 et 1874.[13]
Quand Louis XVII envoyait l’abbé Laprade à Rome pour supplier le Pape de juger sa cause, Grégoire XVI disait à l’envoyé du Roi proscrit : « Je le bénis, lui et les siens, mais vous comprenez que, comme pape, je ne puis rien faire pour lui. »
Louis XVII entra dans le coma, ne reconnaissant plus les siens, et délirant. Et c’est ici que se place le plus cinglant démenti des dires de certains anti-naundorffistes haineux, car on ne ment pas dans le délire…
Le lieutenant général Van Meurs écrira 27 ans plus tard, à la demande de Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, la lettre en date du 26 juin 1872 dont cet extrait :
« Toutes les relations de sa vie que le Prince m’a faites, et ma présence continuelle dans sa chambre pendant sa maladie, m’ont mis à même de pouvoir bien observer toutes ses actions, toutes ses paroles. Eh bien, tout ce que je lui ai entendu dire, alors qu’il pensait haut en ses nuits sans sommeil, tout ce qu’il a dit également en son délire et même peu avant sa mort, tous ces évènements et la triste fin de cette vie de malheur, sont pour moi autant de preuves convaincantes que le nommé Naundorff était le duc de Normandie, le véritable Dauphin, fils de Louis XVI, martyr de la politique et de la haine de ses plus proches parents.
TH. Van Meurs, lieutenant général, La Haye, ce 26 juin 1872. »
Parallèlement à ce témoignage, voici maintenant celui des deux médecins qui le soignèrent jusqu’à sa dernière heure ; il a été établi également à la demande de Jules Favre, à Delft, le 30 mai 1872 :
« Nous soussignés, docteurs-médecins en fonctions à Delft, Jean Soutendam et Jean-Gérard Kloppert, autrefois Officier de Santé, et comme tel adjoint comme médecin consultant par feu Son Excellence le ministre List, déclarons avoir traité en 1845 celui qui se nommait Charles-Louis de Bourbon duc de Normandie.
Beaucoup d’intérêt fut témoigné à l’auguste malade. Des bulletins furent envoyés journellement sur l’état de sa santé au ministre susdit, qui de temps en temps vint en personne prendre des informations.
[…] Les pensées du malade s’arrêtaient principalement sur feu son malheureux père, Louis XVI, sur le spectacle effroyable de la guillotine ; ou il joignait les mains pour prier et demander, avec des paroles entrecoupées, de bientôt rejoindre au ciel son royal père. Presque jusqu’au dernier soupir ce fut ainsi. Et Charles-Louis de Bourbon mourut en notre présence le 10 août 1845.
Delft, le 30 mai 1872. »
Nous savons par les archives de la Maison de Bourbon, branche des Pays-Bas, par la revue la Légitimité[14], et le témoignage de l’abbé Pochat-Baron[15] que :
Le père Aloys, religieux de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, qui était originaire de Delft même, a témoigné que Louis XVII, se sentant gravement malade en revenant de Sccheveningen, fit appeler un prêtre catholique.
Le père Garneaux, religieux de la Congrégation du Très-Saint Rédempteur, témoigna que ce fut son confrère le père Bernard qui entendit en confession Louis XVII alors qu’il était encore en possession de ses moyens d’expression.
Ce qui a fait oublier ces faits, c’est que Gruau de la Barre était alors parti à Londres chercher la famille du prince, qu’à leur retour il était déjà dans le délire, et que le prêtre avait ainsi officié bien avant leur arrivée.
5) Louis XVII s’est-il fait sacrer ?
Nous n’en sommes personnellement pas sûr.
Cependant, c’est ce qu’affirme Marguerite de la Tour du Pin Chambly de la Charce, dans le témoignage qu’elle donne au journal la Légitimité de septembre 1906, pages 630-632 :
« Lorsqu’en 1876, j’alla à Rome avec mon père, en entrant à Saint-Pierre du Vatican, presque au seuil, à l’intérieur, au centre du merveilleux dallages de marbres variés à l’infini, est un immense morceau de porphyre rouge formant une incrustation circulaire d’environ un mètre 50 cm de diamètre. Mon père m’arrêta là, et, s’agenouillant avec moi sur ce pavé de marbre, il murmura : « la tradition veut que cette pierre indique la place où Charlemagne fut sacré ; et sur cette pierre votre grand’mère affirmait que le bon Pie VI avait sacré Louis XVII. Je baisai la pierre avec ferveur, gardant la tradition dans mon cœur et ma mémoire. Je le connaissais dès l’enfance, cette tradition. […]
Les années passèrent ! En 1893, le jour des saints Innocents, et au champs des Martyrs ( !...), je reçus chez moi la petite-fille des Rois martyrs. Une de mes amies intimes (beaucoup plus âgée que moi), la marquise Deville de Sardelys, née Green de Saint-Marsault, dès qu’elle sut la présence de la princesse Cornélie sous mon toit, accourut pour saluer en elle tous nos martyrs royaux.
Ce fut alors que la marquise de Sardelys me confirma la tradition de ma famille :
« La survivance et l’identité sont bien connues à la cour d’Espagne, et les Bourbons de Naples n’ignorent pas le sacre du Dauphin-Roi par Pie VI.
Pour moi, j’en ai la tradition de première main par mon père (marquis Green de Saint-Marsault, ancien préfet de Versailles), qui avait connu un des témoins, son oncle, Mgr Green de Saint-Marsault, évêque de Bergame, mort à Rome et enterré à Saint-Louis des Français. Il était l’aumônier de Mesdames de France, en dernier lieu, de Madame Adélaïde ; et c’est en cette qualité que, bien que n’étant pas cardinal, il fut convoqué à assister à cette cérémonie. Il disait que le cardinal Maury savait le fait et avait mission de le porter officiellement à la connaissance du gouvernement français. »
Le marquis Deville de Sardelys, présent à cet entretien, confirma la tradition qu’il tenait de son beau-père et du milieu où il vécut et qui était la cour d’Espagne.
Un peu après le fatal bazar de la Charité (où la marquise de Sardelys perdit sa sœur, la baronne Caruel de Saint-Martin, née Green de Saint-Marsault), mon amie de Sardelys s’établit chez moi, à Paris, pour quelques mois. La Reine Isabelle II vint la voir chez moi. Naturellement, dans mon salon, il ne pouvait être omis de parler de la Cause. Précisément, j’allais partir pour Teteringen. La reine Isabelle me dit :
« Portez mes vœux à mon cousin !... et dites-lui que je sais ce que l’on souffre en exil !... »
Elle me parla longuement de Charles XI, fils de Louis XVII, haussa bonnement les épaules sur « les motifs… pécuniaires qui seuls empêchaient la reconnaissance par la famille. » Je saisis l’occasion de lui demander si elle avait entendu parler du sacre de l’enfant-roi par Pie VI ?
« C’est un fait que nul Bourbon – de ma génération au moins ! - n’ignore ! Pas plus qu’aucun souverain d’Europe ! » Me répondit la Reine.
Lorsque j’allais, avec la marquise de Sardelys, lui rendre sa visite, au palais de Castille, avenue Kléber, Sa Majesté me montra sur sa table, au milieu d’autres portraits, un portrait de Louis XVII enfant, et avec un air malin, elle dit bien haut : « Et il n’est pas mort au Temple ! » au grand ébahissement des quelques français présents.
[…] Puis Marguerite de la Tour du Pin raconte son entretien avec Léon XIII :
« Est-il vrai que Pie VI ait sacré le petit roi en présence d’une vingtaine de cardinaux, dont le cardinal Maury et Mgr Green de Saint-Marsault, évêque de Bergame, aumônier de Madame Adélaïde, lequel assistait à ce sacre comme aumônier de la tante du petit roi… Est-ce vrai ?
Léon XIII répondit avec fermeté :
« Si ! Si ! E vero. »
Moi : Et c’est bien l’infortuné fils de Louis XVI qui a été affublé du nom de Naundorff ?
Léon XIII : « Si ! Si ! Tutta questa è vero ! (Oui, oui, tout cela est vrai !) Ma chè ! Ci vorrebbe un miracolo ! (Mais quoi !... il faudrait un miracle !) »
II] Les descendants de Louis XVII et les papes
On met toujours en avant le Vatican en ce qui concerne la Survivance de Louis XVII. Mais, depuis le Concordat, Rome s’est imposé la règle du silence et de la bienveillance, règle invariable dictée par la prudence et la sagesse, afin de vivre officiellement en bonne intelligence avec tous les gouvernements en général.
Mais parfois les Maîtres de la Maison se départissent du silence.
Le 7 avril 1907, l’Observatore Romano publiait le communiqué suivant :
« Nous avons vu récemment comment les défenseurs de la légitimité des Naundorff pour la succession de Louis XVI citent, à l’appui de leur thèse, les actes et paroles de divers souverains pontifes dans le but de faire croire que ceux-ci se sont prononcés d’une manière quelconque dans le sens qu’ils voudraient. Sans entrer le moins du monde, pour notre compte, dans une semblable controverse, nous tenons, par respect pour la vérité historique, à affirmer deux choses seulement. La première est que, des documents invoqués ou supposés, le seul par eux attaqué, à savoir celui qui émane de Grégoire XVI de sainte mémoire, est d’une authenticité indiscutable, car il se trouve dans le recueil officiel des actes de ce pontife. La seconde est que jamais et d’aucune façon l’autorité pontificale ne s’est prononcée dans le sens de la thèse qu’ils défendent. »
Sans être une version officiel, l’Observatore Romano nous présente une opinion pleine de prudence : « sans entrer le moins du monde pour notre compte dans une semblable controverse », nous dit le rédacteur ! En effet, nous allons maintenant rencontrer des opinions catégoriques, émanant de papes et de dignitaires de l’Eglise, et qui affirment nettement le contraire.
Madame Amélie fut une femme d’une piété extraordinaire. Elle avait épousé Abel Laprade, frère de l’abbé du même nom.
En mai 1872, le Pape Pie IX fait parvenir trois bénédictions dont une pour « S.A.R. Amélie de Bourbon » (1819-1891, fille de Louis XVII) et une pour sa mère, « S.A.R. la duchesse de Normandie ».
Voici un article de la Tradition légitimiste :
« Un prêtre de nos amis nous écrit une lettre de laquelle nous détachons le passage suivant :
Le documentateur de Louis XVII fut l’abbé Blanchet, dont le nom a paru plusieurs fois dans votre revue, prêtre entre les mains de qui abjura le protestantisme notre Prince Henri, duc de Normandie.
Il fut mon ami pendant 40 ans ; il est mort il y a 7 ans. Vous pourrez compléter l’alinéa en faisant connaître l’opinion de Sa Sainteté Pie IX. Monsieur l’abbé Blanchet était allé à Delft passer toute une semaine pour recueillir des détails sur Louis XVII, de la bouche de sa veuve, la duchesse de Normandie.
Quand il revint à Fribourg, où il résidait et s’occupait très activement de la question royale, la duchesse le pria de porter au Pape Pie IX une copie authentique officielle de l’acte de décès de Louis XVII. Il s’attendait à être obligé de fournir des explications au Saint Père. Au contraire, dès qu’il eut nommé la duchesse, Pie IX l’interrompant :
« Dites à la duchesse de Normandie, à la reine, que je lui adresse mes plus sincères condoléances. Je suis du nombre des tout convaincus et croyant de la cause Naundorff-Louis XVII, duc de Normandie. De plus, je tiens à déclarer que je regrette vivement une erreur de mon prédécesseur Grégoire XVI sur une fausse indication du Nonce à Paris. Il a prononcé le mot imposteur appliqué à Louis XVII. Je regrette cela très vivement. »[16]
En 1879, la fille aînée de Naundorff, la Princesse Amélie, adresse à S.S. Léon XIII la prière suivante : « J’ose espérer que Votre Sainteté exaucera la prière de la petite-fille du Roi-Martyr et voudra bien lui envoyer sa bénédiction comme gage de salut et de suprême espérance. » et elle signe « Amélie de Bourbon. »
Cette lettre n’est pas considérée comme une impudente tromperie, la réponse écrite de la main même du Pape, est adressée à « Son Altesse Royale Madame Amélie », et le secrétaire d’Etat, cardinal Nina, écrit dans les mêmes termes (21 juillet 1879) : « Madame la Princesse, la réception de votre honorée lettre du 14 courant me fournit l'occasion de vous exprimer les sentiments de respect et d'estime pour votre Altesse et l'auguste famille des Bourbon... »
En mai 1879, l’abbé Adolphe Blanchet de Thielmans, professeur d’histoire à Lausanne, fut chargé par le prince Louis-Charles, aîné des fils survivants de Louis XVII, de présenter au pape Léon XIII quatre chevalières d’or gravées aux nouvelles armes de la Maison de France. Le prince et sa sœur Amélie avaient en effet décidé en 1879 de porter le Sacré-Cœur en « abîme » sur l’écu traditionnel aux trois fleurs de lys. Et le pape Léon XIII accepta de bénir lui-même ces quatre anneaux, sachant à qui ils étaient destinés, à savoir les fils de Naundorff ou leurs enfants males. Et le pape ne s’étonna nullement de les voir arborer les « pleines armes » des Bourbons.[17]
En 1879, l'abbé Henry Dupuy publia un ouvrage intitulé La Survivance du Roi-Martyr qu'il soumit à la censure romaine sur lequel celle-ci se prononça dans les termes suivants :
« Le soussigné, ayant reçu le mandat d'examiner l'ouvrage intitulé La Survivance du Roi-Martyr, par un Ami de la Vérité, déclare qu'après l'avoir lu attentivement, il n'y a rien trouvé de contraire à la foi et aux bonnes mœurs. Il en recommande vivement la lecture.
Rome, le 23 décembre 1879,
P. Pie Carullo,
Docteur en Théologie et curé de Sainte-Dorothée. »
Cette attestation fut légalisée par le cardinal Monaco-Lavaletta, cardinal-vicaire général du pape, le même jour 23 décembre 1879.
Le 27 mai 1881, l'auteur de cet ouvrage, qui eut beaucoup de succès dans les milieux romains, reçut une lettre élogieuse de Mgr Giuseppe Pennacchi, consulteur de la Sacrée Congrégation de l'Index, rédacteur en chef des Acta Sanctae Sedis, et qui fut professeur d’histoire à l’Université de Rome jusqu’en 1870, lui écrivant :
« Je réponds un peu tard parce qu'auparavant j'ai voulu lire le livre La Survivance, que j'ai parcouru très vite, mais en entier, avec à la fois une grande tristesse d'âme et aussi une grande joie.
Bien que j'avais déjà entendu dire que le Dauphin s'était évadé du Temple, les documents me faisaient cependant défaut pour prouver cette évasion.
Je vous remercie infiniment, car par l'envoi de ce livre vous m'avez rendu certain de ce fait.
Depuis 1865, je suis professeur d'histoire ecclésiastique : jusqu'en 1870, à l'Université Romaine, et maintenant, grâce à Léon XIII, au Séminaire Romain de Saint-Apollinaire.
Vous me concéderez ainsi très facilement que je connais un tant soit peu la réalité et la force probante des documents historiques, ainsi que les critères qui enseignent à discerner la vérité historique.
Voici donc mon jugement :
1°) Ou bien les documents allégués dans le livre sont apocryphes et doivent donc être rejetés.
2°) Ou bien, si on les admet, Charles-Guillaume Naundorff est bien Charles-Louis, fils du Roi de France Louis XVII.
Je ne vois pas avec quels arguments on pourrait défendre le premier terme de cette alternative : il reste donc à admettre le second.
Fasse Dieu que les Français rendent aux fils de ce si malheureux Prince [naturellement roi !] la justice qu'ils dénièrent à leur père.
Je l'avoue : la politique d'aujourd'hui est une fontaine d'iniquités, mais je ne savais pas à quel point elle pouvait être inique.
Il est vrai que, comme Dieu enlève l'esprit à ceux qu'il veut perdre, les adversaires de ce Prince si infortuné ont prouvé son origine royale par leurs propres persécutions.
Plaçons en Dieu notre Espérance afin que nous puissions chanter un jour : « Tout ceci a été permis par le Seigneur, pour qu'un miracle éclate devant nos yeux ».
Mais, dites-moi : n'y-a-t-il personne en France pour suggérer au Comte de Chambord de porter au moins secours à cette pauvre famille et de lui restituer ce qu'il retient ?... »[18]
Le Prince Louis-Charles (Charles XI de droit), consacra en 1883 la France au Sacré-Cœur au cours de deux cérémonies émouvantes, l’une au Sacré-Cœur de Montmartre, l’autre à Paray-le-Monial.
Voici le texte de la consécration, faite par Charles XI de droit, le jour de Noël 1883, dans la chapelle provisoire, à côté du chantier de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre en construction :
« Moi, Louis-Charles de Bourbon, fidèle au vœu de mon aïeul Louis XVI, le Roi martyr, je déclare que, de mon plein gré, je renouvelle et confirme le changement déjà fait des armes de notre maison.
Je veux que le Sacré-Cœur brille dans notre écusson, et qu’il soit brodé dans nos étendards.
Je consacre ma personne, ma famille et le royaume de France à ce Divin Cœur. »
Voici le dernier paragraphe de la déclaration faite le 16 décembre 1884 à Paray-le-Monial par Louis-Charles de Bourbon, à la Nation Française :
« Français, en adhérant pleinement aux enseignements infaillibles de la Papauté, la France retrouvera ses grandeurs passées et rentrera dans sa vocation de fille aînée de l’Eglise.
Je montre la voie à tous en déclarant que le Syllabus, la bulle humanum genus et les autres actes pontificaux indiquent ce que les peuples doivent croire et ce que les rois doivent pratiquer.
Obéir à l’Eglise et lutter contre la Révolution, voilà le salut.
Pour faire exécuter ce programme, il faut une autorité légitime, n’ayant aucune attache avec la Révolution et ne relevant que de son Dieu et de son droit.
Fils aîné de Louis XVII, petit-fils de Roi Martyr et gardien d’un dépôt sacré, je ne saurais pactiser avec la Révolution, ni abdiquer aucun droit.
Par ma naissance je suis votre roi.
Si je viens à mourir en travaillant à votre régénération ou en combattant à votre tête, mes héritiers légitimes seront les enfants de mon frère Charles-Edmond, décédé le 29 octobre 1889.
Mon frère Adelberth et ses fils ne viennent qu’après eux.
Je veille sur l’éducation de mon successeur. Il sera le digne fils de Saint Louis ; je vous en donne ma parole d’honnête homme et de chrétien.
Cette nombreuse descendance de Louis XVI, consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, assure l’avenir de la Monarchie.
Cet avenir est à nous parce que nous voulons être à Dieu. »[19]
Le prétendant répond ainsi au désir exprimé par la Sacré-Cœur sous Louis XIV à la Bienheureuse Marguerite Marie.
Voici un extrait du livre de Léon Bloy : Le Fils de Louis XVI, page 69 :
« 28 juin 1889. Voici les paroles du Roi (Charles XI, fils de Louis XVII-Naundorff) :
O Mon Adorable Maître, puisque vous avez eu l’extrême bonté d’indiquer vos volontés saintes à mon aïeul Louis XIV, je prends l’engagement de les exécuter toutes, le jour où votre infinie miséricorde m’aura rendu la puissance politique et le rang social de mes ancêtres. Mais, en attendant, je vous promets, ô Divin Cœur de Jésus, de maintenir toujours votre Image sacrée dans les armes et la bannière de ma famille. Je vous promets en tant que simple fidèle, un constant hommage d’amour et d’adoration ; en tant que Roi de droit, sinon de fait, de la fille aînée de votre Eglise, un hommage lige de particulière soumission et dépendance. Comme Roi légitime de cette catholique nation, je jure d’honorer en vous le Roi des Rois et d’être fier de saluer en vous le seul vrai Roi de France dont je ne veux être que l’humble Lieutenant. Je vous promets, ô divin Cœur de Jésus, de posséder toujours sous mon toit votre Image sacrée, de l’y mettre à une place d’honneur et de l’y vénérer chaque jour. Je vous promets d’élever un jour, dans le Palais de mes Pères, une chapelle consacrée à votre divin Cœur et d’y venir souvent, à la tête de ma cour et des principaux officiers de ma Couronne, m’y reconnaître votre vassal. Je vous promets de consacrer, immédiatement après mon sacre, à votre Cœur sacré, ma personne, ma Famille et mon royaume. »
On connaît la fameuse rencontre entre Léon XIII et Lyautey. Léon XIII, recevant Lyautey, jeune officier, lui déclara avec force et à sa grande stupéfaction « qu’il n’était pas légitimiste », au sens où cela s’entendait alors, c'est-à-dire du vivant du Comte de Chambord, fait relaté dans une lettre écrite en 1883, où le futur maréchal exprime son émotion sur « ce qu’il aurait tant voulu ne pas être sûr d’avoir entendu. »
En 1884, M. le comte de Beaumont d’Auty et M. le marquis Henri de Meckenheim présentèrent Charles XI à Léon XIII.[20]
Lorsque le 8 juin 1888 mourut en Hollande l’épouse très respectée de Naundorff, ce n’est pas à Madame Naundorff, et pas seulement à Madame de Bourbon que le pape envoie sa bénédiction in extremis, c’est à « Son Altesse Royale la Duchesse de Normandie » ainsi désignée par ce titre souverain.
Le 8 février 1898, à Lunel, le prince Auguste-Jean, petit-fils de Louis XVII, épousa Fanny-Marie-Magdeleine Cuillé, des Cuillé de La Rocca-Rodente : Léon XIII accorda sa bénédiction aux jeunes époux par son secrétaire Marzolini :
« Prince de Bourbon, Lunel.
Le Saint-Père accorde bénédiction apostolique au prince de Bourbon et à la princesse sa jeune épouse. Signé : Marzolini. »
La Croix du 3 mars 1898 attaqua l’authenticité de la dépêche pontificale. Elle fut obligée de se rétracter le 8 mars, devant les faits, et le fit loyalement.
Les archives s’entrouvrent ? Le Vatican est l’un des centres de l’univers les mieux informés et spécialement sur cette question de la Survivance. A aucun instant le nom « de Bourbon » ne peut y prêter à erreur ou distraction. Et si cette bénédiction ne fut pas, et ne pouvait être une reconnaissance directe, elle marqua tout au moins un acte voulu de considération.
« Altesse Royale », « Prince », « Princesse »… le Vatican et son protocole antique et rigoureux ont-ils coutume de dispenser au hasard ces titres exceptionnels ?
Le Vatican et ses vastes archives pouvaient-ils ignorer le problème dynastique soulevé par le seul nom de Bourbon, et donc le problème politique de si près à l’histoire de la « fille aînée de l’Eglise ? »
Et le pape Léon XIII se serait-il rendu coupable de complicité d’imposture par consécration de la plus retentissante imposture ?
Le 16 août 1899, le Pape Léon XIII reçut en audience privée la princesse Marguerite de La Tour du Pin-Chambly de la Charce, représentant Charles XI de droit. Elle remit au Pape l'acte de Charles XI de la consécration de la famille de Bourbon et de la France aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Dans une audience privée que Sa Sainteté Léon XIII accorda le 16 août 1899, à Mlle de la Tour du Pin, messagère du Prince naundorffiste, qui souhaitait que le pape intervienne en sa faveur, le pape répondit : « Je ne puis. On dirait : le pape est intolérant, donc il est intolérable ! Attendez la rupture du concordat. »
Mais il bénit avec effusion le drapeau du Prince qu’elle avait apporté.[21]
En 1899, le Pape Léon XIII envoya sa bénédiction « in articulo mortis » pour Charles XI.
La qualité de Dauphin fut reconnue par le pape Léon XIII, ainsi qu’il résulte d’un Certificat de Bénédiction Apostolique, en date du 24 avril 1903, où le jeune prince est appelé : « Le Dauphin Henry Charles Louis de Bourbon. »
Mais la bénédiction Pontificale, objectera-t-on sans doute, s’obtient assez facilement ! A cela nous répondons que la qualité de Dauphin, unique au monde, ne se donne pas à quiconque et qu’elle n’a pu être écrite à la légère et sans l’autorisation spéciale du Pape.
Extrait de ce certificat :
« Très Saint-Père,
Le Dauphin Henry-Charles-Louis de Bourbon, humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, Le supplie de vouloir bien accorder à lui et ses proches parents jusqu’au troisième degré la Bénédiction Apostolique et Indulgence Plénière in Articulos mortis, dans la forme usuelle de l’Eglise et prescrite par le Siège Apostolique.
SSmus Pontifex benigne annuit precibus
Dat. Ex Aedibus Vaticanis Die 24 Aprilis 1903
+ Im. Constantine, Archiep. Patrensias »
Le 26 février 1904, la princesse de La Tour du Pin fut reçue cette fois par le Pape Pie X, à qui elle remit le renouvellement de consécration au Sacré-Cœur fait par le prince Jean III de droit [Auguste-Jean-Charles de Bourbon, 1872-1914, petit-fils de Louis XVII].
Dans une seconde audience particulière que Mlle de la Tour du Pin obtint le 21 avril 1904, cette fois devant Pie X, il lui fut dit : « Soyez sûre que je ferai quelque chose pour cette famille. »[22]
Une autre bénédiction fut adressée par le Pape Pie X en 1904, au « Dauphin Henri-Charles-Louis de Bourbon », fils du prince Jean.
Les Pontifes romains ont-ils l'habitude de s'engager moralement à la légère en accordant leur bénédiction à n'importe qui ou à une famille qui tire l'origine de son nom d'un imposteur pour acquérir des honneurs et des avantages qui ne lui sont pas dus ? Peut-on être damné en honorant une telle famille que plusieurs Papes ont eux-mêmes honorée ?
Au mois de février 1906, Mme Maillet, fille du docteur Antoine Martin, (c’est-à-dire petite fille de Martin de Gallardon !) reçue en audience particulière par Sa Sainteté Pie X, obtint la réponse suivante :
« Dites-vous que vous avez le droit pour vous, et le droit triomphe toujours tôt ou tard…
Je vous donne à vous, à ces chers Princes, à tout ce petit groupe dont vous faites partie, en un mot à tous ceux que vous avez dans le cœur, la plus grande bénédiction que le Vicaire de Jésus-Christ puisse donner. Portez-leur mes encouragements et mes espérances ; c’est tout ce que je puis faire à l’heure actuelle. J’ai le cœur meurtri, ulcéré, mais Dieu m’aidera ! »[23]
Témoignage re-confirmé, dans un numéro de Flos Florum de 1938 et de1950 également :
Madame Maillet a publié ses « Souvenirs de Rome » :
« Après la mort de mon cher et vénéré Père, le 6 février 1904, ne l’ayant jamais quitté, partageant sa vie de labeur, en partie consacrée au soulagement des misères humaines, je m’imposai la lourde charge de continuer la tâche ardue qu’il avait entreprise de perpétuer, si je puis m’exprimer ainsi, la mission qu’il avait reçue de son Père, Thomas Martin de Gallardon, de faire connaître la survivance du Roi-Martyr dans la personne de son fils Louis XVII l’évadé du Temple.
Introduction à Rome :
En 1906, profitant du passage à Paris de la princesse Ruspoli, qui était reçue chez une de mes meilleures amies, la Comtesse C. Le Gonidec, boulevard des Invalides, je sollicitai son appui pour, lors du voyage que je désirai entreprendre en mars de la même année, obtenir facilement et d’une façon spéciale mon entrée au Vatican auprès de S. S. Pie X. Non seulement elle accéda à mon désir, mais elle me fît le grand honneur de m’accompagner auprès du Saint Père lors de ma première audience, qui ne fut en réalité qu’une audience de présentation (la première audience obtenue par la Princesse était libellée de cette façon : S. E. la signora Principessa di Poggio Sussa, suo Palazzo, S. Nicola di Valentino). Puis, me continuant sa bienveillance, elle me recommanda chaleureusement à un de ses parents, le Comte Edoardo Soderini, garde noble auprès du S. S.
Audiences de S. S. Pie X.
Encouragée par ces hautes protections, je rendis visite à Mgr Bisletti, majordome de S. S. Ce fut ce haut personnage qui me facilita surtout l’accès fréquent auprès de Pie X en me procurant trois fois par semaine et quelquefois plus, l’insigne honneur d’assister à la Messe du Saint Père dans sa chapelle privée. Ceci dit, et mes audiences se répétant, il me fallait avoir une raison majeure pour les obtenir aussi régulièrement ; ma raison, la voici : dès ma deuxième audience, me présentant à Pie X comme la petite-fille de Thomas Martin de Gallardon, j’abordais de suite la question de la survivance du fils de Louis XVI. Après m’avoir écoutée quelques minutes avec un intérêt très soutenu, le Saint-Père se leva, droit, sérieux, pénétré et, levant les deux doigts de la main droite, il prononça ces paroles : « Ils ont le droit pour eux et le droit triomphe toujours, tôt ou tard. »
M’étant mise à genoux, très émue, lorsqu’il s’était ainsi levé, il me bénit et m’encouragea à continuer ce qu’il appela mon œuvre.
Ceci se passa le 19 mars 1906, le jour de la Saint Joseph, fête du Saint-Père. A l’audience particulière suivante, le Saint-Père, qui savait me recevoir, avait placé bien en vue sur son bureau la photographie du Prince Henry, âgé alors de sept ans, par une attention très délicate et comme pour confirmer ce qu’il avait dit le 19 mars. Il accueillit d’un sourire ineffable mon exclamation ravie à la vue de la photographie ainsi placée. Partie de Paris pour une quinzaine de jours, je restai trente jours à Rome, ne pouvant me résoudre à quitter cette ville où j’avais obtenue tant de grâces.
Cardinal Mery del Val :
Car pendant ces trente jours, j’eus l’insigne honneur d’être reçue en audiences souvent répétées par S. Em. Le Cardinal Mery del Val, Secrétaire d’Etat. Ah ! Je n’ai pas eu à le convaincre sur la légitimité des descendants de Louis XVII ; S. Em., très au courant et très convaincu, me fit ce simple reproche : « Vous ne donnez pas assez de vie à votre Cause ; parlez-en partout, animez-la, suscitez des polémiques, en un mot faites-la vivre ».
« Puis-je faire connaître, Eminence, votre façon de voir à mes amis de Paris ? » « Je vous en prie, je ne m’en cache pas ! »
D’où ma nombreuse correspondance avec le cher Cardinal qui me combla d’insignes faveurs, entre autres en 1915, la Bénédiction du Saint-Père demandée au moment de sa Première Communion pour le Prince Henry de Bourbon, à ce moment-là élève à l’école Bossuet. J’ai la dépêche du Cardinal en ma possession et je vois encore l’émotion de l’abbé Dibildos pour l’obtention de cette bénédiction.
Séjours divers à Rome :
Je continuai mes séjours à Rome pendant les années 1907 et 1908, sollicitant et obtenant les mêmes faveurs de Pie X, du Cardinal Mery del Val, de Mgr Bisletti que j’eus le très grand plaisir de revoir, malheureusement pour la dernière fois, en 1933 lors du Jubilé.
Je fus le trouver à son Palais du Belvédère et il me rappelait malicieusement mes nombreuses demandes de messes et d’audiences, car, à chacune de mes visites, je lui disais : « C’est la dernière fois, Monseigneur, que je viens solliciter ma messe du Saint-Père, je compte partir demain pour Paris. » Il hochait la tête, en me disant : « Je suis persuadé que demain vous montrerez au Vatican solliciter les mêmes faveurs. » Et c’était vrai ; c’était toujours le cœur gros que je quittai Rome.
En 1907, dans une audience qui restera mémorable, j’offris au Saint-Père la vie de mon grand-père, Thomas Martin de Gallardon, que j’avais fait relier en chagrin blanc, orné des armoiries du Saint Père. Au moment où je lui présentais le livre, le Saint Père tendit la main et la plaça serré sur sa poitrine par le bras gauche. Timidement, je lui dis : « T. S. Père, je ne vous demande pas de le lire en entier, mais d’en prendre un aperçu. » Alors je vis son geste qui m’alla droit au cœur le pressant plus fortement sur sa poitrine ; le Saint Père dit avec ce sourire angélique qu’il avait : « Je le lirai tout entier. » Très émue, je m’agenouillai pour recevoir sa bénédiction.
En 1908, renouvelant mes visites au Vatican, en février et mars, pour la première fois mon mari m’y accompagnait. J’avais prié Mgr Bisletti de vouloir bien présenter lui-même, le lendemain, mon mari à Sa Sainteté. Monseigneur le fit très amicalement puis il nous quitta, se rendant à une cérémonie hors du Vatican.
Le Saint-Père se montra si bon, nous encourageant d’une façon si pressante à continuer notre œuvre en ce qui concernait la Survivance, que mon mari en fut touché jusqu’aux larmes. L’audience dura près de vingt minutes. Nous nous dirigions vers une salle où le Pape donnait une audience publique, lorsque, tout à coup, me retournant pour essayer de voir encore le Saint Père, je vis venir à nous assez rapidement un jeune Monseigneur, dépêché par Pie X, qui nous demanda de la part du Saint Père si nous avions été contents de l’audience. On juge de notre surprise et de notre émoi. Nous lui affirmâmes notre reconnaissance d’avoir été si bien reçus et de la confiance que nous avait montrée le Saint Père dans les trop courts instants qu’Il nous avait accordés, nous étions émus au point que Pie X passant près de nous pour se rendre à son audience publique, nous en oubliâmes de nous mettre à genoux sur son passage.
Cardinal Bisletti.
En 1933, lors d’une de mes visites au Cardinal Bisletti, après avoir rappelé nos souvenirs anciens et mes exigences pour mes audiences, le cher Cardinal se souvenant à quel point je vénérais Pie X me dit : « J’ai un portrait de Pie X que nul ne connaît et qui m’a été offert par S. S. ; vous êtes une des rares, à part ma famille, qui le connaîtrez », et nous conduisant dans sa chambre, il nous fit admirer ce portrait, véritable chef-d’œuvre, montrant Pie X avec une expression de rayonnement et de sainteté sur le visage, ignorée certainement de tout le monde, puisque je n’en ai jamais vu une reproduction, le cardinal Bisletti le gardant jalousement.
Cardinal Ferrata
Le Cardinal Ferrata, ancien Nonce à Paris, me recevait toujours avec empressement. En sa qualité de Nonce, me disait-il, il avait reçu à la Nomenclature la visite de tous les prétendants de plus ou moins bon aloi. « Il n’y en a qu’un qui ait retenu mon attention, c’est le descendant direct de vos Rois de France, le continuateur de la légitimité, votre Prince Jean de Bourbon. Ah ! Sur celui-là je n’ai eu aucun doute. D’ailleurs, je suis un partisan fervent de l’évasion et de la descendance de Louis XVI. Je ne leur ai pas dissimulé à chacun ma façon de voir. D’ailleurs, ils n’insistaient pas.
Voici en toute sincérité, sur ma part de paradis, mes souvenirs exacts de mes visites à Rome que de tout cœur j’autorise la Revue Flos Florum à publier, ce qui, jusqu’alors n’avait pas été fait.
L. Maillet. »
Paru dans Flos Florum en 1938, republié dans le n°3 du mois de juillet 1950 de la revue Flos Florum, pages 5 à 8.
On pourra nous objecter que cette narration ne repose sur aucun document écrit ; la bonne foi et la dignité de vie de l’auteur du récit valent des preuves écrites. Elle a recueilli elle-même des lèvres augustes et sacrées les paroles qu’elle relate.
Madame Maillet est morte en 1946. Que l’on ne prenne pas pour vision de vieille femme son récit. M. le baron de Genièvre l’a entendu de sa bouche, a eu en mains des lettres prouvant les contacts qu’elle eût avec Mgr Bisletti, les cardinaux Merry del Val, Ferrata et autres personnalités religieuses.[24]
Conclusion : Bienveillance et silence de la part du Vatican. Toujours la Sagesse et la Prudence.
En 1915, le pape Benoît XV adressait sa bénédiction au « Prince Henri de Bourbon », alors élève au lycée Bossuet.
Robert Ambelain écrit : [25]
« En 1923, le prince Louis-Charles-Jean-Philippe de Bourbon, petit-fils de Naundorff, fit solliciter du pape Pie XI la faveur d’une réception ès qualités. Le R. P. Genocchi, missionnaire apostolique du Sacré-Cœur, confesseur du pape Pie XI, se chargea inconditionnellement de soumettre la demande du prince, et la demande d’audience fut accordée sans aucune difficulté. Le prince se rendit alors à Rome et fut reçu le 28 novembre 1923 en audience privée, dans la salle du Tronetto, par le pape Pie XI. On retrouvera le compte rendu de cette audience dans divers journaux italiens : Il Piccolo des 29-30 novembre 1923, l’Ambrosiano du 30 novembre 1923, le Corriere Italiano et La Tribuna Illustrata des 9-16 décembre 1923, etc.
Des années passèrent encore, et ce fut à Jean XXIII, alors simple nonce apostolique sous le nom de Mgr Roncalli de 1944 à 1953 à Paris, à attester avec finesse ce qu’il savait sur la survivance.
Recevant un jour en la cathédrale Notre-Dame le prince René de Bourbon, il le qualifia à chaque fois au cours de cet entretien d’Altesse Royale. Par la suite, devenu pape, il le reçut à Rome en audience privée, et la lettre d’invitation fut adressée à « Son Altesse Royale le prince de Bourbon ». Le journaliste suisse Willy Aeschlimann en témoigna en ses Notes historiques, ayant vu cette lettre.
A cet entretien à Notre-Dame, René de Bourbon se présenta avec deux amis, en accord avec Mgr Roncalli. Dès l’entrée en matière, le prince déclara : « Je suppose, Monseigneur, que Votre Eminence ne peut rien nous communiquer sur ce que possède le Vatican quant à la survivance de notre aïeul Louis XVII ?... »
A cette question, probablement mise au point d’avance, Mgr Roncalli répondit simplement, en joignant les mains selon son habitude sur son abdomen : « Comme Votre Altesse Royale est perspicace… Elle a deviné ma réponse ! En effet, je ne puis rien lui dire sur ce sujet. »
Cet entretien me fut rapporté par mon regretté ami Henry Buisson, fonctionnaire aux Affaires étrangères à l’époque. On notera la subtilité très vaticane de celui qui allait devenir le grand pape Jean XXIII ; en donnant à son interlocuteur le titre d’Altesse Royale, il répondait par une confirmation implicite à la question ! »
La consécration faite par Charles XI a été renouvelée par chacun des chefs de famille (branche aînée) : le prince Jean en 1900, le prince Henri en 1914, et enfin celle faite par Charles-Louis-Edmond de Bourbon.
Voici le renouvellement de la Consécration au Sacré Cœur de Jésus le 21 janvier 1987 à Saint-Nicolas du Chardonnet, en présence de Mgr Ducault-Bourget, par Charles-Louis-Edmond de Bourbon :
« Nous, Charles-Louis-Edmond de Bourbon renouvelons solennellement en ce jour la consécration de notre famille et de la France au Divin Cœur de Jésus, comme l’ont fait nos prédécesseurs, descendants de Louis XVII. »
III] Louis XVII et les prophéties
Les anti-naundorffistes ne se sont pas fait faute de reprocher aux partisans de Louis XVII de rechercher leurs adeptes parmi les fidèles du merveilleux et les mystiques.
La cause de Louis XVII a été mêlée à ces questions du vivant même de Louis XVII-Naundorff avec l’affaire de la Doctrine Céleste, puis avec la troublante mission de Martin de Gallardon. Plus tard vinrent les affaires de la Salette, Loigny, etc. Les naundorffistes ont dû, malgré leur réserve, parler de ces faits qui ont leur importance, car, quoiqu’on dise et sans préjuger de rien, il n’est pas indifférent que l’on fixe, pour l’histoire, qu’un paysan de Gallardon soit allé dire à Louis XVIII qu’il n’était pas à sa place ou qu’un pâtre des Alpes ait voulu parler au Comte de Chambord pour lui dire à peu près la même chose.
Comme l’écrivait le marquis de La Vauzelle, écrivain naundorffiste providentialiste :
« Je veux le Roi par Dieu, et non pas Dieu par le Roi au choix exclusif des hommes. Je soupire après le Grand Monarque annoncé par tant de prophéties. »[26]
L'annonce d'événements futurs par les prophètes, comme tous et chacun le savent, remonte au tout début de la création de l'univers. Durant toutes les périodes troubles de l'histoire de l'humanité, Dieu a suscité chez les peuples des prophètes ou de grands visionnaires qui ont joué un rôle prédominant dans l'histoire de l'humanité. L'histoire Sainte (l'Ancien Testament), de même que le Nouveau Testament, en contient tous deux une multitude d'exemples.
Si les Juifs avaient bien étudié les prophéties, ils auraient reconnu le Messie et ne l'auraient jamais crucifié.
Le terme de « prophétie » fait hausser les épaules à notre époque rationaliste et sceptique. Les prophéties de l’Ancien Testament ne peuvent pas être récusés, mais les voyants de nos jours sont traités d’exaltés, d’illuminés, de fous, etc.
Cependant, le prophète Amos nous affirme qu’il y en aura toujours quand il dit au chapitre III, v. 6 et 7 :
« La trompette sonnera-t-elle dans la ville sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Y arrivera-t-il quelque mal qui ne vienne pas du Seigneur ? Car le Seigneur notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé auparavant son secret aux prophètes ses serviteurs. »
Un monsieur hostile au secret de la Salette et au surnaturel à qui je citais ce passage d’Amos me répliqua gravement : « Les prophètes de l’Ancien Testament n’ont jamais prophétisé pour les siècles après Jésus-Christ. C’est l’enseignement de l’Eglise. »
Je réponds par le passage ci-après de l’Ecclésiastique, chapitre XLIII, 26, 27, 28 :
« Isaïe fut un grand prophète : il vit par un don de l’Esprit de Dieu ce qui devait arriver dans les derniers temps : et il consola ceux qui dans la suite devaient être affligés dans Sion. Il prédit ce qui devait arriver jusqu’à la fin des siècles, et il découvrit des choses secrètes avant qu’elles n’arrivassent. »
Voilà un prophète de l’Ancien testament qui a prophétisé des évènements « qui devaient arriver jusqu’à la fin des siècles. »
En cherchant bien on en trouverait d’autres.
Donc il y a eu des prophètes qui ont prédit pour tous les temps.
Doc il y en aura toujours.
Donc il y en a de nos jours. [27]
On a tant abusé des prophéties, surtout dans ces derniers temps, qu'il semble qu'on ne puisse plus prononcer ce mot sans exciter le sourire. Cependant l'Esprit-Saint nous dit : Ne méprisez pas les prophéties, examinez-les attentivement, afin de discerner les véritables. Prophetias nolite spernere, omnia probate: quod bonum est tenete. (I Thom. XX, 21). Il ne faut donc pas croire toutes les prophéties, de même qu'il ne faut pas les rejeter toutes ; pas de crédulité exagérée et sans fondement d'une part ; pas de négation systématique de l'autre. Le démon, qui est le singe de Dieu, peut nous tromper par de fausses prophéties, comme il trompe par de faux miracles.
Qu'on ne méprise donc pas les prophéties.
Conformément aux décrets d’Urbain VIII, nous déclarons nous soumettre au jugement de la sainte Eglise et ne vouloir en rien prévenir ses décisions, lorsque nous relatons des prophéties privées ou des faits extraordinaires, sur lesquels elle ne s’est pas prononcée. Nous entendons ne les donner qu’à titre documentaire ou d’information.
Prophétie de Jean de Vatiguerro, dite de Saint-Césaire, archevêque d’Arles, en 468. Extrait du Liber Mirabilis de 1524, déposé à la BNF et dont l’édition remonte aux premiers temps de l’imprimerie :
« Le Lis (Louis XVII) sera privé de sa noble couronne ; on l’en dépouillera et on la donnera à un autre (Louis XVIII), à qui elle n’appartient pas, et il sera humilié jusqu’à la confusion (Louis XVII traqué par tous les gouvernements et dépouillé même de son nom.) »
Prophétie de St Catalde, évêque de Tarente (Elle est très ancienne ; David Pareus la cite dans son commentaire de l'Apocalypse imprimé à Heidelberg en 1618) :
« … Un roi sortira de l’extraction et tige du lys très illustre, ayant le front élevé, les sourcils hauts, les yeux longs et le nez aquilin… »
Prophétie du Père Calliste, religieux de Cluny (XVIIème siècle)
Cette prophétie date du 3 décembre 1750, trois jours avant la mort du Père Calliste. Elle a été annoncée, au milieu du plus profond silence, à la fin de la messe, dans l'étonnement et la consternation de tous les assistants. Le texte de la prophétie du Père Calixte est conservé grâce à la lettre, datée du 3 décembre 1751, adressée par un religieux de Cluny, Dom Madrigas, au Prieur de l'Abbaye de Moutier-Saint-Jean-en-Auxois en Bourgogne.
Après une peinture rapide de la Terreur, le prophète tient ce langage d’une précision qui terrifie :
« Trois fleurs de Lys de la couronne royale tomberont dans le sang (Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Elisabeth) ; une autre tombera dans la fange (le duc d’Orléans), une cinquième sera éclipsé (Louis XVII)… »[28]
Le Père Nectou, au XVIIIe siècle, mort bien avant la Révolution, avait annoncé que l’Enfant du Temple ne périrait pas et que sa postérité assurerait le triomphe de l’Eglise « tel qu’il n’y en aura jamais eu de semblable ».[29]
Martin de
Gallardon
Voir le chapitre qui lui est consacré, page 37.
Voici les évènements prédits par M. le curé de Maumusson, l’abbé Mathurin Souffrand en 1817 :
« La venue du grand Monarque sera très proche, lorsque le nombre des légitimistes restés fidèles sera tellement petit, qu’à vrai dire on les comptera.
Ce grand Monarque est de la branche aînée des Bourbons. Je suis portée à croire que c’est Louis XVII, parce que je vois un rameau d’une branche coupée. Avant ce grand Monarque, des heurs terribles devront fondre sur la France… »
Sa conviction profonde de la survivance du Dauphin évadé du Temple lui fit écrire deux lettres, l’une à Napoléon Ier, et l’autre à Louis XVIII, pour leur reprocher leur usurpation. De là les colères et les gendarmes.
Il écrit également, le 25 février 1820 :
« Le Grand Monarque sera un Bourbon. On croira la race du grand Louis XVI entièrement éteinte. Point du tout !... Un duc ! (Le duc de Normandie ou l’un de ses héritiers) … Il faut garder ici le silence. L’évènement prouvera la vérité. »[30]
Prophétie de la religieuse trappistine Notre-Dame des Gardes, en Anjou, morte vers 1828 :
Le dimanche de la Toussaint, 1816 : « Dans ce moment, je vis un jeune homme qui me parut avoir environ 33 ans. Il était d’une beauté ravissante et d’un port qui annonçait quelque chose de grand et de majestueux. En même temps, la voix me dit : « Voilà celui que je garde de tous les périls pour le bonheur de la France. » J’entendis qu’il portait les deux noms de Louis-Charles. Il fut sauvé de la Tour du Temple et conduit en Espagne, et de là en Sicile où il fut enseigné par les Jésuites (sécularisés). En 1801, il rentra en France où il fut arrêté et mis en prison. Il s’en échappa, parce que Dieu le protège et le conserve pour notre bonheur. Il ne rentrera en France qu’après le grand combat. »
La petite Marie des Terreaux ou des Brotteaux, servante de Lyon (1773-1843).
C’est de 1811 à 1832 qu’elle fut favorisée de nombreuses visions prophétiques. Poursuivie par la police à la suite de la révolution de 1830, l’humble servante dut se cacher.
La petite Marie des Terreaux, au moment où elle était poursuivie par la police de Louis-Philippe, après la révolution de 1830, eut la vision d’un drapeau blanc, sur lequel se trouvaient, vers le milieu, 6 fleurs de lys, et, dans un coin, une autre plus petite et isolée. Elle demanda ce que signifiait cette petite fleur de lys toute seule. Il lui fut répondu : c’est le duc de normandie. _ Mais je ne sais pas ce que c’est, répliqua-t-elle. _ Eh bien, on te l’apprendra, ajoute la voix céleste ; et la vision disparut.[31]
Prophétie de la bergère Marianne Galtier de Saint-Affrique (1830) :
« Un prince connu de Dieu seul, et faisant pénitence au désert, arrivera comme par miracle. Il sera du sang de la vieille cap. Il s’appellera Louis-Charles.
Il ne régnera qu’un an, et il cédera la couronne à un prince qui n’a pas de descendant. »
Mlle Lenormand (Née à Alençon en 1772. Morte le 25 juin 1843). En 1842, elle écrivit un certain nombre de prédiction :
« O Lis qu’on a brisé, mais qu’on n’a pu arracher, tes blanches fleurs de nouveau vont éclore. Les suaves parfums de tes symboliques corolles arrivent jusqu’à moi. Autour de ta tige veillent des amis fidèles et dévoués. Ils attendent un cri que doit pousser ton peuple, et alors tu remonteras sur le trône de tes aïeux. »
Prophétie du Père Eugène Pegghi, moine cistercien mort à Rome au monastère de Sainte-Croix en 1855 :
« … Il y aura une grande stupeur quand on apprendra qu’il y a dans Paris un roi inconnu, et qui demeure au milieu du peuple. Et qu’on verra placé sur le trône un premier janvier le dernier de cette époque… »[32]
Marie Lataste
Religieuse française (1822-1847). Sur ordre de son directeur spirituel, elle écrit ses mémoires, qui furent publiées en même temps que son journal et sa correspondance, en 1862. Ses locutions ne sont pas sans rappeler les célèbres « Dialogues » de sainte Catherine de Sienne.
Elle a écrit, le 20 novembre 1843, à son directeur spirituel :
« Oui, ma fille, au souffle qui sortira de ma bouche – (C’est Notre-Seigneur qui parle) – les hommes, leurs pensées, leurs projets, leurs travaux disparaîtront comme la fumée au vent.
Ce qui a été pris sera rejeté.
(Ecrit en 1843, cela se rapporte à Louis-Philippe).
Ce qui a été rejeté sera pris de nouveau.
(Louis XVI a été rejeté ; Louis XVII aussi.)
Ce qui a été aimé et estimé sera détesté et méprisé.
(Les Orléans).
Ce qui a été méprisé et détesté sera de nouveau estimé et aimé.
(Les enfants et les petits-enfants de Louis XVII).
Quelquefois un vieil arbre est coupé dans une forêt.
(Louis XVI).
Mais un rejeton.
(Louis XVII)
Pousse au printemps et les années le développent et le font grandir.
(Un membre de la Survivance)
Il devient lui-même l’honneur de la forêt.
(Le Grand Monarque.) »[33]
Mme de Meylian
Le Baron de Novaye écrit dans son livre Demain ?[34], page 260 :
« Le R. P. Parent, missionnaire apostolique à Nantes, nous a communiqué le document qui va suivre. On n’en connait pas l’auteur. On ne sait pas à quelle date il a été composé. Nous ne pouvons que certifier, d’après les attestations fort sérieuses que nous a fournies ce religieux, que cette prophétie telle que nous la reproduisons, vient de Mme de Meylian, fondatrice et supérieure de l’Immaculée-Conception à Rome.
Elle possédait, depuis 1848, ce texte qu’elle a donnée à Madame Amélie de Bourbon, et c’est de cette princesse qu’il nous est parvenu par l’entremise d’un de ses partisans qui l’a communiqué au P. Parent. Nous sommes sûrs, par conséquent, qu’elle est au moins antérieure à 1848, et comme elle prend les faits à peu près à cette époque, elle n’a certainement pas été faite après coup.
Extrait :
« 1_ La France sera toujours en révolution tant que son roi légitime ne la gouvernera pas.
2_ Il portera une couronne et doit être sacré.
3_ Grande erreur des légitimistes à regarder comme roi tout autre que Louis XVII et ses descendants.
4 _Ils tomberont d’imposteurs à insensés et d’insensés en tyrans.
[…]
23_ L’annonce des vrais descendants des Lys par des voix étouffées.[35]
24_ A ce moment le nombre de vrais légitimistes sera tellement petit qu’il pourrait tenir dans une chambre de 25 pieds carrés. »
Cette prophétie était écrite en latin sur un parchemin, découvert dans le cercueil d’un saint religieux. Ces détails viennent des papiers de la princesse Jeanne, épouse de Mgr Jean de Bourbon.
Le Curé d’Ars
En 1846, le fils de M. Martin de Gallardon, le docteur Antoine Martin, passant par Lyon pour se rendre à Rome puis à Jérusalem, voulut d’abord aller voir l’abbé Vianney. Chose remarquable, le saint prêtre chercha le jeune voyageur au milieu de 4 à 500 personnes, le prit par la main et lui parla ainsi : « Nous avons beaucoup de choses à nous dire ; vous me servirez la messe pendant 10 jours. »
Heureux de se trouver avec un si saint personnage, le fils de Martin lui promit tout ce qu’il voulut et renonça au voyage projeté à Jérusalem, parce que le vénéré curé lui dit : « Vous avez l’intention d’aller à Jérusalem, c’est trop tôt ; si vous devez y aller, vous irez plus tard ; allez d’abord à Rome… »
Voici un document issus des Archives Nationales, extraits des Carnets Louis XVII de Janvier 1998, n°13 :
Lettre de l'abbé Delcros à Pierre Champion (directeur de la Légitimité).
A.N.
227 AP 14 Dr 130 S.C.I
« 23 sept. 1897
Monsieur le Directeur de la Légitimité,
Ma mère, femme d'un grand sens, d'une mémoire solide, m'avait souvent entretenu de faits ayant trait à l'histoire de la Révolution, et à la cause monarchique. En raison de son commerce, ma mère allait souvent à Lyon, et de là à Ars.
Un jour, prosternée dans l'Eglise, elle vit Monseigneur le Comte de Chambord et son épouse. Le prince sortait d'un long entretien avec le Saint Curé ; il priait avec ardeur, mais il était dans une telle agitation extérieure, que ma mère s'avança et lui dit : « Monsieur, convertissez-vous et écoutez votre femme ».
La comtesse s'était penchée à l'oreille de Monseigneur, et essayait de le calmer. Le comte lança un regard terrible à ma mère ; il demeura longtemps dans la lutte douloureuse première.
Ma mère a
bien reconnu les augustes visiteurs qu'elle avait pris de loin pour
des étrangers.
Le soir à l'hôtel, on parlait du Comte de Chambord et on disait qu'il n'était pas content du
curé. Celui-ci aurait dit qu'il ne règnerait pas.
Napoléon, Président, avait connu du Curé d'Ars qu'il tomberait après une guerre.
Ma mère a beaucoup connu un nommé Charbonnier, séide de la Révolution. Il déclarait au foyer de mon grand-père Bruaire, boulanger, qu'il avait fait échouer, au Temple, un plan d'évasion de la famille royale ; il était convaincu que le Dauphin était sorti. Ce Charbonnier est mort à Craponne, Haute Loire, à l'hôpital. Il possédait des couvertures fleur de lysées, un étui de Marie Antoinette et des objets précieux que personne ne voulait acheter.
Mon grand père disait souvent que, contraint de faire la guerre aux Vendéens, il avait entendu dire, dans les rangs, que Louis XVII était venu dans l'armée royale, qu'il n'était pas mort au Temple.
Ma mère me racontait aussi qu'à Lyon, sous le règne du duc d'Orléans, un curé de la Croix-Rousse soutenait avec énergie l'existence de Louis XVII, malgré les misères que l'archevêché lui suscitait sur cette question.
Ma mère était très convaincue de la réalité de Louis XVII en Naundorff. Je lui dois, moi qui avais été trompé par la fausse éducation historique des séminaires et des collèges, d'avoir cherché à m'éclairer. Je suis convaincu qu'un esprit sérieux et indépendant ne peut se refuser à tant de preuves.
Abbé Louis Delcros, ancien professeur d'histoire. »[36]
Les voyants de La Salette Mélanie Calvat et Maximin Giraud.
Voir le chapitre spécial consacré à eux, pages 64 à 76.
Saint Jean Bosco
La Légitimité faisait souvent de la publicité pour les œuvres de Don Bosco, dont la lettre ci-dessous nous révèle qu’il était naundorffiste.
Lettre de Saint Jean Bosco au Marquis de Meckenheim (qui remplit auprès de Charles XI de droit, la charge de secrétaire chancelier) :[37]
« Cher Monsieur le Marquis,
J’ai reçu régulièrement vos lettres et vos mémoires de la grande question (Naundorff) qui nous occupe en ces jours. Je n’ai pas négligé de recommander la chose aux personnes qui ont relation avec nous et qui puissent avoir quelque influence.
Plus encore : j’ai prié, et nos enfants continuent tous les jours leurs prières à Notre-Dame auxiliatrice selon votre intention.
Toutes les choses que la divine providence me fera connaître, je vous le dirai promptement.
Mais, notez, cher Marquis, les temps sont mauvais et avec difficultés la justice triomphera humainement parlant, sans l’intervention de la main du Bon Dieu. Prions.
Je recommande humblement nos orphelins (150 mille) qui se trouvent vraiment dans la misère.
Que Dieu bénisse, vous, votre famille, vos bonnes intentions et veuillez aussi prier pour moi, qui, à jamais, en notre Seigneur Jésus-Christ avec gratitude…
Votre humble serviteur : Abbé J. Bosco. Turin, le 1er mars 1883. »
A la fin de l'année 1882 et jusqu'en septembre 1883 la Vierge Marie est apparue 19 fois à une jeune fille habitant le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, Anne-Marie Coste, dit « Annette Coste », qui devint par la suite soeur Marie de l'Eucharistie.
Sous les traits de Notre Dame de Fourvière, la Vierge Marie est apparue avec l'Enfant-Jésus dans ses bras tenant un globe surmonté d'une Croix brisée. Elle confia à la jeune fille quelques révélations ou prédictions. Elle parla de châtiments à propos de la mauvaise conduite de la France : « Il y aura bientôt de grandes inondations mais, une fois encore Je préserverai Lyon, cette ville que j'aime, du courroux de mon Fils. Ce sera la dernière fois si on ne se convertit pas, et je serai forcée de laisser aller le bras de mon Fils ».
Comme il fut dit, des inondations se produisirent ; de nombreux fleuves débordèrent, mais, même si la Saône et le Rhône gonflèrent exagérément, Lyon, ne fut pas touché par les crues.
La Mère de Dieu a mis l'accent aussi sur son chagrin : « Je suis une Mère abandonnée ! La cause de mon chagrin, c'est l'ingratitude de mon peuple. J'ai bien de la peine à retenir le bras de mon Fils... II faut que mon peuple se convertisse, qu'il fasse des pénitences et qu'il prie avec plus de ferveur. Vous ferez faire des neuvaines dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés, en récitant neuf Pater, neuf Ave Maria avec neuf fois les invocations : « Mère abandonnée, priez pour nous. Mère affligée par des coeurs ingrats, priez pour nous. »
La guérison d'Anne-Marie, malade, suivie d'autres miracles de guérisons attestèrent de la véracité des faits.
Pourquoi le Christ est-il apparu tenant dans ses mains une croix brisée ? Peut-être pour confirmer les dires de sa Mère à la Salette en 1879 : «...On a négligé le devoir de la prière et, de la pénitence ; on a jeté par tombereaux les crucifix des prétoires et des écoles...»
Un groupe de Naundorffiste dont l’abbé Dupuy, y allaient souvent prier. Elle avait fait des prédictions favorables à la thèse de la survivance.
Joséphine Reverdy, de Bouilleret
Apparition du 8 septembre 1883[38] :
« La Sainte Vierge fit voir un personnage à Joséphine, dont elle remarqua bien les traits. Elle dit tout haut en répétant les paroles de la Sainte Vierge : « Dieu est tout-puissant ; il vient frapper la France par la mort du Comte de Chambord : mais la France ne sera pas perdue pour cela : il viendra un sauveur qui le remplacera. » Aussitôt un spectacle merveilleux se déroule aux regards de la voyante. Elle voit un Pape, qui n’était pas Léon XIII, la tiare en tête, et revêtu de ses ornements pontificaux, s’approcher du personnage qu’elle avait remarqué et le sacrer roi. Auprès de ce nouveau monarque était une splendide corbeille de lis blancs, très hauts et un drapeau blanc fleurdelisé. En même temps, la Sainte Vierge dit à la voyante ces paroles, qu’elle lui fait répéter tout haut devant tous les assistants : « Voilà le digne successeur d’Henri V, c’est celui-là qui sauvera la France, il est héritier des sentiments de Jésus-Christ. »
Apparition du 8 décembre 1883 :
« Après l’apparition du 8 septembre, une dame venue de Paris, désirant connaître l’identité du personnage que Joséphine, dans son extase, avait vu sacrer roi par un nouveau Pape, lui présenta la photographie du Prince Louis-Charles de Bourbon, fils aîné de Louis XVII.
Joséphine fut frappée de la ressemblance de cette photographie avec le personnage qui lui avait été montré en vision. Néanmoins, elle n’osait encore se prononcer formellement sur son identité. Mais la Sainte Vierge se plut à lever tout doute dans son apparition du 8 décembre. Ici laissons la parole à un témoin oculaire des faits et dont nous taisons le nom pour le moment :
« Le jour de la fête de l’Immaculée-Conception, à 1h30 du soir, beaucoup de personnes sont venues prier et réciter le chapelet de Notre-Dame des Septs-Douleurs, dans la chambre de Joséphine. Elles étaient au nombre de 27. Parmi elles se trouvait cette dame de Paris qui avait présenté à Joséphine la photographie du fils aînée de Louis XVII. […] A ce moment, la voyante aperçoit un tableau merveilleux. D’un côté était Notre-Seigneur-Jésus-Christ se tenant debout devant la Croix ; sa figure était empreinte de tristesse ; Il était couronné d’épines et avait sur sa poitrine son Sacré-Cœur ouvert. De l’autre côté se trouvait le roi qui lui avait été montré en vision, le 8 septembre ; derrière le roi était une belle corbeille de lis qu’ombrageait un drapeau blanc fleurdelisé.
La Sainte Vierge alors adresse à la voyante quelques paroles qu’elle ne répète pas. Mais aussitôt les assistants la voient prendre dans sa poche la photographie du prince Louis-Charles de Bourbon, fils aîné de Louis XVII, connu sous le faux nom de Naundorff, photographie que la dame parisienne lui avait glissée dans la poche, à son insu.
Joséphine, fixant la personne du roi que la Sainte Vierge lui faisait voir et puis la photographie qu’elle tenait dans ses mains, se met à dire tout haut, en souriant : « Oui, ma bonne Mère, c’est bien lui ! » Elle regarde une deuxième fois le roi et sa photographie, et répète d’une voix encore plus forte et en souriant toujours : « Oui, ma bonne Mère, c’est bien lui ! »
La Sainte Vierge adresse encore à Joséphine des paroles qu’elle seule entend, et répond : « Mon confesseur me défend de parler. » Aussitôt, sur l’ordre que lui en donne la Sainte Vierge, Joséphine présente la photographie à toute l’assistance et dit d’une voix très forte : « Voilà celui qui doit monter sur le trône. Il est le digne successeur d’Henri V, et héritier des sentiments de Jésus-Christ ; et bientôt on ne dira plus : à bas les ministres de Jésus-Christ ! – C’est celui-là qui sauvera la France. »
C’était la Sainte Vierge elle-même qui prononçait ces paroles, et la voyante les répétait après elle. »
Marie-Louise de Diémoz (Isère) est une voyante, stigmatisée, qui a annoncé aussi Louis-Charles de Bourbon, fils de Louis XVII, comme roi de France et son sauveur, sous le nom de Charles XI.[39]
Mme Boitet de Lyon, est une voyante, extatique, acquise à la cause naundorffiste. Elle n’est pas une « voyante spirite », comme un anti-naundorffiste la qualifiait. Elle témoignait habituellement son affection pour Charles XI.
Mme Boitet, « qu’estimait et dirigeait le curé d’Ars, a l’estime de tous ceux qui la connaissent, est admise à la communion fréquente, obéit scrupuleusement à son directeur, que nous connaissons et qui nous l’a déclaré.
Est-elle dans la vérité ou l’illusion ? Ceci n’est pas de notre domaine : à ses directeurs le soin de trancher la question. »[40]
Une voyante de la fin du XIXe siècle.
Extrait du livre de Michel de Savigny : La perspective des grands événements[41], au chapitre concernant le Grand Monarque, pages 309-310 :
« Une prophétie attribuée à une voyante, qui fut un moment célèbre à Paris, à la fin du XIXe siècle, va jusqu’à affirmer que les droits du véritable prétendant seront reconnus officiellement.
Elle dit :
Un papier est resté,
Il est à l’étranger,
Il vous sera montré
Comme preuve d’identité.
Certains affirment que des documents officiels, reconnaissant la légitimité de Naundorff, se trouveraient en Allemagne et seraient produits au moment de l’avènement de l’Elu de Dieu ! C’est ce que suggérait d’ailleurs la voyante dans son texte. Par ailleurs, elle termine en disant :
Je vois la France accepter,
Quand elle aura peiné,
Celui qui est l’héritier.
En 1909, la revue Diex el volt[42], par la plume de M. Henri Lainé, a publié des révélations qui ont été faites à une femme illettrée du nom de Marie-Joseph Lavadoux, décédée en 1909.
Ci-dessous un extrait des révélations de Marie-Joseph[43] :
« Si l’Ayant-droit[44] ne répondait pas à l’appel de Dieu dans le bien qu’Il veut faire, il pourrait se faire que Dieu le mette de côté, comme Il a fait de Charles XI, lorsqu’Il m’a fait lui écrire la lettre de janvier 1886, l’avertissant qu’il n’arriverait pas au trône s’il mettait en jeu les moyens humains.
Et c’est par la suite de ses résistances que Dieu l’a mis de côté. »
Pourtant Charles XI a consacré la France au Cœur du Christ-Roi, avec son drapeau, ses armes, sa famille, sa personne, dès 1883 en la Basilique de Montmartre.
En fait, jusqu’à sa mort, Marie-Joseph a toujours vu les princes naundorffistes appelés, mais sous l’expresse réserve qu’ils se constitueraient le « lieutenant du Christ ».
Louis XVI, dans une apparition consignée dans le dossier constitué en vue de sa Cause de Canonisation, disait :
« Plusieurs se sont assis sur mon trône et y ont trouvé leur perte. Tout ce qui aura survécu s’assemblera un jour autour de la place où mon sang a coulé (la Place de la Concorde à Paris) ; au milieu d’eux paraîtra celui qu’on croit mort à cause du vêtement et de la nuée qui le couvrent. C’est lui qui doit tenir mon sceptre en sa main ; il est l’aîné après moi. »[45]
Jules de Vuyst (1933-1952)
« Cette femme a fui avec l’enfant (Louis XVII), elle est entourée d’anges et elle est éclairée par la divine Providence. Cet enfant était un enfant de roi qui était perdu et qui a été plusieurs fois sauvé dans sa vie par cette femme. Plus tard, de la descendance de cet enfant sortira un grand Roi qui viendra apporter le bonheur en France. Il vivra saintement et s’appellera lui-même le roi du Sacré-Cœur. »[46]
Il faut apparemment rajouter à cette liste d’autres personnes.
Le Marquis de La Franquerie, qui affirme qu’il a « relevé seize prophéties sérieuses, contemporaines, qui affirment que le Grand Monarque descendra de Louis XVII », nous parle de Mère Saint Dominique à Paris[47], d’une certaine Marie-Françoise Decotterd en suisse et « d’une religieuse de Lyon et trois âmes contemporaines dont on ne peut présentement encore citer les noms. »[48]
Rajoutons enfin que le Padre Pio, dont les capacités psychiques étaient très développées, a vu, en état de bilocation, le testament de la duchesse d’Angoulême, détenue au Vatican, document « d’une importance capitale pour la France, l’Europe et le monde. »
Et Nostradamus, diront certains ?
Certains auteurs survivantistes utilisent les prophéties de Nostradamus. En effet, il semble que Nostradamus annonce que le fils de Louis XVII ne mourra pas au Temple :
« Le règne prins le roi convicra.
La dame prinse à mort jurès à sort.
La vie à royne fils on desniera. »
Traduction :
« Le roi pris, le gouvernement le déclarera convaincu et le condamnera ; des jures prononceront la peine de mort contre la Reine ; quant au petit roi, on se contentera de nier qu’il existe. »
Cependant, pour notre part, nous nous abstenons d’utiliser les prophéties de Nostradamus.
En effet, Nostradamus est un astrologue cabaliste. En ses deux premiers quatrains, il nous révèle clairement que c’est par le moyen de la Magie et de l’Astrologie qu’il pouvait prophétiser sur certaines époques précises.
Si Rome adopte une attitude sage et prudente, lorsque la fantaisie devient trop exaltée, Rome parle. Un livre interprétant Nostradamus, voulait faire de Pie XII le descendant de Louis XVII.
Il s’agit du
livre du docteur Max de Fontbrune[49] : La Divine tragédie de Louis XVII (Michelet, Sarlat, 1949).
Voici un article de Flos Florum sur cette affaire :
« Le Comte de Fontclairs de Coriolan nous a déjà fait part de son étonnement devant une telle assertion d’autant plus qu’il avait été ami intime du Comte Pacelli, un des frères du Pape Pie XII. Et son étonnement trouve un écho dans le démenti formel que vient d’adresser la Nonciature au secrétaire de notre Cercle Louis XVII, le Baron Pacotte de Servignat.
Voici ce démenti :
Nonciature Apostolique de France
N° 11.821
Paris, 17 avril 1950
10, avenue Président-Wilson, XVIe
Monsieur le Baron,
En réponse à votre lettre du 2 mars 1950 et en l’absence de Son Excellence, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la Nonciature n’a pas manqué d’interroger à Rome les personnes compétentes sur l’hypothèse présentée dans le livre La Divine tragédie de Louis XVII.
Comme le laissait prévoir l’auteur, « le dénouement… paraît être du domaine des contes de fées » : il ne s’agit là, selon l’avis autorisé des personnes consultées, que d’une pure fantaisie, ne reposant sur aucun fondement historique.
Veuillez agréer, Monsieur le Baron, l’assurance de mon respectueux dévouement.
Egano Righi Lambertini,
Auditeur. »[50]
IV] Martin de Gallardon
Préambule[51] :
Retiré au château de Rambouillet, le roi Charles X attend avec anxiété les nouvelles de Paris : un fait inouï s’est produit, la Monarchie vacille, les combattants s’avancent, le sang va couler…
Nous sommes en juillet 1830.
Le Roi, cependant, a 12 000 soldats fidèles qui peuvent vaincre ces parisiens révoltés, mais Charles X hésite, n’ordonne rien, ne répond pas aux demandes ; le Roi attend.
Il a envoyé un officier, Monsieur de La Rochejaquelein, à Gallardon, près de Chartres ; celui-ci doit consulter un paysan, Martin. De sa réponse dépend le sort de la France. La Rochejaquelein revient à Rambouillet dans la nuit.
Martin à répondu : « Charles X ne règnera plus – il doit sortir de France au plus vite – il mourra à l’étranger ainsi que son fils Angoulème – ils ne reverront jamais la France – le petit-fils du Roi ne sera pas roi. »
Charles X écoute le message ; il se résigne, tristement, et il signe son abdication ainsi que son fils, Angoulème. Et puis, tous deux partent pour l’exil…
Qui est donc ce Martin, ce paysan, sans grande intelligence et sans culture aucune, qui a prédit l’avenir de la famille royale, convaincu le Roi et changé ainsi le sort de la France ?
L’histoire de Thomas Martin de Gallardon est proprement incroyable, mais pourtant aussi réelle que tous les documents officiels qui en ont attesté ; histoire véridique que l’on peut lire aux Archives Nationales.
Voici l’histoire de Martin :[52]
Nous sommes le 15 janvier 1816, Thomas Martin, petit fermier de Gallardon, se rend, l’après-midi, sur une des terres qu’il exploite, au lieu dit « Le Champtier des Longs Champs », afin d’y répandre du fumier.
Seul dans cette grande plaine de Beauce, si désespérante pour le regard qui ne peut se poser sur aucun arbre, alors qu’il était bien sûr d’être absolument seul et qu’on n’apercevait âme qui vive jusqu’à l’horizon, vers trois heures de l’après-midi, il entend des paroles qui semblent être prononcées tout près de lui. Martin, qui se croyait seul, relève brusquement la tête et voit alors un individu distant de seulement quelques mètres. Le personnage lui est totalement inconnu. Il pense même ne jamais l’avoir aperçu dans le pays. Du reste, il n’aurait certainement pas oublié une personne habillée aussi bizarrement.
De taille moyenne, très mince, il est vêtu d’une longue redingote blonde qui l’enveloppe tout entier du col aux chevilles ; des souliers lacés, un chapeau rond haut de forme. Le visage est fin, pâle, délicat.
L’inconnu parle, sans bouger mais avec autorité :
« Martin, il faut que vous alliez trouver le Roi pour l’avertir qu’il est en danger. Des méchants cherchent à renverser le gouvernement. Il faut que le Roi fasse une police générale de ses Etats, qu’il ordonne des prières publiques pour la conversion des peuples sinon la France tombera dans de plus grands malheurs. »
La voix est fort douce et Martin cesse son travail pour écouter ces ordres étranges mais le paysan est mécontent d’être dérangé :
« Puisque vous en savez si long, répliqua-t-il, pourquoi n’allez vous pas faire votre commission vous-même ? Pourquoi vous adresser à un pauvre homme comme moi qui ne sait pas s’expliquer ? »
Mais l’étranger reprit, d’un ton d’autorité, pourtant sans élever la voix :
«Ce n’est pas moi qui irai, ce sera vous, faites ce que je vous commande. »
Aussitôt Martin, ébahi, le vit s’élever de terre, flotter un instant horizontalement et disparaître « comme s’il se fût fondu » dans l’air.
Le paysan veut fuir, il ne peut pas. Une force mystérieuse l’oblige à reprendre son travail « qui se trouve terminé en beaucoup moins de temps qu’il ne l’avait prévu. » Il rentra chez lui, à la nuit tombante, inquiet et absorbé.
Trois jours plus tard, le 18 janvier, vers 6 heures du soir, Martin descend dans sa cave, une chandelle à la main, chercher quelques pommes. Quelle n’est pas sa surprise d’y découvrir le même individu, « immobile et silencieux ». Martin laisse tomber sa chandelle et terrifié, remonte en courant l'escalier.
Le 20 janvier,
il sort dans sa cour de ferme, il ouvre la porte du pressoir pour prendre de
l'avoine. Dans l'encadrement de la porte, Martin se trouve
face à face avec l'inconnu, debout, qui le regarde. Martin se sauve, éperdu,
et s'enferme chez lui, tout tremblant. Il ne peut garder ce lourd secret, il en
parle à sa femme, Madeleine[53], et
à son beau-frère, Charles Francheterre. Tous deux
lui rient au nez : « Un homme caché sera vite dépisté, qu'il ne s'inquiète
pas », lui répondent-ils.
Le 21 janvier est un dimanche ; c'est le 23e anniversaire de la mort
de Louis XVI et des
offices solennels ont lieu dans la très belle église de Gallardon. Thomas Martin va aux
Vêpres avec sa famille. Au moment où il met la main dans le bénitier, il voit
l'inconnu qui fait de même. Martin se hâte de gagner sa place ; l'inconnu
le suit et entre dans le banc sans s'asseoir : « Il assiste aux Vêpres et
au chapelet avec le plus grand recueillement », dira Martin - et il sort avec
le paysan. L'inconnu n'avait de chapeau ni sur la tête ni dans les mains à
l'entrée de l'église mais il en a un à la sortie et, avec Martin qui rejoint sa
famille, il prend le chemin de la maison. Jusqu'à la ferme, l'inconnu se mêle à
la société ; là, de sa voix douce mais impérieuse :
« Acquittez-vous de votre
commission, dit-il ; faites ce que je vous dis. Vous ne serez pas
tranquille tant que votre commission ne sera pas faite » et il disparaît.
Martin prend à
témoin les personnes de sa famille : elles ont sûrement vu et entendu ?
Non, elles n'ont rien vu ni entendu…
Cette obsédante apparition va gâcher la vie de Martin, si
paisible : « Pour se débarrasser de ses tourments », dira-t-il,
il en parle à son curé, et il ajoute : « Je n'ai pourtant fait de mal
à personne pour qu'on m'ait donné cela ! » L'abbé Laperruque, 64 ans, Curé
de Gallardon, est un
excellent prêtre ; il écoute Martin, le réconforte, lui conseille de
consulter un médecin et, pour demander à Dieu d'éclairer son paroissien, il
dira, le 24 janvier, un messe au Saint-Esprit.
Précisons
que Martin, âgé de 33 ans à l’époque des faits, a toujours
été d’une santé très robuste (véritable bénédiction que lui valait certainement
une vie saine exercée au grand air). En outre, notre fermier n’avait rien d’un
illuminé. Comme tout bon paysan qui se respecte, Martin avait les pieds bien
sur terre. Il était dur à la tâche et économisait les maigres sous gagnés à la
sueur de son front. Il était également connu comme étant un honnête homme et un
bon père (il avait quatre enfants[54]).
Naturellement, il croyait en Dieu et assistait à certains offices, mais il
n’avait rien de la grenouille de bénitier et pas davantage du mystique. Tout
ceci, pour faire remarquer au lecteur que Martin n’est pas homme à aller
inventer une telle histoire. Martin, avait, qui plus est, toute sa raison,
ainsi qu’il sera établi plus loin.
Martin et sa
famille assistent à cette messe et puis le paysan rentre chez lui, monte au
grenier pour mettre le blé en sac avant de se rendre au marché de Chartres.
Dans le grenier, l'inconnu apparaît pour la cinquième fois. « Martin,
acquittez-vous de votre commission : le temps passe ! »
Le Curé de
Gallardon qui constate
l'agitation et l'inquiétude de Martin (celui-ci
perd sommeil et appétit) s'adresse à l'évêque de Versailles, Monseigneur
Charrier de la Roche, un homme bon mais fort original. Cet évêque a
prêté le serment civique exigé des prêtres pendant la Révolution et puis il
s'est rétracté. Arrêté à Lyon en 1793, l'évêque fut sauvé par les pauvres,
reconnaissants de sa bonté et de ses bienfaits.
Bonaparte lui
donne l'évêché de Versailles et ensuite Charrier de la Roche se rallie à
la Restauration.
L'évêque
demande à Martin de venir le
voir, accompagné du Curé de Gallardon et Martin,
très paisible, redit son histoire. L'évêque en est fort mécontent mais, devant
la candeur de Martin et sa bonne foi, il se contente de lui dire : « Allez
conter cette histoire au Préfet de Chartres et dites à l'inconnu de venir me
trouver. » Et l'évêque, certain de voir en face de lui une pauvre dupe
naïve, écrit au Ministre de la Police générale pour demander une enquête ;
il en avise le Curé de Gallardon qui est fort mécontent, persuadé, lui, de la
bonne foi et de l'équilibre de son paroissien. C'est d'ailleurs par ce prêtre
qui a mis tous les faits par écrit, que nous avons un des témoignages des
« visions » et des aventures de Martin.
Le fermier
retourne à sa ferme mais le 30 janvier l'inconnu lui apparaît et lui
parle : « Votre commission est bien commencée mais celui qui l'a
entre les mains ne s'en occupe pas. J'étais près de vous quand vous avez fait
votre déclaration à l'évêque mais j'étais invisible, il vous a dit de demander
mon nom et de quelle part je venais ; mon nom restera inconnu. Celui qui
m'a envoyé est au-dessus de moi » et il montre le ciel.
Martin réplique : « Comment vous
adressez-vous toujours à moi pour une commission comme celle-là, moi qui ne
suis qu'un paysan ? Il y a tant de gens d'esprit ! » Et l'inconnu :
« C'est pour abattre l'orgueil. »
« Vous
irez trouver le roi », affirme encore l'inconnu qui continue à apparaître
avec sa redingote blonde fermée, ses souliers lacés, son chapeau haut de
forme : « Vous lui découvrirez des choses secrètes du temps de son
exil mais dont la connaissance ne vous sera donnée qu'au moment où vous serez
introduit en sa présence. » Et l'inconnu révèle plusieurs faits à Martin qui rapporte
tout au Curé Laperruque. Celui-ci
prend note et Martin lui dit : « Je vous assure que toutes ces
visions m'ennuient et me fatiguent bien fort ; je voudrais bien en être
débarrassé ! »
Le paysan
s'imagine qu'il pourra échapper à toutes ces visites importunes en quittant le
pays, en cachette, sans rien dire à sa femme ; mais dans la grange où il
bat le blé, l'inconnu revient : « Vous aviez formé le projet de
partir mais vous n'auriez pas été loin : il faut que vous fassiez ce qui
est annoncé. » Et il disparaît. Le 2 mars, il revient et annonce des
malheurs et des fléaux pour la France.
Cependant le
Préfet d'Eure et Loir reçoit une lettre du Ministre de la Police, alerté par
l'évêque ; il est prié de vérifier si Martin n'est pas un
esprit exalté victime de son imagination, ou s'il ne convient pas d'arrêter le
prétendu « envoyé du ciel, cet homme extraordinaire qui poursuit un paysan
de Gallardon pour le
presser de se rendre auprès du Roi. » Le Préfet, comte de Breteuil, invite Martin et son Curé à se présenter à la
Préfecture de Chartres le 6 mars, à 6 heures du soir : « Vous allez
bientôt paraître devant le premier magistrat de votre arrondissement ; il
faut que vous rapportiez les choses comme elles vous sont annoncées. »
Le Préfet,
tout à fait sceptique, reste seul avec Martin pendant une
heure : l'aspect gauche et naïf du paysan qui parle certainement avec
franchise et conviction, frappe le comte de Breteuil. Il fait dire et redire son récit à Martin, essaie
de le jouer, de l'intimider et il le menace même de prison ! Martin,
paisible : « Comme vous voudrez mais je ne peux que dire la
vérité. » Le Préfet : « Et devant le Ministre, soutiendrez-vous
ce que vous venez de me dire? » Martin : « Oui, Monsieur, et
devant le Roi lui-même. » Le Préfet se décide alors à envoyer le fermier
au Ministre et il prévient Martin qu'il va partir pour Paris. Bien loin d'être
effrayé Martin est content de se rapprocher du Roi et de remplir sa
mission : « Il répétera ce qu'il a vu et entendu devant qui l'on
voudra, le signera et il consent à être puni très sévèrement si l'on prouve
qu'il est un imposteur. »
Le Curé
rédige un certificat fort élogieux de son paroissien et le Préfet appelle un
officier de gendarmerie, André, qui ne quittera plus Martin. Tous deux prennent à 5 heures du matin, le jeudi
7 mars, la diligence pour Paris tandis que le Préfet écrit au Ministre :
« Cet individu entoure d'un mystère ses prétendues visions et refuse
obstinément d'en désigner l'auteur. »
Rambouillet,
11 heures du matin. Martin et André se
mettent à table mais : « C'est le Carême, dit Martin, je ne mangerai
pas de viande. » A Paris, vers 5 heures et demi ils descendent à 1'Hôtel
de Calais, 38, rue Montmartre et, devenus très bons amis, Martin et le
lieutenant de Police se promènent dans Paris.
Vendredi 8
mars : Martin entre à la
Police Générale, quai Malaquais, à 9 h du matin et, dans la cour, l'inconnu se
présente devant Martin et André (ce dernier ne voit ni n'entend rien) :
« N'ayez crainte ni inquiétude et dites seulement les choses comme elles
sont. » Et la vision s'évanouit.
Martin est d'abord
reçu par deux secrétaires qui lui posent de nombreuses questions sans
l'intimider le moins du monde. Le Ministre, Elie Decazes, le fait
ensuite entrer dans son cabinet où il le garde une heure. Decazes a 35 ans, une
figure aimable ; il est le confident du Roi et son ami ; il essaie
d'abord de savoir si le paysan n'a pas quelque intérêt dans l'affaire mais
celui-ci répond : « Ce n'est pas de l'argent que je veux : il
faut que j'aille parler au Roi. » Decazes : « C'est une chose
qui n'est pas possible : moi-même je ne puis y aller que d'après un ordre
écrit. » Martin : « Il m’a toujours été dit qu'il fallait que j'aille
parler au Roi et que j'y parviendrais. »
Les
nombreuses questions du Ministre au sujet de l'inconnu ne troublent pas Martin.
Alors Decazes lui dit : « Vous ne le verrez plus : je l'ai fait
arrêter et conduire en prison. » « Comment avez-vous fait »,
répond Martin, « il disparaît comme un éclair ! D’ailleurs je viens
de le voir ici tout-à-l'heure. » Le Ministre appelle un secrétaire :
« Allez voir si cet homme est en prison. » Le secrétaire sort et
revient : « Il y est toujours. » Martin : « Eh bien,
faites le venir ; je le reconnaîtrai bien, je l'ai assez vu pour
cela ! » Decazes n'insiste pas, congédie Martin et recommande au
lieutenant André de le surveiller de près.
Tous deux
retournent à l'hôtel de Calais et Martin dit :
« Monsieur le Ministre a donc relâché l'homme qui m'apparaît puisqu'il
m'est apparu de nouveau et qu'il m'a dit : « On a voulu vous faire
croire qu'on m'avait arrêté mais vous pouvez dire que l'on n'a aucun pouvoir
sur moi et qu'il est grand temps que le Roi soit averti. » André fait son
rapport.
Samedi 9
mars, à 7 h et demi du matin, Martin est dans son
lit, le lieutenant André près de lui. L'inconnu se dresse devant le paysan qui
avertit aussitôt André : « Il est là !... » Mais le
lieutenant ne voit ni n'entend rien ; il se met à la place que Martin lui
indique, il tâtonne avec ses bras. Rien.
L'inconnu
annonce à Martin qu'il verra
un docteur dans la journée et qu'il doit répondre sans inquiétude. En effet, un
visiteur se présente l'après-midi, Monsieur Pinel, célèbre médecin en chef de la Salpêtrière,
reconnu comme le meilleur aliéniste de son temps. La conversation s'engage et
Martin, très calme : « Il m'a été dit qu'un docteur viendrait ;
je ne sais pas ce que c'est qu'un docteur mais je pense bien que c'est
vous ; il m'a été dit que ceux qui vous envoient sont plus fous que
moi ! » Pinel ne constate aucune trace de délire mais un état
visionnaire qui nécessite un traitement médical. Pinel reste préoccupé cependant ;
il examinera de nouveau Martin, le 12 mars, avec Royer-Collard, médecin-chef
de Charenton. Celui-ci demandera que Martin y fasse un séjour ; les deux
médecins avouent ne pas bien comprendre ce cas !
C'est après
la visite de Pinel, le 10 mars,
que l'inconnu révèle son « identité », si l'on peut dire. « Je vous avais
dit que mon nom resterait caché mais l'incrédulité est si grande qu'il faut
que je vous le dévoile : je suis l'Archange Raphaël, ange très célèbre
auprès de Dieu. J'ai reçu le pouvoir de frapper la France de toutes sortes de
plaies. »[55] Martin est saisi de
frayeur : il le dit à André.
Deux fois,
le 11mars, Martin voit
l'apparition et encore le mardi 12 mars. L'ange lui dit que l'on prendra des
informations sur lui à Gallardon et Martin
l'écrit à son frère. Cette lettre est datée du 12 mars et pourtant le Ministre
n'écrit au Préfet que le 15 mars ; l'enquête retiendra cette
« prémonition » de Martin. Le 13 mars, le paysan annonce à André
qu’ils vont se séparer et, en effet, André le conduit à Charenton et Martin
passe sa première nuit chez les aliénés.
Martin voit le Roi
Écoutons
l'historien Lenôtre[56] :
« La sincérité de Martin est absolue
- à moins d'imaginer qu'il soit assez madré, assez habile comédien pour réussir
à duper les gens les plus sceptiques du monde, les policiers, les gendarmes et
les aliénistes, portés à voir partout des simulateurs, des roués et des
fourbes, il faut bien croire que Martin voit ou croit voir un ange dont il
écoute les instructions et auquel il obéit avec une aveugle docilité. »
Cet ange, dont le costume est déconcertant et qui ne se montre qu'à lui,
l'instruit de tout. S'agit-il donc d’un Martin paranoïaque,
d'un Martin aliéné, d'un Martin imposteur, instrument de quelque homme
politique ? Toutes les hypothèses ont été envisagées : aucune
n'aboutit à une conclusion satisfaisante et cependant les rapports les plus
sérieux nous sont parvenus, rapports de police, diagnostics de médecins, compte
rendus d'hommes politiques, avis d'ecclésiastiques. Personne d'ailleurs ne
semble avoir mis en doute la parfaite bonne foi du laboureur mais les enquêtes
n'aboutissent pas…
Revenons à Charenton le 13 mars 1816. À l'hôpital, il y a trois classes
de pensionnaires et André remet Martin au Directeur
en le lui recommandant chaudement : c'est un homme droit, digne et
religieux. Le Directeur écoute à son tour les récits de Martin et André s'en
va.
Le médecin
en chef de Charenton doit se rendre à l’évidence : Martin n’est
atteint d’aucune maladie apparente et il ne présente pas davantage de signe de
démence. Il est quand même décidé de garder Martin à Charenton, afin de
l’observer de manière assidue. Pour le paysan de Gallardon, commence alors un long séjour dans un lieu où il
n’a certainement pas sa place.
La santé du paysan est florissante, disent les médecins qui l'examinent,
sa tranquillité parfaite ; les infirmiers ont ordre de l'observer sans
cesse et Martin découvre
avec surprise les excentricités des malades : un Curé se croit perdu et
damné, Martin le réconforte ! Pendant qu'un interne note toutes ses paroles
et que les médecins l'observent, perplexes, Martin travaille au jardin pour
s'occuper et répond aux questions sans se vanter jamais ni prendre la parole le
premier.
Tout d'ailleurs semble clair au paysan de Gallardon : il a reçu une mission pour le Roi de la
part d'un Ange, commissionnaire du Bon Dieu, quoi de plus normal ? A son
frère, Martin écrit :
« À la volonté de Dieu ! Je suis toujours le même ; tant que ma
commission ne sera point faite, je ne serai jamais tranquille. » Au
personnel de Charenton Martin inspire beaucoup de sympathie et en attendant placidement
de voir le Roi aux Tuileries, Martin mange, Martin dort, Martin travaille,
Martin rit !
Dès le 15 mars, Louis XVIII sait que, de
la part du Ciel, un simple campagnard veut le conseiller mais il y a eu souvent
des fous qui entendent des voix et le Roi se renseigne. Le Vicomte de La
Rochefoucauld, aide de camp
du Comte d'Artois, vient à Charenton
et dit à Martin : « Qu'attendez-vous ici ? »
« Qu'on vienne me prendre pour me conduire chez le Roi parce que l'Ange me
l'a prédit ; j'attends donc avec confiance, il faut que je lui parle, je
lui parlerai. » Et, dans les Mémoires de La Rochefoucauld, on
lit : « Je n'ai jamais vu une expression aussi frappante que celle de
Martin, une physionomie aussi honnête et aussi simple que la sienne qui
cependant prenait quelque chose de solennel et d'inspiré quand on en venait à l'Ange. »
C'est La Rochefoucauld qui obtiendra du Roi une audience pour Martin.
Le 28 mars, M. Le Gros, surveillant, vient voir Martin et lui
demande que l’Ange que Martin voit le prenne sous sa protection. « Oui,
répondit Martin, je le lui demanderai. » Il n’eut pas la peine de la
faire ; car, dès l’apparition suivante, l’Ange le prévint et lui
dit : « Quelqu’un de la maison vous a demandé que je le prenne sous
ma protection, vous lui direz : que tous ceux qui professent la religion,
et qui la pratiquent avec une ferme foi, seront sauvés. »
L'apparition
du 31 mars 1816 est la plus remarquable : Martin se promène
dans le parc de Charenton et l'ange apparaît : « Approchez-vous de
moi, dit-il, et prenez ma main. » Martin sentit sa main droite serrée par
celle de l'ange. Alors l'apparition ouvre sa redingote blonde et une lumière
aussi brillante que le soleil éblouit Martin qui met sa main devant ses yeux.
Le corps de l'ange est étincelant mais il referme son vêtement, la lumière
s'éteint et l'ange ôte son chapeau pour montrer son front lisse car les démons
sont, dit-on, toujours cornus !
Un
questionnaire est parti pour Gallardon. Martin appartient à
une famille saine, il n'a jamais été bizarre mais simple, droit, religieux sans
excès. Sa vie fut toujours paisible, ses amis en témoignent ainsi que sa
famille. Jacques Martin, son frère, qui labourait avec Thomas, dit qu'il l'a vu
un jour s'arrêter dans l'attitude d'un homme qui écoute.
S’il sait
lire et écrire, Martin n’en abuse
pas : son curé ne lui connaît que des livres d’office ; « il
n’est point lecteur », dit de son côté le maire ; il ne lit pas les
journaux, et en 1816, il ignorait l’histoire de Jeanne d’Arc.
A la cour,
on parle de plus en plus du visionnaire de Gallardon, et l’histoire finit par parvenir jusqu’aux
oreilles de Monseigneur de Talleyrand de Périgord,
grand aumônier du Roi, lequel décide d’envoyer deux émissaires ecclésiastiques
à Charenton dans le but d’examiner Martin. Les envoyés de l’archevêque se trouvent être
l’abbé d’Astros et l’abbé Denis de Frayssinous, tous deux grands théologiens et
intellectuels reconnus. La conversation qu’ils ont avec Martin les convertit
immédiatement à sa cause. Pour eux, il n’est nul doute qu’un envoyé de Dieu se
manifeste à Martin et c’est d’ailleurs ce qu’ils indiqueront dans leur rapport.
Autre
rapport très attendu, celui de Pinel et de
Royer-Collard, dans lequel les deux éminents hommes de science
concluent « que Martin ne présente
aucun symptôme de démence, qu’il n’est pas non plus un imposteur, que nulle
ambition de jouer un rôle et de se mettre en évidence n’a jamais germé dans son
esprit très médiocre et de peu d’étendue ; enfin qu’il est matériellement
impossible d’admettre, dans ces phénomènes déconcertants, l’intervention d’une
personnalité étrangère. Au surplus, il existe des exemples incontestables de
prévisions et de pressentiments qui ont été ensuite réalisés par l’événement. »
Le séjour de
Thomas Martin à Charenton
eut une conséquence singulière : il serait dommage de ne pas la noter. Le
directeur de l’asile d’aliénés, M. Roulhac-Dumaupas, le célèbre docteur Royer-Collard, bref presque tout le personnel de Charenton,
médecins, infirmiers, garçons de salle, qui se trouvèrent en contact avec
Martin pendant son séjour à l’asile furent ramenés à la stricte observation de
leurs devoirs religieux.
Cependant
les commérages commencent à aller bon train et les Ultras s'agitent. Le Roi, si
peu crédule et si peu mystique pourtant, demande qu'on lui amène Martin, le 2 avril 1816.
Martin n'aura donc lutté que deux mois et demi pour accomplir sa mission
puisque la première apparition date du 15 janvier. Un employé de Police
apporte à Charenton une lettre du Roi : il faut lui confier Martin.
Le paysan
ignore où on l'emmène mais il part paisiblement à pied, refusant la voiture
qu'on lui propose et il arrive Quai Malaquais. De nouveau, il est introduit
chez Decazes : « Vous voulez donc parler au
Roi ? »
« Oui,
ma mission ne sera pas faite à moins que je ne lui parle. » « Mais
qu'avez-vous à lui dire ? » « Je ne sais pas pour le
moment : les choses me seront indiquées quand je serai auprès de
lui. » « Je vais vous y conduire. » Et Decazes se retire
pour mettre son costume de cour ; Martin, resté seul, voit l'Ange qui lui dit :
« Vous allez parler au Roi ; les paroles vous viendront à la
bouche. » Decazes, lui, donne une lettre à un employé : « Vous allez
conduire cet homme au premier valet de chambre de Sa Majesté. »
Le carrosse
du Ministre part ; l'autre suit. Voici le Carrousel, la façade solennelle
et le superbe Pavillon Central des Tuileries, l'escalier d'honneur, les appartements
du Roi. Rien n'étonne Martin. Le valet Hue lit la lettre d'audience :
« Suivez-moi », dit-il à Martin et il le conduit chez le Roi.
Dans le
cabinet de Louis XVIII, Decazes assistera à
la première partie de l'entretien mais ensuite le Roi congédiera son Ministre
et fera fermer les portes. Nous n'avons aucune relation du Roi lui-même mais
Decazes donne au médecin Royer Collard son
témoignage pour la première partie de l'entretien et le médecin la transmet. Et
en 1825, après la mort du Roi, Martin redira à Mathieu
de Montmorency ce qu'il a
dit au Roi en secret et Mathieu a témoigné à son tour. Ces deux relations se
trouvent aux Archives Nationales.
Voici donc
Martin en face de
Louis XVIII comme le lui
a prédit l'apparition ; le Roi est obèse, goutteux mais sa belle tête et
sa majesté en imposent. Depuis l'émigration, Louis est l'affirmation d'un
principe, la Monarchie.
Pauvre,
exilé, repoussé par les Puissances européennes, il a maintenu sans faiblir
l'entité abstraite « royauté » et le voilà sur le trône ! Mais
pourtant, la Restauration n'a pas ressuscité la Monarchie défunte et elle doit
justifier de son existence. Avant 1789, être sujet du Roi ne supposait aucune
adhésion à un régime : tous les Français naissaient sujets du Roi. En 1816,
il faut s'affirmer royaliste et l'opposition au régime ne cesse pas…
Dans ce
cabinet sévère, Martin ôte son
chapeau sans aucune gêne : « Sire, je vous salue. » « Bonjour,
Martin. » « Vous savez, Sire, pourquoi je viens. » « Oui,
je sais que vous avez quelque chose à me dire et c'est quelque chose que vous
ne pouvez dire qu'à moi, asseyez-vous, Martin. » Le paysan s'assied dans
un fauteuil, une table le sépare du Roi auquel il demande : « Comment
vous portez-vous ? » « Je me trouve un peu mieux. Quel est le
sujet de votre voyage? » Martin raconte ses visions et les recommandations
de l'Ange. « On a trahi le Roi, on trahira encore, il s'est sauvé de
prison un homme (« c'est la Valette », dit le Roi). Que le Roi
examine bien tous ses employés et surtout ses Ministres. » Louis XVIII pense sans
doute qu'on attaque Decazes et que le
naïf laboureur est victime d'une machination ; il semble peu probable que
le sceptique monarque ajoute foi aux visions de Martin.
Cependant le
paysan change de ton ; le Roi fait sortir Decazes et plus tard
Martin assurera à
Montmorency qu'il ne
savait rien de ce qu'il allait révéler, l'ange lui ayant seulement promis que
l'inspiration viendrait au moment voulu : « Les mots, dira Martin, se
sont trouvés dans ma bouche. » Un autre parlait en lui et, quand ce fut
fini, il n'a plus trouvé d'expressions.
Brusquement
inspiré, Martin s'adresse
donc au Roi. « Faites appeler votre frère et ses fils car ils doivent
savoir ce que j'ai à vous dire. » Le Roi l'interrompt : « Cela
est inutile ; d'ailleurs je leur répéterai tout ce que vous me direz. Il
semble que vous avez quelque chose à me dire en particulier et en
secret ? » Martin sent venir sur sa langue les paroles que l'Ange
avaient promises : « Le secret que j'ai à vous dire, Sire, c'est que
vous occupez une place qui ne vous appartient pas. » Le Roi fait un vif
mouvement « Comment ! Comment ! Mon frère et ses enfants étant
morts, je suis le légitime héritier. » Martin : « Je ne connais
rien tout cela mais je sais bien que la place n'est pas à vous ; ce que
j'ai à vous dire, c'est que vous occupez un trône auquel vous n’avez aucun
droit. » Le Roi : « A qui donc doit-il appartenir ? » « A
votre neveu Sire. » « Mais où est-il, mon neveu ? »
« Vous
le savez mieux que moi. » « Non vraiment. »
« Dans
ce cas, ordonnez que l'on fasse les recherches nécessaires pour le retrouver et
lui rendre ses droits. Et tout ce que je vous ai dit est aussi vrai qu'il est
vrai qu'étant un jour à la chasse avec Louis XVI, votre frère, dans la forêt de Saint-Hubert, le
Roi étant devant vous d'une dizaine de pas, vous avez eu l'intention de tuer
votre frère, le Roi. Vous aviez un fusil à deux coups dont l'un était destiné à
Louis XVI et vous auriez tiré l'autre en l'air pour faire croire qu'on avait
tiré sur vous et vous auriez accusé quelqu'un de votre suite. Seulement au
moment de réaliser votre projet, vous vous êtes trouvé embarrassé dans une
branche d'arbre et le Roi rejoignit un groupe de chasseurs. Cette pensée vous
traversa l'esprit : « un peu plus, j'étais roi de
France ! » et longtemps vous avez conservé le même dessein mais vous
n'avez pas pu trouver une occasion favorable. »[57]
Le Roi,
frappé d'étonnement et profondément ému : « O mon Dieu, cela est bien
vrai. Il n'y a que Dieu, vous et moi qui sachions cela. Promettez-moi de garder
sur toutes ces communications le plus grand secret. » Martin promet ; il ne se croira dégagé de son
serment qu'après la mort du Roi. Et le paysan continue à parler pendant que le
Roi murmure : « Quel souvenir vous venez de réveiller en
moi ! » « Vous faites des préparatifs pour votre Sacre ;
prenez bien garde de vous faire sacrer : si vous le tentiez, vous seriez
frappé de mort au milieu de la cérémonie. » Louis XVIII ne se fera
jamais sacrer. Et Martin : « Vous voyez que je connais vos pensées
les plus secrètes. Descendez de votre trône et laissez l'affaire à gouverner à
qui en a le droit. Envoyez des gens de confiance pour préparer l'avènement du
prince légitime qui sera aimé et respecté de ses sujets. Ordonnez des
recherches pour retrouver votre neveu : me le promettez-vous ? Le
Roi : « Oui, Martin, je vous le promets. » Et Louis XVIII
demande à Martin des détails sur la vision lumineuse du 26 mars, l'Ange plus
brillant que le soleil ; et il dit à Martin « que je touche la main
que l'Ange a touchée ! » Martin lui tend la main droite et le
Roi : « Priez Dieu pour moi. » Et Louis XVIII se lève et
reconduit Martin à la porte du Cabinet.
Le Duc des
Cars, gentilhomme de la Maison du Roi, attend dans la pièce voisine ;
l'entrevue, dira-t-il, a duré 55 minutes. Le Duc voit Martin sortir,
calme et serein, et qui demande à retourner chez lui. Le Roi, au contraire est
ému, pâle, agité ; son chancelier s'approche et lui demande en souriant
ironiquement l'explication de ce mystère mais Louis XVIII répond
sévèrement : « Il ne convient pas de baguenauder, Monsieur
d'Ambray ; Martin m'a dit des choses que seuls, Dieu et moi, pouvions
connaître. » Les révélations inattendues de Martin ont certainement beaucoup
frappé le Roi puisque, en reconduisant le laboureur, Louis XVIII lui a parlé
solennellement à la troisième personne : « Je suis sûr que Martin ne
trahira jamais ce secret. » Et plus tard, à la Duchesse de Berry, le Roi affirmera « que Martin était un fort
honnête homme qui lui avait donné de bons conseils dont il espérait pouvoir
profiter. »
En d'autres
temps, le paysan eût peut être été jeté dans une oubliette ou bien il serait
mort mystérieusement : or, il, n'en fut rien. Une belle voiture reconduira
Martin à Charenton
d'abord, selon son désir, et puis il regagnera Gallardon. Martin reverra Decazes qui le
forcera à accepter un peu d'argent de la part du Roi ; au Ministre, Martin
dira que sa conversation avec le Roi demeurera secrète. En effet, elle ne sera
connue qu'après la mort de Louis XVIII. Et Martin prédira à Decazes sa disgrâce dans des
circonstances sanglantes : ce sera, nous le savons, l'assassinat du Duc
de Berry, en 1820, qui entraînera la chute du Ministre.
La mission
est accomplie, le paysan rentre chez lui.
Le Roi Louis
XVIII[58]
Martin, le laboureur, a donc rencontré, seul à seul, ce
Roi dont Talleyrand disait,
quand il était encore Comte de Provence : « Il veut la couronne et son frère lui fait
obstacle : il est possible qu'il s'en débarrasse ! » La Comtesse
de Provence, elle, affirmait : « Monsieur veut trôner. » Quant à
Napoléon il portera un jugement sévère sur le futur Louis XVIII : « Faux comme Monsieur. »
Tous les
témoignages concordent : le frère de Louis XVI, ce cadet, se
consume dans l'envie. Il est cependant le second personnage du royaume, il a de
belles ressources financières, de l'esprit, de la culture et une cour de thuriféraires
autour de lui ; mais pourquoi n'est-il pas roi, lui qui se croit tellement
supérieur à son aîné ?
Cagliostro,
le voyant, affirma au Comte de Provence qu'il serait
roi et, pendant plusieurs années, Louis XVI n'a pas eu
d'enfants ; s'il venait à disparaître, son cadet prendrait sa place sur
le trône. Plusieurs historiens font état, sans preuves certaines, de tentatives
d'assassinat perpétrées contre le Roi par son frère. On sait qu'en septembre
1778, Louis XVI s'est égaré en forêt de Sénart ; Provence arrête la
voiture d'un médecin pour que le Roi monte ; la voiture s'effondre et se
brise !
Deuxième
voiture, deuxième accident ! Tout cela était-il préparé ? Martin parlera
d'une autre tentative d'assassinat...
Cependant
voici le mariage du Roi consommé et la Reine qui attend un héritier. Monsieur
renoncera aux attentats et fera appel à d'autres méthodes. En apprenant les
espérances de Marie-Antoinette, Monsieur a
écrit sa déception au roi de Suède : « La raison, un peu de philosophie,
la confiance en Dieu me fait accepter la naissance ! » Mais au
baptême de la petite Marie-Thérèse, le Comte de Provence qui
représente, comme parrain, le Roi d'Espagne, déclare au Cardinal de Rohan
demandant le nom de l'enfant : « Ce n'est pas par où on commence ; la
première chose est de savoir quels sont les père et mère, c'est ce que prescrit
le rituel. » Les prêtres restent interdits, les courtisans chuchotent et
ricanent : Provence a osé jeter un doute sur la légitimité de Madame
Royale et sur la vertu de la Reine. Celle-ci n'oubliera jamais…
Un premier
dauphin est né en 1781 et puis le Duc de Normandie en 1785.
Alors Provence prépare
contre la Reine un dossier perfide : le Roi est incapable d'avoir des
enfants, ceux-ci ne sont donc que des bâtards, ils ne peuvent régner et la
Reine est infidèle. Des enfants adultérins ne doivent pas prétendre à la
couronne : il faut donc interner le Roi, exiler la Reine et nommer
Provence Régent ou bien Lieutenant Général tandis que son cousin, le Duc
d'Orléans deviendra Premier Ministre. Ce dossier est confié au Duc de Fitz
James pour être
déposé au Parlement de Paris. Une copie en sera faite pour chacun des membres
de l'Assemblée des Notables en 1787. Ces documents sont pris par la Convention
et retrouvés dans les papiers de Robespierre ; on comprend le mot de
Madame Campan : « Une haine implacable est accumulée sur la tête de
Marie-Antoinette par la
calomnie et les paroles de la Reine au sujet de son beau frère. Il y a dans ce
cœur là plus d'amour personnel que d'affection pour son frère et certainement
pour moi. Sa douleur a été toute sa vie de ne pas être né le
maître ! »
Après la
prise de la Bastille, le Roi va à Paris, le 17 juillet 1789 et il confie la
lieutenance générale du royaume à Monsieur ; mais Louis XVI est acclamé à
l'Hôtel de Ville et Provence ne prendra
pas le pouvoir. Monsieur s'était toujours posé en prince « patriote »
et c'est lui qui avait demandé le doublement des voix du Tiers Etat, un acte
qui changeait tout à fait le sens des Etats Généraux ; ce doublement fut
voté par l'Assemblée des Notables, présidée par le Comte de Provence, le 13
novembre 1788, à une voix de majorité, celle du vieux Comte de Montboisier.
Celui-ci dormait ; on le réveille, il demande: « Qu'est-ce qu'on
dit ? » On lui répond : « On dit oui. » Et il vote le
oui.
Monsieur a
aussi refusé de signer le Mémoire que les princes ont remis au Roi au moment de
la séparation des Notables. Il prend donc une position différente de celle des autres
Princes et, dans l'ombre, dès septembre 1789, il ourdit un complot avec les
Comtes de La Châtre et du Luxembourg : on enlèvera le Roi, la Reine, les
enfants, on les conduira en lieu sûr, Monsieur sera Régent.
Ce projet
est différé mais Monsieur semble bien être un des instigateurs des Journées
d'octobre 1789, fort bien préparées et qui ont contraint la famille royale,
assiégée à Versailles, à se rendre à Paris. Le général Bouillé accuse le Comte
de Provence et le Duc
d'Orléans d'avoir préparé ces Journées ; le général de Grimoard, qui
travaillera plus tard au Comité de Salut Public, y apprendra, dit-il, que le
frère du Roi fut le moteur de ces Journées d'Octobre et, dans les papiers du
Conventionnel Durand, on peut lire : « Le Comte de Provence passa la
nuit du 5 au 6 octobre 1789 fort tranquillement dans l'attente qu'on viendrait
le chercher pour le proclamer au moins Régent ! »
La Reine,
pendant ce temps, manqua d'être assassinée dans son lit par la foule et, quand
Monsieur rejoint le Roi, vers 8h et demi du matin, coiffé, habillé, pas du tout
ému, il se contente de dire paisiblement : « Que voulez-vous ?
Nous sommes en révolution : on ne fait pas d'omelette sans casser les
œufs ! » Monsieur emmènera son épouse à Paris, s’installera dans son
cher Luxembourg et y mènera une vie de sybarite pendant que la famille royale
est étroitement surveillée aux Tuileries… Quant au Duc d'Orléans, il dira à son
secrétaire, Choderlos de Laclos, après les Journées d'Octobre :
« L'argent n'est point gagné : le marmot vit encore » tandis que
Provence écrit :
« C'est un pauvre sire que mon frère et la France est digne d'avoir un
véritable Roi. » Louis XVI devient
l'otage de la capitale et Mirabeau qui voit le danger propose un plan pour
sauver le Roi et les siens mais il le fait présenter à Monsieur et celui ci
affirme que le Roi ne l'acceptera pas et ne partira pas en Normandie. La
tentative de Mirabeau échoue.
Ce projet
contrariait, en effet, celui de Monsieur qui prépare l'enlèvement du Roi avec
Thomas de Mahy, Marquis de Favras, un exalté auquel on fait de belles promesses.
Favras, à la fin de 89, recrute des hommes pour le compte de Monsieur et
rencontre le banquier Chomel qui doit procurer l'argent nécessaire ; mais
Chomel demande des précisions avant de prêter deux millions. Alors Favras parle
trop : on fera partir le Roi à Péronne, on se débarrassera de Bailly et de
La Fayette, Monsieur prendra le pouvoir. Chomel, très inquiet, prévient La
Fayette et un billet circule bientôt dans Paris, accusant Monsieur d'être à la
tête d'une conjuration pour détrôner le Roi.
La Fayette
va trouver le Comte de Provence qui nie
tout, feint la stupéfaction et l'horreur mais demande secrètement conseil à
Mirabeau. Ce dernier lui dit de se défendre hardiment devant la Commune de
Paris. Avec la permission du Roi, auquel il a présenté l'affaire comme une
calomnie à son égard, Monsieur, un prince du sang, n'hésite pas à se rendre
devant les bourgeois pour se justifier, fait sans précédent ! La salle
est comble, le Comte de Provence parle habilement ! Il ne connaît pas
Favras, il a seulement essayé d'emprunter pour payer ses dettes. La situation
se retourne alors et Monsieur est acclamé. Pourquoi ne deviendrait-il pas Premier
Ministre tandis que le Roi prendrait la tête de la Révolution ? La Reine
fait échouer ce projet ce qui rend Monsieur furieux.
Favras, lui,
est arrêté ; mais il reçoit l'avis secret qu'il ne court aucun danger s’il
met Monsieur hors de cause. Favras se tait donc devant ses juges mais il dépose
un récit véridique entre les mains du lieutenant civil Omer Talon, dont la
fille sera plus tard Madame du Cayla. Cette déposition rendra Madame du Cayla toute
puissante, plus tard, auprès de Monsieur devenu roi de France.
Le 18
février 1790, Favras, pieds nus et le cierge à la main, fait une amende
honorable à Notre Dame et puis, il est conduit à la potence. Il comprend alors
qu'on l'a joué et il demande à son confesseur s'il doit parler, si de nouvelles
révélations obtiendront sa grâce. Un silence pesant : les magistrats se
regardent. Alors le Curé de Saint-Paul affirme à Favras qu'il n'a rien à
espérer tandis que la foule s'impatiente. Omer Talon guette les lèvres du
condamné et Favras, à deux reprises : « Je suis innocent. » On
lui passe la corde au cou et pendant que les assistants crient :
« Saute, marquis. » Omer Talon griffonne un billet : « Il expire
et il n’a rien dit ! » On court porter la bonne nouvelle à
Monsieur ; le Comte de Provence se frotte
les mains, soulagé : « Allons, nous pouvons nous mettre à table et
souper de bon appétit ! »
Mais, depuis
l'affaire Favras, Monsieur sait qu'il est à la merci de La Fayette et la
carrière du futur Louis XVIII ne débutera
qu'avec sa fuite hors de France dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 qui le
conduit à Mons pendant que la famille royale est arrêtée à Varennes. Plusieurs
historiens accusent Monsieur d'avoir fait échouer le voyage du Roi ; le
Comte russe Potocki affirme avoir trouvé, quelques années après, dans les
bagages de Louis XVIII pillés par les brigands au départ de Mittau, des
instructions pour faire disparaître Louis XVI évadé du Temple et pour faire
arrêter la famille royale à Varennes. Documents déposés par le tsar Alexandre
aux Archives secrètes de Russie…
Louis XVI, en tout cas, n'a pas confiance en son frère,
puisqu’il ne l'a informé qu'au moment du départ de son intention de gagner
Montmédy ; si Monsieur connaissait cependant l'itinéraire du voyage et l'a
révélé à La Fayette, la poursuite devenait facile. Le Général a bien lancé
Romeuf sur la route de Montmédy, la bonne route…
Devenu Louis
XVIII, le frère de Louis XVI célébrera chaque année le
bonheur de sa délivrance, le 20 juin ; c'est ce jour là, en effet, que la
possibilité de ceindre la couronne se précise. Emigré, le Comte de Provence mène une
politique qui doit conduire le Roi à l'échafaud et son impertinente réponse à
l'ordre officiel de l'Assemblée de rentrer en France sans délai, fait venir des
larmes aux yeux de la Reine.
Elle
murmure : « Caïn, Caïn » et le Roi : « Je vois qu'il
pense à lui plutôt qu'à moi. »
Provence continue à
se conduire en rebelle ; par son action à Coblence, il apparaît que
Monsieur a contribué à provoquer la journée du 10 août 1792 qui a renversé le
trône - en s'associant à la campagne militaire de Brunswick à travers la
France, il a peut-être rendu la mort du Roi inévitable - en provoquant les
émeutes de Lyon et de Toulon, il a sans doute entraîné la condamnation de la
Reine…
En apprenant
l'exécution de Louis XVI, le Comte de Provence écrit au
Comte d'Artois la lettre suivante :
« C'en est fait, mon frère, le coup est porté. Je tiens dans mes mains la
nouvelle officielle de la mort du malheureux Louis XVI et je n'ai que le temps
de vous en avertir. L'on m'apprend aussi que son fils va mourir. En donnant des
larmes à nos proches, vous n'oublierez pas de quelle utilité pour l'Etat va
devenir leur mort. Que cette idée vous console ! »
Or, en 1793,
le dauphin, devenu Louis XVII, est en parfaite santé mais cette phrase terrible
révèle, une fois de plus, l'ambition du Comte de Provence « cuirassé dans son égoïsme » comme
l'écrit un contemporain.
La Reine est
guillotinée à son tour et Provence écrit :
« Me voilà maintenant dans une belle position. Nous verrons si la Cour de
Vienne continuera à me refuser la Régence ! »
Dès
l'annonce de la mort légale de Louis XVII, Monsieur prend le nom de Louis XVIII et l'annonce
à toutes les Cours d'Europe. Monsieur a gagné une rude partie ![59]
Les
révélations de Martin de Gallardon ne portent
pas sur ces faits dont les preuves, d'ailleurs, ne sont pas toujours
trouvées ; le laboureur se contente d'affirmer que le fils de Louis XVI est vivant,
qu'il faut lui rendre le trône, que c'est lui qui doit régner. Nous allons voir
dans quelle mesure le Roi Louis XVIII fut
influencé par les avertissements du paysan.
Après la
visite au Roi
Martin quitte donc
le Roi auquel, nous dira-t-il, il a transmis le principal objet de sa
mission : rendre la place de son neveu, le fils de son frère, qu'il ne lui
sera pas difficile de retrouver. Et Louis XVIII a pris la
main droite de Martin, celle que l'Ange a serrée, en disant : « Priez
pour moi. »
Le bonhomme
rentre chez lui et garde, jusqu'à la mort du Roi, le secret que celui-ci a
demandé. Les visions ne se renouvellent pas et, aux voisins de Gallardon qui
l'interrogent, Martin répond
simplement : « J'ai fait mes affaires comme vous avez fait les vôtres. »
Cependant il se confie à un magistrat janséniste, Monsieur Silvy, qui fera une
relation des faits très précieuse pour l'Histoire.
Voici un
extrait des Mémoires de La Rochefoucauld, tome 9[60],
page 520, sur Martin de Gallardon :
« Louis
XVIII fut si
frappé des paroles de Martin qu’il envoya
chercher l’archevêque de Paris, le cardinal de Périgord, pour lui tout
raconter ; ce qui du reste prouve la bonne foi du Roi.
En sortant
de chez Sa Majesté, le vénérable prélat vint chez mon père lui confier ce
secret auquel il paraissait attacher une grande importance ; et le
lendemain mon père, qui connaît ma position comme mon dévouement et ma
discrétion, me répéta tout ce qui venait de se passer. »
Le Roi n'a
pas oublié Martin, il en a
parlé aux siens et ce sont peut-être les paroles du laboureur qui conduisent
Louis XVIII à écrire sur
Marie-Antoinette « un
témoignage conforme à la vérité », à affirmer « qu'elle n'a commis
aucune faute » et le Roi ajoute même : « Je proteste
solennellement de sa vertu. »
Les
apparitions ont cessés. Louis XVIII a donné une
demi satisfaction à l’envoyé de Dieu en faisant davantage respecter le saint
jour du dimanche et dire des solennelles actions de grâces. La crainte ne lui a
pas permis de réclamer l’onction du sacre, bien que cette cérémonie ait été
plusieurs fois annoncée. Cependant, il a gardé la couronne usurpée ;
malgré sa promesse, il n’a rien dit à sa famille du secret révélé pour elle à
Martin. Mais en 1820, le plus jeune des Bourbons résidant
en France, le Duc de Berry, est frappé par le poignard d’un assassin. Ce
premier coup de la Providence annonce la révolution future. Alors le paysan de
Gallardon voit l’Ange
lui apparaître de nouveau.
En effet,
l'évènement Martin a fixé
l'attention du Duc de Berry, le fils du Comte d'Artois ; celui-ci écrit à Naundorff, l'homme qui affirme être le Duc de Normandie, fils de Louis XVI. Le Duc de Berry est alors
convaincu par cette correspondance qu'il a retrouvé son cousin germain et qu'il
doit lui céder la place. Il engage une discussion à ce sujet avec son père, le
futur Charles X : « Eh bien, mon père, il paraît qu'au
lieu d’un vieux roi nous allons en avoir un jeune ! » « Va-t-en,
imbécile que tu es ! » Et le Comte d'Artois de rire ; mais Berry
explique sa conviction de la survie de Louis XVII, alors son père le reprend vivement :
« Taisez-vous, vous êtes aussi intéressé que nous dans la
question ! » Et Berry sort. Mais, au cours d'un dîner, le Duc de
Berry affirme de nouveau l'existence de Louis XVII et le Roi Louis XVIII, inquiet, convoque son neveu et l'interroge.
Berry : « Sire, on m'assure que Louis XVII existe et, si cela est
vrai, je serai le plus soumis de ses Sujets. » Louis XVIII en colère lui
jette une serviette au visage : « Monsieur, vous êtes un factieux »
et il s'écrie : « Tu veux mettre un bâtard sur le trône ! »
Berry sort, bouleversé ; cette terrible querelle et les menaces du Roi
font dire aux gardes et aux huissiers de l'antichambre : « Le Duc est
perdu. » Nous avons les témoignages des gardes du corps d'Hozier et de Marcoux qui ont tout
entendu par la porte entr'ouverte.
Le Duc de Berry rentre chez lui, très ému, et il
dit à sa jeune femme avec impatience de ne pas sauter sur un pied comme une
écolière ; alors Marie-Caroline, en riant : « Je suis
jeune ! Ne me parle pas encore une fois de veuvage ! » Et Berry, très sombre : « J'ai tort mais c'est
une idée fixe ! » Trois jours après, il était assassiné par Louvel à la sortie
de l'opéra[61] ; c'était le 13
février l820 et le duc avait écrit à Naundorff le 3
février ! Martin avait
annoncé « un si grand trou dans la couronne si le Roi ne fait pas ce qui
est dit que cela le mettra tout près de la ruine ! » Et dans les
Mémoires d'Aimée de Coigny, nous lisons : « Le couteau de Louvel
frappa le soir ; le Roi, prévenu, va se coucher, son entourage en est
stupéfait. Pendant ce temps, le Ministre Decazes force le
secrétaire du Duc de Berry et prend ses papiers, puis le Roi va à l'opéra
auprès de son neveu, à 5 heures du matin. »
Après ce drame qui oblige Louis XVIII à se séparer
de Decazes, la renommée de Martin se répand
partout ; mais la jalousie des gens de Gallardon oblige le
paysan à se réfugier à Saint Arnoult chez le curé Appert ou bien à Versailles
chez Madame Marco de Saint Hilaire[62] :
il n'ose plus rentrer chez lui.
Martin est reçu
dans la meilleure société du boulevard Saint-Germain et fréquente la noblesse.
On l’invite comme une attraction étonnante et après n’avoir été que
visionnaire, il devint prophète : il prédisait l’avenir.
On doit
croire à la sincérité de Martin. Dans le cas contraire il lui eût été facile et
profitable d’affirmer que l’ange, visible pour lui seul, continuait à le
visiter : or, pas un document sérieux ne permet d’incriminer le prophète
de cette hâblerie : il proclame, au contraire, que l’ange ne vient
plus ; Martin assure recevoir tacitement son inspiration.[63]
Sur un seul
point il demeurait obstinément renfermé. Jamais on ne pouvait lui faire révéler
le secret qu’il avait confié au Roi.
Cependant,
les Montmorency-Laval, qui habitent le château d'Esclimont, près de
Gallardon, s'intéressent à Martin, le protègent et laissent entendre que le Duc de
Berry a été
assassiné parce que le Roi n'a pas écouté les avertissements du ciel. Si Louis
XVIII avait
obéi ! Le Roi meurt en 1824, chrétiennement et dans le repentir de ses
fautes ; il laisse d’ailleurs, nous le savons, un testament pour son frère
Charles X auquel il
demande de proclamer roi Louis XVII, c'est-à-dire Naundorff ; est-ce sous l'influence de Martin que le
Roi écrit ces lignes ?
En tout cas,
une cassette fermée est remise au Ministre Villèle et le roi
Charles X, qui a pris
connaissance du testament, réunit un conseil privé auquel il demande son avis.
Les ministres sont d'accord pour proclamer roi le Duc de Normandie, alias Naundorff, mais le Cardinal de Latil feint de ne
voir qu'une fable dans le demande de Louis XVIII et insiste
« pour que Louis XVII ne soit pas reconnu » affirme l’un des témoins.
Les autres conseillers protestent. Alors le Comte d'Artois : « Je ne puis vous cacher que le
fils de Louis XVI existe mais… » « Votre Altesse Royale, en rendant
le trône à qui il appartient fera acte de justice, répond le Vicomte de
Montchenu, et c'est la justice qui sauve les empires. »
On décide
alors de proclamer Roi Charles X qui jugera
ensuite de cette importante affaire. Le nouveau roi semble convaincu que
Naundorff est bien son
neveu mais il réunit de nouveau son conseil privé : Talleyrand - Villèle - Latil. Ils lui représentent les importants intérêts
dynastiques qui sont en jeu : la reconnaissance de Louis XVII risque de
causer de graves troubles en Europe, le jeune prince n'a pas été élevé pour
être roi - il connaît mal la religion catholique - il est marié devant un
pasteur et il a fait une mésalliance - Naundorff exerce un métier manuel - il
ne possède pas parfaitement la langue française - il ignore la diplomatie,
etc., etc.
Un des
ministres : « C'est un roi ouvrier, sire, que allez mettre sur le
trône ! » « Alors, Messieurs ? » dit le roi et le
testament passe entre les mains des conseillers : « Il faut le brûler
immédiatement », dit une voix.
Les
considérations de prudence humaine et les exigences de la politique
l'emportent sur les avertissements du ciel, transmis par le paysan visionnaire,
et sur les droits présumés du fils de Louis XVI. Dans un
dramatique silence, Charles X jette le
testament au feu. Plusieurs témoins attestent ces faits et le Comte de
Beaurepaire cite les membres
du conseil privé du roi, ceux qui étaient présents : le baron Patry, son oncle, ministre de la police, Monsieur de
Brémond, le marquis
de Rignon, intime du ministre Villèle, le comte de
Bruges, le vicomte de Montchenu, le docteur
Alibert, médecin de
Charles X… Tous affirment la vérité de cette délibération et son épilogue :
le testament brûlé !
Cependant
Charles X consultera
aussi le Pape. Celui-ci répond que l'état de la France est fort troublé et que,
pour éviter de plus grands maux, le roi Charles X ne peut faire autrement que
de rester sur le trône…
Et l'affaire
Naundorff rentre dans
l'ombre…
Le marquis
de Sillery persuade
alors Martin qu'il est
libéré de la promesse faite au roi Louis XVIII puisque celui-ci n'est plus, et
qu'il doit révéler tout ce qu'il a dit à Louis XVIII seul à
seul ; le cacher serait une faute grave car la France doit réparer une
injustice qui attire sur elle le malheur. Il faut que Martin fasse connaître
ces graves révélations qu'il avait promis de garder secrètes « un secret
entre Dieu, Louis XVIII et Martin ». Le paysan se laisse convaincre et la
seconde partie de son entretien avec le Roi est bientôt connue de tous. Alors,
une nouvelle se répand en France : Louis XVII va reparaître, Louis XVIII
et Charles X ne sont que
des usurpateurs !
De nombreux
textes, contenant cette fois-ci le secret sont publiés.[64]
La
publication de ce secret eut un effet énorme…, si énorme, que Charles X en trembla.
Jamais il ne voulut voir Martin de Gallardon, mais il envoyait régulièrement des émissaires
pour l’interroger. Charles X conserva toujours à l’égard de Thomas une grande
crainte qui se manifesta sous une forme tangible lors de son abdication.
Nous voici
en juillet 1830 ; un fait inouï, presque invraisemblable se passe :
en trois jours, la monarchie est en grand péril, Paris se bat et Charles X part au
château de Rambouillet avec sa famille. Cependant le roi dispose de 12 000
soldats fidèles avec des canons, qui peuvent résister aux bandes
indisciplinées. De plus, la province ne bouge pas. Les maréchaux demandent les
ordres au roi mais Charles X hésite et n'ordonne rien. Le roi a reconnu,
semble-t-il le châtiment de Dieu, il songe aux prédictions de Martin, aux malheurs prédits à la France, à la mort de
son fils Berry : Martin, dont Charles X connaît fort bien
les avertissements, n'a pas été écouté, le trône n'a pas été rendu au fils de
Louis XVI qui est
vivant… Alors le roi envoie Monsieur de La Rochejaquelein auprès du
laboureur Martin, entre le 1er et le 3 août 1830, fait ahurissant
mais incontestable : un officier envoyé par le roi demande au paysan ce
que Charles X doit faire, Charles X, un dévot de la monarchie, Charles X
convaincu que la légitimité règne en sa personne !
La
Rochejaquelein part en
pleine nuit, suivi de deux écuyers, on galope, à francs étriers, vers Gallardon et ce n'est
pas sans peine que l'aide de camp trouve la ferme de Martin vers deux
heures du matin. Il frappe longuement. Enfin, le bonhomme en chemise et pieds
nus, ouvre sa porte et reste sur le seuil, en haut de trois marches, une lanterne
à la main !
« Monsieur
Thomas Martin, au nom du
Roi. » « Ne prenez pas la peine de vous expliquer », dit
Martin, « L'archange m'a averti qu'on viendrait me consulter : j'ai
la réponse » - Monsieur de la Rochejaquelein reste à
cheval et Martin sur son perron – « Je vous écoute, Martin. » Et
voici la réponse du paysan : « Dites au roi qu'il sait bien la raison
de tous ces malheurs. À présent, il ne peut rien faire quand bien même il
aurait 200 000 hommes de troupe ; il ne réussirait qu'à faire couler
beaucoup de sang. Il faut qu'il parte en exil, il y mourra sans avoir revu la
France ainsi que son fils, le duc d'Angoulême. Henri, son
petit-fils, ne sera jamais roi. »
Telle est la
réponse rapportée au roi par la Rochejaquelein. Martin a même
ajouté : « la branche ne pourra rien faire ; tous ceux qui ont
usurpé le trône, périront misérablement ! »
Et, à son
propre fils qui le répètera, Martin dira que le samedi qui a précédé les
ordonnances de juillet, causes de la révolution, il a entendu une voix terrible :
« La hache est levée, le sang va couler. » Et il a vu comme une main
qui repoussait le Roi de France. Et, le lendemain de la visite de la
Rochejaquelein, Martin aurait vu couler sur un calice trois larmes rouges,
trois noires, trois blanches…
A l'aube,
l'aide de camp revient à Rambouillet et rapporte au roi la réponse du
paysan : Martin n'a pas été
écouté, les malheurs prédits sont arrivés, le roi et sa famille doivent
quitter la France. Charles X écoute en
silence, il se résigne, il signe tristement son abdication, le duc d'Angoulême signe aussi
et puis les princes s'en vont, par Maintenon, la route que Napoléon a prise en
partant pour l'exil, quinze ans avant ![65]
Dans les
Mémoires de Madame de Boigne, nous
lisons : « Le départ du Roi n'a été décidé ni par le Maréchal Maison ni
par Monsieur Odilon Barrot, mais sur les conseils de Martin, le
voyant. » Chartes X se sent-il réprouvé, maudit de Dieu pour avoir occupé
le trône de son neveu ? En tout cas, il envoie La Rochejaquelein à Vienne
avec mission de chercher le roi légitime…
Après
l’avènement de Louis-Philippe, les libéraux et les jacobins voulurent se venger.
Les légitimistes étaient en fuite et on vint faire l’assaut de la maison de
Martin qui avait un
peu trop de relations dans les milieux légitimistes. La population envahit son
jardin, entoura sa maison ; comme on cherchait à lui faire un mauvais
parti, Martin parvint, en se déguisant, à s’enfuir. Il se réfugia chez Mme
Pasquier, l’autre visionnaire qui demeurait à 20 kilomètres
de là, à Saint-Arnoult. Il y resta quelques temps.[66]
L’abbé Jacques-Michel Dubois (décédé en
1853 à 57 ans), curé de Gallardon de 1831 à
1833, puis de 1836 à 1843, ancien confesseur de Martin, naundorffiste convaincu, a laissé à l’évêché de
Chartres de précieux documents sur les derniers moments de Martin, et le début
de l’aventure Naundorff.
La fin de Martin
Le désastre des Bourbon a valu à Martin une renommée
prodigieuse. Il trouve asile chez ses amis, il est aidé par une veuve, Madame
Pasquier, mais il n'ose plus rentrer à Gallardon où il ne
fait que de courts séjours.
Le Comte Gruau de la Barre a écrit page
345 qu’en août 1830 on savait par Martin que
« le Dauphin, fils de Louis XVI, était caché en Allemagne où il faisait une rude
pénitence ; qu’il paraîtrait des imposteurs sous son nom et que sa mission
spéciale à lui, Martin, était de faire distinguer le véritable. »[67]
Vers la fin d’une deuxième neuvaine le 27 septembre 1833, Martin dit à M.
Appert qu’il devait
aller à Paris, qu’il avait reçu des ordres positifs pour aller reconnaître le
Prince, qu’il l’avait vu en révélation, et qu’on lui avait désigné des marques
auxquelles il ne pouvait se tromper.
Martin dit à son
fils : « En ce moment réside à Paris, chez Madame de Rambaud, un inconnu qui se dit le Roi Louis XVII ; mon ange m'engage à m'assurer de son
identité. Je reconnaîtrai à 3 signes : une cicatrice sous le menton, une
forme de lion sur la poitrine, et une forme de colombe sur la cuisse. »
Le lion était effectivement une excroissance de la figure d’un lion
endormi.[68]
Le 26 mai 1833, un pauvre horloger est entré dans Paris ; il arrive
d'Allemagne « sans souliers, sans chemise et sans bas » mais ce
Naundorff est aussitôt
reconnu par beaucoup de personnes de l'ancienne Cour comme le vrai fils de Louis
XVI.
Le 28 septembre, Martin arrive pour
rencontrer Charles-Louis, duc de Normandie, alias Naundorff, au carrefour
Buci, à Paris, à 8 heures du matin. Charles-Louis est encore couché quand le
paysan entre dans sa chambre ; il ouvre les yeux : « Mon cher
Martin » dit-il « Mon Prince », répond Martin et pendant une
heure, seul à seul, les deux hommes parlent et pleurent. Martin dit qu'il
connaît, par révélation, les marques qui se trouvent sur le corps du fils de Louis
XVI ; Naundorff les lui montre et la joie de
Martin est grande. Martin dira : « Je crois que ma mission est
maintenant terminée, que je n’aurai plus de visions, mais, ce qui est possible,
c’est que lui en ait. »
Il ajouta également : « Le Duc de Normandie connaîtra
l'abandon de tous ses partisans ; il sera humilié jusqu'à la confusion. »
Prédiction qui s'accomplira…
En attendant, la vie de Martin, devenu
errante, est profondément troublée ; il entend de terribles voix sans rapport
avec la douce voix de l'Ange ; il lit sur les murs des lettres menaçantes
et mystérieuses. De terribles voix le tourmentent, « s’attribuant le
pouvoir de prolonger et d’accroître ses souffrances s’il reste fidèle à sa
mission. »
Sa tranquillité est finie et Martin va souvent à
Chartres supplier la Vierge miraculeuse de lui venir en aide. Tout est devenu
obscur dans la vie du paysan du jour où il a reconnu Naundorff comme le
fils du Roi ; ce dernier d'ailleurs affirme qu'il ne demande pas le trône
mais seulement la reconnaissance de son identité. C'est aussi le but des
efforts de ses partisans et de Martin.
Le 12 avril 1834, le laboureur part à Chartres faire une neuvaine et, en
partant, il dit à sa femme : « Je sais bien qu'il m'arrivera quelque
chose. J'ignore ce que ce peut être mais je remets tout à la volonté de
Dieu. » Martin a 51 ans, il
n'a jamais été malade mais la voix menaçante qui le persécute maintenant
s'efforce de le faire renoncer à sa mission : la reconnaissance
officielle du fils de Louis XVI.
À Chartres, la neuvaine finie, Martin est saisi de
terribles douleurs d'entrailles, ses lèvres sont brûlantes et il lui semble
qu'on lui arrache les ongles. La voix menaçante le tourmente toujours.
Cependant, le 6 mai, il va mieux et il se prépare à retourner chez lui. Le 8
mai grave rechute ; on prévient sa femme qui accourt de Gallardon et trouve
son mari mort à Chartres où on ne veut pas l'enterrer. Il le sera à Gallardon
le 10 mai.
Naundorff, lui, allait partir à Chartres retrouver Martin quand il
apprend sa mort ; il lui semble revoir le paysan qui lui dit :
« On m'a assassiné à cause de vous. »[69]
Les fils de Martin, persuadés que ce sont les ennemis de leur père qui
l'ont terrifié par des paroles et des inscriptions menaçantes et finalement mis
à mort, demandent une autopsie : celle-ci révèle un empoisonnement ?
Quatre médecins, dont deux étaient de Gallardon, procédèrent à l’examen des viscères :
l’abdomen et l’intestin présentaient, il est vrai, des traces
d’inflammation ; les poumons
étaient le siège d’une congestion sanguine très prononcées ; mais l’état
de décomposition de ces organes ne permit pas de formuler une conclusion nette.
L’histoire de Martin est
terminée.
Tout le cycle des prophéties de Martin de Gallardon semble
s’être accompli.[70]
Amusant :
Longtemps, dans toutes les veillées de la Beauce, les grands-mères parlèrent à leurs petits-enfants du voyage en carrosse du gars Thomas Martin. Après 1900, lorsque les premiers avions firent leurs essais dans la plaine de Chartres, les vieux Beaucerons dirent en parlant des aviateurs : « Ils volent comme Martin de Gallardon ! » Jusqu'à son empoisonnement criminel, Thomas raconta qu'il avait survolé Chartres, Paris, Lille, Londres et Strasbourg dans le carrosse de l'archange Raphaël. Des Anglais qui vinrent le voir furent stupéfaits de l'entendre décrire Londres vu du ciel ! Homme simple, Martin racontait également que l'archange parlait avec d'autres archanges dans une langue inconnue, en utilisant des petits entonnoirs (peut-être des micros) et que de l'intérieur de son véhicule était tout éclairé par des bougies de toutes les couleurs enfermées dans des verres. C'est sur ces deux points précis qu'il fut considéré comme aliéné par l'évêque de Chartres, qui le fit interner. Ils racontaient que les cochers de ce merveilleux fiacre étaient au nombre de cinq et qu'ils avaient les cheveux blonds et les yeux phosphorescents.
Nous sommes convaincue de la véracité des dires de Martin.
Cependant, voici l’intéressant l’avis d’un sceptique :
César de Vesme écrit, dans le numéro 4 de la Revue
Métapsychique (juillet-août 1935), pages 326-328 :
« J’ai sous les yeux l’ouvrage
métapsychique d’un auteur connu par son exaltation anti-religieuse et
révolutionnaire : le Dr Binet-Sanglé. Dans sa Fin du Secret, il s’occupe
assez longuement du visionnaire de Gallardon et,
tout en ne prenant naturellement pas au sérieux son archange Raphaël et sa
mission céleste auprès du Roi, il n’hésite nullement à reconnaître que la
paysan beauceron était doué de facultés de télépathie – nous dirions plutôt de
clairvoyance – et il allègue, pour le démontrer, plusieurs circonstances :
1° Le 9 mars 1816, il annonce qu’il
recevra, ce jour-même, la visite d’un médecin chargé de l’examiner ;
2° Le 11 mars, il comprend la conversation
de deux personnes qui parlent de lui en anglais ;
3° Ce même jour, il annonce une deuxième
visite du docteur ;
4° Il annonce qu’on va prendre des
informations dans son pays pour connaître quelles sont les personnes qu’il
fréquentait antérieurement ;
5° Le 13 mars, il dit que le lieutenant
André, chargé de le surveiller, va le conduire dans une maison pour y être
examiné (à Charenton) ;
6° Martin révèle au Roi que jadis il pensa attenter à la vie de son frère aîné.
Les petites prédictions dont il est question se sont bien réalisées ; il faut cependant reconnaître que quelques-unes – la 4e surtout – pouvaient être prévues normalement, avec un peu de perspicacité et de chance. Pour la révélation du fratricide qui a traversé la tête du futur Louis XVIII, il faut s’en tenir aux dires de Martin et à quelques indices ne revêtant pas la valeur d’une preuve absolue.
Ce qui me semble constituer un plus sérieux indice du fait que Thomas Martin doit avoir réellement révélé à Louis XVIII un secret de provenance apparemment supranormale, c’est l’attitude que le Roi garda jusqu’au bout envers le visionnaire ; c’est surtout l’attitude de Charles X, qui eut assez de confiance en ce paysan pour le consulter comme un Oracle dans une heure suprême de son règne et se décider à abdiquer en recevant de lui une prédiction décourageante. « Ceci est une certitude historique », dit M° Maurice Garçon. A cette heure-là, Thomas Martin a bien été l’arbitre des destinée de la Monarchie française !...
Les biographes favorables à Thomas Martin lui attribuent encore un certain nombre de prédictions réalisées, s’égrainant sur presque tout le cours de sa vie. Il en est une, toutefois, dont je crois intéressant de dire quelques mots. Les biographes du visionnaire sont, en effet, très discordants sur divers points de sa carrière, comme on pense bien, ses partisans le présentant comme une sorte d’envoyé du Ciel, tandis que ses adversaires écrivaient contre lui des pamphlets fondés sur les documents de la police, naturellement adverse à Naundorff et aux siens. Or, voici la version des amis de Thomas Martin.
Dans les derniers temps de sa vie, Martin était tourmenté par l’obsession de « voix intérieures indésirables » et décida de faire une neuvaine pour obtenir de Dieu d’en être délivré ! (Ce en quoi on peut reconnaître des troubles mentaux chez le visionnaire, mais aussi sa bonne foi). Cette neuvaine commença le 8 avril 1834 ; mais bientôt Martin dit aux siens que son « Ange » lui avait annoncé que « cette période de prières serait pour lui la dernière ». Malgré cela, ayant été invité à se rendre à Chartres dans le château de la Comtesse Walou de Lancé, il partit le 12 avril, après avoir recommandé à son fils de réciter journellement certains psaumes. Le 17 avril, dernier jour de la neuvaine, il mourut soudain.
Ses partisans firent grand bruit autour de cette prédiction de mort réalisée. D’autre part, ils manifestèrent ouvertement le soupçon que le Gouvernement l’eût fait empoisonner. La police ordonna alors une autopsie du cadavre : le verdict des médecins fut que Martin était mort d’apoplexie – ce qui, d’un côté, semblait confirmer la réalisation de la prédiction, mais de l’autre côté, innocentait les « séides de Louis-Philippe » du soupçon d’avoir mis fin par le poison aux jours du visionnaire. L’autopsie n’a d’ailleurs pas suffi à convaincre les amis de Martin de l’absurdité de leurs accusations ; la comtesse Walou de Lancé fut elle-même soupçonnée par eux de complicité dans le prétendu meurtre et eut à supporter par là beaucoup d’ennuis. »
Pour terminer, voici un article de l’Echo du Merveilleux, du 15 mars 1904, signé Timothée :
« M. le docteur Martin, qui vient de mourir, me donna, il y a plusieurs années, les renseignements suivants :
Le docteur Duval remit le cœur du voyant au véritable Louis XVII (Naundorff) pour la cause duquel le paysan de Gallardon était mort martyr. Quand il dut quitter la France, le prince méconnu, craignant de perdre cette précieuse relique dans les hasards de cette vie persécutée, la confia aux soins pieux de Mme Pasquier. « Gardez-moi bien ce dépôt, lui dit-il, je ne vous le donne pas. » Le malheureux Naundorff mourut en 1845 sans avoir pu revoir Mme Pasquier. Celle-ci cacha longtemps dans sa cave le cœur du voyant de Gallardon. Quand elle se sentit non loin de sa fin, elle dit à l’aîné de ses enfants : « Vous remettrez ceci à la famille Martin. » Charles Francheterre, allié du voyant, reçut ce souvenir du fils aîné de Mme Pasquier. En 1856, ou vers cette année, il le remit à Antoine Martin. Au mois de mai 1857, les trois demoiselles Breton, ainsi que d’autres témoins, reconnurent que de cette relique il suintait du sang. Le cœur était renfermé dans une enveloppe de toile. « Vous ne pouvez l’emporter ainsi, dit une de ces demoiselles à Antoine Martin ; nous allons l’envelopper dans du velours. » Elles s’acquittèrent promptement de ce soin pieux.
Depuis, chaque année, au commencement de mai, anniversaire de la mort mystérieuse de Thomas Martin, son cœur augmente de poids et de volume. Cette augmentation a lieu aussi quand un évènement mémorable vient d’avoir lieu. M. Antoine Martin, durant un mois, m’a fait constater que le cœur de son père était desséché et remuait dans une enveloppe de métal recouverte de velours.
Je n’ai pas eu l’occasion de vérifier le fait prodigieux dont il me parlait. Mais, paraît-il, plusieurs personnes en pourraient témoigner.
NOUS SOMMES PRECISEMENT L’UNE D’ENTRE ELLES.
M. Antoine Martin m’a déclaré qu’il désirait qu’on parlât pas du cœur de son père tant que lui-même serait vivant, parce qu’il ne pourrait supporter de sang-froid les insultes d’ennemies dénuées de loyauté…
Il resterait à constater ce prodige d’une manière authentique ; par exemple en plaçant le cœur dans un récipient bien clos et cacheté, devant témoins, et en faisant signer un procès-verbal qui constaterait son poids ; puis en le pesant de nouveau à l’anniversaire du décès, devant les mêmes témoins. »
V] Le Sacre de Charles X
Avant toute chose, nous savons que Louis XVIII ne s’est pas fait sacré. Pourtant, des préparatifs avaient été faits.
Du Journal de Paris, 28 juin 1816 :
« Tout annonce que l’auguste cérémonie du sacre de S. M. aura lieu dans le cours de l’été. Déjà l’on s’occupe de dessins d’après lesquels sera disposé le décor de la cathédrale de Reims pour ce jour solennel. »
Qui a empêché l’exécution de ce projet ?
Du Moniteur Officiel, 16 janvier 1819 :
« On assure que le sacre de S. M. est fixé le 3 mai, jour à jamais mémorable dans nos annales par le retour du Roi en 1814. »
Qui s’interpose ?
Du Constitutionnel, 29 janvier 1819 :
« Le sacre du Roi n’aura lieu, dit-on, que le 15 août prochain, jour de l’Assomption. »
Qui oppose toujours son veto ?
Du Moniteur, 24 mai 1819 :
« Le 25 août, jour de la fête de S. M., est désigné pour l’auguste cérémonie de son sacre. Toutes les commandes nécessaires ont été faites pour cette époque et la commission chargée de régler tout ce qui a trait au cérémonial dans cette grande solennité a terminé son travail. »
Qui se dresse encore contre la volonté royale ?
C’est bien établi par l’histoire : les préparatifs du sacre étaient faits et ils furent contremandés après la venue de Martin de Gallardon aux Tuileries. Si Louis XVIII n’est pas un usurpateur, pourquoi lui défendre de se faire sacrer ?
On objectera peut-être : Charles X reçut le sacre et il n’a pas été frappé de mort.
Tout d’abord, la menace de mort concernait Louis XVIII uniquement.
Remarquons également qu’il s’en est peu fallu que Charles X ne perdit la vie en allant se faire sacrer à Reims : chevaux emportés, gentilshommes d’atours grièvement blessés ; mort subite du prélat qui devait prononcer le discours du sacre.[71]
Enfin, comme le remarque Charles Saint-Mémoire, « Charles X ne fut pas aussi coupable. Il continua une usurpation déjà commencée. Et puis Louis XVIII, qui a reculé devant cette profanation, régna dix ans et mourut sur le trône. Son frère au contraire vit le sien s’effondrer au lendemain d’une victoire éclatante. »[72]
Le Comte de Cornulier-Lucinière écrivait à la Légitimité cette lettre datée du 21 mars 1905 :
« Monsieur le directeur,
Le R. P. Henry de Régnon vient de me dire, il y a deux jours, que, pendant le conseil privé qui eut lieu après la mort de Louis XVIII, auquel assistaient Talleyrand, de Villèle, Mgr de Latil, etc., la phrase suivante fut adressée au comte d’Artois : « La charade est finie. A vous de voir si vous voulez continuer la comédie. »
Le R. P. Régnon tient ce fait inédit de son père, le marquis de Régnon, ami intime de M. de Villèle. Ce dernier ajouta que Mgr Latil avait insisté pour que Louis XVII ne fût pas reconnu, en disant qu’on ne pouvait pas appeler au trône de France un prince protestant.[73]
Comment le marquis de Régnon en savait-il si long ? Voici :
Le grand-père du R.P. de Régnon, M. de la Porte-Lalanne, habitait avec ses filles, la marquise de Régnon et Mme Alphonse de la Bouillerie, le pavillon de Flore, en qualité de directeur de la commission de restitution des sépultures royales de Saint-Denys. Son salon était assidûment fréquenté par les notabilités politiques, littéraires et religieuses les plus en vue. Des ministres et d’anciens ministres s’y coudoyaient avec le chancelier Dambray. On y causait de tout.
Le marquis de Régnon a beaucoup connu M. Franchet, préfet de police, lequel disait, en souriant, qu’il connaissait les noms des gens des quatre parties du monde.
Comme on le voit, le marquis de Régnon était bien placé pour collectionner les renseignements les plus sûrs.
Son fils, le Père Henry, est né aux Tuileries.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’assurance de mes plus distingués sentiments,
Comte de Cornulier-Lucinière,
Général de division en retraite. »
Cet important témoignage corrobore de façon la plus frappante les déclarations de M. Brémond, ancien secrétaire de Louis XVI, devant le tribunal de Vevey :
« Louis XVIII, dans un document écrit et signé de sa main, fit un récit de la vie de son neveu, le duc de Normandie, et il fit un devoir à son frère de le reconnaître et de le proclamer roi de France. Ce papier extraordinaire fut fermé dans une cassette anglaise à double fond, qui était placée dans son cabinet, et dont une dame, autre que la dame de qualité, avait la faveur de tout voir à son gré. Une personne[74], qui s’occupait alors de l’Orphelin du Temple pour le produire sur la scène, et à qui elle avait déjà procuré des pièces importantes pour de l’argent, reçut de sa part, en 1820, la confidence du secret déposé et l’offre de lui confier la cassette de minuit à minuit, moyennant la somme de cent mille francs, déposée et acquise en remettant la cassette. Cette personne en parla au comte d’Artois qui accepta l’offre, sous la réserve de la soumettre à un grand magistrat qui avait sa confiance, et qui, s’il l’approuvait, recevrait la cassette et en ferai l’examen : le magistrat n’approuva pas et motiva son refus, malgré les avantages de connaître les résolutions prises, pour préparer les moyens de les déjouer.
En 1824, la même personne, voyant Louis XVIII près de mourir, fit une visite à M. Franchet (préfet de police), lui raconta l’histoire de la cassette de 1820, l’invita à vérifier lui-même si elle était toujours à sa place, à en rendre compte à Monsieur et à prendre ses ordres. Elle existait, fut gardée à vue, et, au moment de la mort, elle fut remise à M. de Villèle et aux deux autres ministres pour en faire l’examen. Si j’en suis bien informé, les trois ministres furent d’accord de proclamer le duc de Normandie ; mais ils crurent devoir consulter le cardinal de Latil qui, feignant de ne voir qu’une fable dans le récit de Louis XVIII, décida que Charles X devait être proclamé dans l’instant, en lui laissant le soin de juger cette affaire. Cet avis fut suivi, et si je suis bien informé encore, Charles X examina réellement l’affaire, se convainquit de la vérité, et il eut la faiblesse de céder à de faux intérêts dynastiques. »
Dans la Légitimité du 1er avril 1905, pages 250-251, nous lisons :
« Dans les deux témoignages que nous venons de reproduire, le premier inédit, le second déjà connu, il est question de M. de Villèle. C’est donc bien le moment de publier les lignes suivantes que nous adressait le 30 juillet 1902 Mme A. Bellier de Villentroy, née de Villèle, petite-nièce du ministre de la Restauration :
« A titre de renseignement, je puis vous dire qu’il y a une quarantaine d’années, causant avec mon père de Naundorff dont un journal avait parlé, je lui posai la question : « Mais vous, mon père, qui avez vécu dans votre jeunesse pour ainsi dire à la cour, puisque vous avez été confié à mon oncle de Villèle, ne lui avez-vous jamais demandé ce qu’il pensait de ce personnage ? – Si, il m’a répondu par ces seuls mots : « C’est un secret d’Etat. » Je sais aussi que mon oncle, qui ne cachait rien à sa femme, lui avait caché ce secret d’Etat, ce qui lui faisait de la peine. »
Si mon père avait vécu (il est mort en 1881) et s’il avait pu lire tous les documents que je possède aujourd’hui sur la Survivance du Roi Martyr, je puis vous affirmer qu’avec sa nature si franche et loyale il se serait rendu de suite à l’évidence et aurait été un de ses plus chauds partisans… »
D’ailleurs, de nombreuses « sommités » de l’époque n’étaient pas dupes.
« Il régnait à cette époque, parmi les sommités du clergé et des royalistes, une étrange superstition de légitimisme. Des évêques, des aumôniers du roi, des nobles illustres regardaient Charles X comme un usurpateur. Tels de ses chapelains, que nous avons connus, ne le nommaient plus dans le canon de la messe.
L’évêque Tharin, précepteur du Comte de Chambord, passait pour être dans les mêmes sentiments… »[75]
Certains diront peut-être : « Pourtant, Charles X a guéri les malades lors de son sacre, donc il est légitime. »
Monseigneur Delassus écrit, dans Problèmes de l’Heure présente (Tome II, page 606) :
« Plusieurs personnes avaient été d’avis de supprimer cette cérémonie pour ôter un prétexte aux dérisions de l’incrédulité, et l’on donna l’ordre de renvoyer les scrofuleux. Ils se lamentèrent, le roi envoya une somme d’argent à leur distribuer. Ils dirent que ce n’était point cela qu’ils voulaient. M. l’abbé Desgenettes, qui était logé à Saint-Marcoul, voyant leur désolation, alla plaider leur cause, et le roi annonça sa visite pour le 30 mai à l’hospice. »
Voici maintenant un extrait de la Ruche catholique de Pau du 15 janvier 1883 :
« Sur ce point, j’offre à M. Jean de Meillon, le témoignage d’un témoin oculaire, relativement à Charles X, celui de M. Cahier père, joaillier, ancien orfèvre de la cour :
M° Amédée Nicolas, avocat, rue Sénac, 64, Marseille, m’écrivait le 19 septembre 1882 : « Charles X a été sacré, mais il n’a pas guéri les malades. Il s’est trouvé… qu’il y a eu malentendu. Les malades se sont trouvés ailleurs que là où ils auraient été touchés par le Roi. Le Roi n’est pas allé où ils étaient (quand il l’a appris) ; les malades sont partis ; ils n’ont pas attendu, croyant que le Roi ne viendrait pas. Je tiens cela de M. Cahier père, qui assistait au sacre. Les malades avaient été placés à Saint-Marcoul d’abord, puis ailleurs. »
Il paraît cependant que plusieurs malades restèrent et que le Roi, après de longues hésitations, les toucha. Cinq guérisons furent constatées, dit-on, et on en publia les procès-verbaux dans l’Ami de la Religion (du 9 novembre 1825, Tome XLV, page 401.)
Les soeurs de l'hospice Saint-Marcoul suivirent les malades et établirent
un procès-verbal attesté par le Dr Noël. Sur les 130 présentés, seul cinq
d'entre eux ont été « guéris ».
Cependant, si nous regardons bien ce rapport, le médecin
certifie « qu'il n'a été employé pour leur guérison que le traitement habituellement en usage » ! Autrement
dit, le toucher royal n'était pas exclusif et les malades avaient reçu des
soins parallèles. Voici donc des gens qui furent très probablement des
miraculés... de la médecine…[76]
Examinons maintenant si le Saint Chrême utilisé lors du sacre de Charles X fut le vrai Saint Chrême.
Clovis fut baptisé et sacré roi des Francs par Saint Rémy, dans la nuit de Noël 496, par un baume, le Saint Chrême, apporté par une colombe. Ce baume avait la particularité de se reconstituer miraculeusement après chaque prélèvement.
Le conventionnel Ruhl brisera, place Royale à Reims, le 8 octobre 1793, l’ampoule de Saint Chrême à coup de marteau, supprimant ainsi l’élément surnaturel du sacre des rois de France.
Pour valider le sacre de Charles X, en 1825, il fallut admettre que l’abbé Seraine avait dérobé une parcelle du baume et qu’on pouvait la faire fructifier légitimement. Ce qui en restait devait être enfermé dans une nouvelle ampoule, enrichie de pierreries, que l’on conserve encore à Reims.
Mais en fait, Ruhl n’a brisé « pour la galerie » qu’une fausse ampoule de baume. La véritable ampoule resta dans la famille du conventionnel, pendant près de deux siècles. Ses descendants la remirent, avec soulagement, au général de Gaulle lors d’un de ses passages à Reims aux environs de 1960. Ce dernier la confia « à qui de droit », dixit le général.
Ce fait a été rapporté par Jacques Bergier, ancien compagnon de la libération, qui le tenait personnellement d’un tête-à-tête avec Charles de Gaulle, qui lui confirma le fait. Il paraît que l’entretien fut court et glacial.
Voici ce que l’on peut lire dans le livre d’Eric Muraise : Histoire et légende du Grand Monarque, (Albin Michel, 1975) pages 216-217 :
« Ayant lu la première version de ce livre, il (Bergier) voulut me voir. Je le rencontrai à Paris en 1968, c’est-à-dire du vivant du général de Gaulle. Alors il me certifia que l’Ampoule du Sacre existait toujours et qu’elle avait été soumise par voie collatérale dans la famille du conventionnel Ruhl « et vous ne pouvez savoir tous les malheurs qu’ils en ont tirés », ajoutait-il avec ce sourire curieux qui le caractérise. Pour « l’homme qui savait », le sacre de Charles X n’était qu’une farce conventionnelle, sans caractère authentique. « Vous savez d’ailleurs quel pauvre roi cela fit ! » commentait-il non sans satisfaction. J’osai alors lui demander ses preuves et voici l’histoire fantastique qu’il me confia.
Les descendants collatéraux des Ruhl auraient remis l’Ampoule du Sacre au général de Gaulle lorsqu’il passa à Reims, au cours de ses voyages de chef d’Etat. « L’homme qui savait » ajouta : « J’ai voulu en avoir le cœur net. Je suis Compagnon de la Libération dont le Général est Grand Maître. J’ai le droit de lui demander une audience. J’ai usé de ce droit et il m’a reçu. » Alors se déroula cette conversation quasi lapidaire :
« Mon Général, est-il vrai qu’au cours de votre dernier passage à Reims, on vous ait remis l’authentique Ampoule du Sacre ?
_ C’est exact, monsieur.
_ Puis-je vous demander ce que vous en avez fait ?
_ Oui. Elle est entre les mains de qui il convient. L’audience est terminée. »
Je n’ai aucune raison de croire que « l’homme qui savait » (Bergier), malgré son humour caustique, ait eu l’intention de me tromper. Il ne m’aurait pas fait faire mille kilomètres pour cela. Il attendait de moi que j’use de sa confidence dans le sens même où mon livre l’avait attiré. C’est fait ! Mais à dire vrai, ni lui, ni moi, n’aurions osé le faire du vivant du Général. »
D’après Michel Morin, le général de Gaulle n’a pu remettre cette Sainte Ampoule qu’au Vatican ou à un haut dignitaire de l’Eglise de France, mais le mystère reste entier.
Le baume de la Sainte Ampoule, dont on s’est servi, lors du sacre de Charles X en 1825, n’était donc pas le Saint Chrême original de Saint Rémy.
Comme l’écrit Eric Muraise, « tous les partis pouvaient porter au Dauphin un très grand intérêt diversement motivé. Les royalistes légitimistes de l’intérieur et les réseaux Atkins-Cormier ne pouvaient que lui vouloir du bien, les émigrés et les réseaux du genre de celui d’Antraigues pouvaient être plus indifférents, car après tout, le « parti des oncles » accédait aux pleins pouvoirs par la mort du Dauphin. Par contre, tous les républicains pouvaient concevoir que détenir le Dauphin « au privé » c’était prendre une sérieuse assurance au cas où la Révolution tournerait mal, et ils étaient le mieux placés pour réaliser une substitution. Mais pour tous, tuer le Dauphin ce n’était pas supprimer la Monarchie. Après Louis XVII, il y aurait encore les oncles, et, à défaut des oncles, les cousins.
Il n’est pas possible d’affirmer si Ruhl avait agit en liaison avec Hébert et Chaumette, parfaits gauchistes comme lui. Mais son geste, par rapport à l’affaire du Temple, montre que l’on avait envie de supprimer en apparence ce qui pouvait constituer un otage capital. Car ce qui peut être vrai pour le Dauphin l’est encore plus pour l’ampoule du Sacre.
Le Dauphin n’avait de valeur que par lui-même ; l’ampoule était l’otage de tous les rois à venir... »[77]
Pour clore ce chapitre, terminons par ce petit texte :
« Don Jaime de Bourbon, fils de Don Carlos, est le chef aîné de la branche masculine des Bourbons d’Espagne, et que, par sa grand-mère maternelle, la Duchesse de Parme, sœur du Comte de Chambord, il descend directement de Charles X.
Dans La Croix du 19 août 1930, voulant démontrer qu’en 1830 le sentiment populaire était favorable à Charles X, Don Jaime écrit ce qui suit :
« Le peuple catholique ne s’y trompait pas, et à ce point de vue, les visions de sainte Catherine Labouré sont, même pour l’incroyant, un témoignage historique de ce qu’il pensait : Je pleure, fait dire à la Vierge l’humble paysanne bourguignonne devenue Fille de la Charité, je pleure parce que le trône légitime va tomber. »
Ainsi, selon Don Jaime, le Ciel lui-même s’est prononcé en faveur de la légitimité du trône de Charles X !!!
Or, nous avons sous les yeux le texte original des paroles recueillies par la voyante le 18 juillet 1830, peu de jours par conséquent avant la Révolution qui se préparait. Ce texte est reproduit à la page 48 de l’ouvrage tout récent de M. l’abbé Crapez, intitulé : La Vénérable Catherine Labouré.
Voici le passage :
« Mon enfant… les temps sont très mauvais. Des malheurs vont fondre sur la France : le trône sera renversé ; le monde entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes (la Sainte Vierge avait l’air très peiné en disant cela) ; mais venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont… »
Le texte original, on le voit, n’a qu’une ressemblance assez discutable ave celui de Mgr le Duc de Madrid, et le mot « légitime », qu’il convient d’écrire après celui de trône parait dû à sa seule initiative… »[78]
VI] Les voyants de La Salette
1) Mélanie Calvat
En lisant certaines lettres de Mélanie Calvat au chanoine de Brandt, certaines personnes pourraient penser que Mélanie Calvat croyait que Naundorff n’était pas Louis XVII. Par objectivité, nous allons mettre ci-dessous toutes ces lettres :
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Castellamare, 29 janvier 1883.
« J’ai reçu hier un petit journal : La Légitimité. Le bon Monsieur Rigaud aura, sans doute, encouragé cette publicité ; mais nous ne devons pas perdre notre temps dans ces affaires. Dans ce moment, la France ne veut pas de roi ; et quand le moment sera venu, Dieu trouvera le roi à donner à la France humiliée jusqu’au centre de la terre. Les frères de Madame la Princesse Amélie sont tous protestants, et celui qui s’est fait baptiser il y a quelques années ne l’a fait que pour pouvoir plus facilement monter sur le trône de France, et non par principe de foi et de religion. Quand la France sera catholique, elle voudra un roi foncièrement catholique. »[79]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Castellamare, 14 avril 1884.
« M. Roubaud tombe dans l’espace avec ses Naundorff. Il me semble qu’il n’y a plus de trois mois que ce dernier a reçu le baptême. Or, recevoir le baptême pour avoir une couronne mortelle, ce n’est pas l’acte d’un vrai chrétien. Quand il sera temps, le bon Dieu procurera à la France la personne qu’il lui faudra ; pour le moment elle ne veut personne, pas même le bon Dieu. Notre affaire à nous c’est de prier, supplier le bon Dieu d’avoir pitié de notre état et de nous faire miséricorde. »[80]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Castellamare, 29 avril 1884.
« Avec votre bonne lettre j’ai reçu celle du bon monsieur Roubaud que j’ai lue avec tristesse de cœur : et je me disais à moi-même : Eh ! Comment un prêtre, un ministre de Jésus-Christ, un Prince de la maison royale de Dieu peut-il avoir tant d’intérêt pour une personne inconnue qui se dit être le grand Monarque ? Eh ! Fût-il vraiment un prince légitime, en ce moment de crise, de bouleversement européen où les hommes font la guerre à Dieu, à la religion, blasphèment le saint nom de Dieu et se livrent avec frénésie à toutes sortes de passions, se trouve-t-il encore des prêtres qui cherchent un libérateur en dehors de Dieu ? Comment le clergé entier n’est-il pas occupé à prier, pleurer et faire pénitence ? Ne le voit-on pas user les gradins des saints autels, demandant grâce, miséricorde au Seigneur et la force de pouvoir verser son sang pour la foi ? Et par conséquent, ne le voit-on pas occupé à confesser, à instruire, encourager et consoler les âmes ?
Je sais bien que, ordinairement, le bon Dieu se sert des hommes pour rétablir l’ordre et la paix, comme il se servit de Napoléon Ier, dans le temps de la Terreur ; et il se servira encore des hommes comme autrefois jusqu’à la fin du monde. Mais, qui doit nous envoyer cet homme ? N’est-ce pas Dieu ? Et Dieu nous donnera un roi, et un roi auquel on ne pense pas, et il nous le donnera après les fléaux petits et grands, après que le sang sera versé et il ne sera versé ni cette année, ni l’année prochaine, ni l’année d’après. Mais Dieu ne cessera pendant cette période de nous punir, tantôt à un endroit, tantôt à un autre, et cela par pure miséricorde, pour nous faire entrer en nous-mêmes et nous convertir. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, je croirais me défier de la bonté du bon Dieu envers nous, si je m’occupais du Roi futur, surtout en ces temps-ci, où nous devrions, la face contre terre, prier, supplier le bon Dieu d’avoir pitié et miséricorde de nous.
[…]
P.-S. – Par la lettre de M. Roubaud il me semble qu’il a son parti-pris pour Ch. N. Je n’ai pas cru devoir entrer en discussion avec lui : je crois que c’est inutile.
Le prince Charles ne pensait pas à entrer dans notre religion. Madame Amélie fut conseillée par quelques prêtres (deux ou trois) disant que l’on trouverait des difficultés que le Prince Charles fût protestant, qu’il fallait donc l’induire à se faire catholique. Mme Amélie partit et alla rejoindre le prince Charles, qui ne se rendit aux prières de Mme Amélie que quelques années après et quand il vit son parti s’augmenter ? (Cela reste entre nous). »[81]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Cannes, 10 octobre 1885.
« On m’a écrit de Lyon que la nouvelle Jeanne d’Arc [Mathilde Marchat][82] a son drapeau et sa brillante armure : elle rentrera en France avec deux cent mille soldats Hollandais et Américains ; elle ira prendre le grand roi (Naundorff), le fera baptiser avec grande pompe, et puis détruira tous les ennemis de la Sainte Eglise. J’ai répondu que si la France, le front dans la poussière, faisait la pénitence des Ninivites (quoique elle soit plus coupable), sa pénitence serait sa Jeanne d’Arc ; que sans cela il n’y a pas de Jeanne d’Arc pour la France : il n’y a que de grands châtiments. »[83]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Cannes, 29 janvier 1886.
« L’abbé Rigaud, après plus d’un an de silence avec moi, m’a écrit et est toujours de plus en plus plongé dans ses Naundorff et dans sa Jeanne d’Arc moderne. Patience. »[84]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Cannes, 31 janvier 1886.
« C’est bien fâcheux que les pauvres Naundorff se croient quelque chose de grand ; et, malheureusement, on les berce dans l’espoir qu’ils monteront sur le trône de France. Nous n’avons besoin, en ce moment, que de réparation, de pénitence et de revenir sincèrement à Dieu. »[85]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Le Cannet, 13 août 1888.
« Dernièrement, M. l’abbé Rigaud a, de nouveau, écrit à une personne que, plus que jamais, il est convaincu que le roi de France est son N. Charles XI. Cela fait pitié que ce pauvre prêtre, qui d’ailleurs serait si bon, s’égare dans cette affaire. »[86]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Le Cannet, 26 octobre 1888.
« Je ne sais, mon très Révérend Père, que cela : le Préfet de la Sacrée Congrégation maintient l’ordonnance de Mgr l’Evêque de Chartres au sujet de la voyante [Mathilde Marchat]. En conséquence elle est privée de la communion ; non seulement elle, mais encore sa Supérieure, les autres sœurs, le portier et sa femme. Voilà donc Naundorff arrêté dans sa course ; mais il sera aussi bien arrêté par sa propre sœur, Marie-Antoinette : peu à peu le jour se fait sur cette famille, non pour autre chose, mais par les travers de l’inconduite des princes. A Dieu tout est présent.
Je suis bien fâchée que Mgr de Grenoble… se soit fourvoyé avec sa fausse visionnaire de Diémoz. »[87]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Marseille, 7 novembre 1890.
« Le pauvre M. Rigaud me fait regret : l’état d’abandon et d’isolement où le laisse son évêque me navre le cœur. Il me semble que depuis quelques temps il ne parle plus des Naundorff ; et puis s’il y croit ce n’est pas un crime ; tandis que c’en est un de dénigrer un prêtre et de l’exposer à souffrir de la faim. Il y a assez de prêtres qui parlent du Comte de Paris, qui, comme personne, vaut peut-être moins que les Naundorff. Mais, d’après ce que m’écrit M. Rigaud, ce n’est pas à cause de ses opinions politiques qu’il est persécuté, mais seulement parce qu’il prêche la dévotion à Notre-Dame de la Salette. »[88]
Une lecture attentive de ces lettres nous montre que dans aucune de celles-ci, Mélanie affirme que Naundorff n’est pas Louis XVII. Elle se montre juste, à l’époque, hostile à un soutien politique des Naundorff.
En effet, Mélanie Calvat croyait bien que Naundorff était Louis XVII.
Voici une lettre de Mélanie de La Salette du 12 juin 1895 à Mlle Vernet :
« Ordinairement je vais à la messe de
quatre heures. Ce matin, voulant autant que possible me rapprocher en union
avec mes amis de Paris, je suis allée à la dernière messe qui se dit à huit
heures ; et la communion, comme de juste, je l'ai faite en action de grâces
pour l'heureuse évasion du Dauphin Louis
XVII. »[89]
(Si l’évasion du Dauphin n’a aucune incidence
pour l’histoire future, pourquoi Mélanie est-elle heureuse de ce fait ?)
Mélanie Calvat affirme également : « Le grand triomphe de l’Eglise se verra sous la Pasteur Angélique avec l’Ange terrestre de la Survivance du Roi Martyr. »[90]
Mais surtout, voici ce que l’on peut lire, dans le Journal de l'Abbé Combe, Dernières années de Sœur Marie de la Croix, Bergère de la Salette, Editions Pierre Téqui, 1978, pages 176-177 :
« - Pour la deuxième fois, elle aborde la question des Naundorff, mais cette fois-ci elle l'aborde d'une façon peu banale.
- Mon
Père, vous savez qu'il n'y a pas de famille d'Orléans ? Que les princes
d'Orléans ne sont pas des Bourbons ?
- Comment peut-on savoir avec certitude ? Vous voulez parler de l'affaire Chiappini ?
- Vous savez pourtant ce qui s'est passé !
- Je sais ce qu'on raconte avec documents à l'appui, mais il faudrait davantage pour que je dise, c'est certain ! Savez-vous par révélations que cet échange d'enfants eut lieu ? Répondez sans détour.
- Oui,
mon Père, vous savez, reprit-elle, que la famille Naundorff descend de Louis XVII.
- Je vous fais la même réponse, je n'en ai pas
la certitude absolue. Dieu vous
l'a-t-il révélé ?
- L'Histoire suffit, mon Père, pour vous convaincre sans recourir à une révélation.
- Il peut y avoir des dessous que j'ignore.
Répondez donc à ma question. Votre « Frère » [c’est ainsi que Mélanie nommait l’Enfant Jésus, qu’elle voyait
quotidiennement] vous a-t-il dit qu'ils
descendent de Louis XVII ?
- Oui, mon Père.
- Me permettez-vous de faire connaître votre réponse à leurs partisans ?
- Pas maintenant, mais après sa mort.
- Monteront-ils sur le trône ?
Elle a refusé de répondre. En vain j'ai tourné autour de la question pour deviner sa pensée ; elle a échappé à mes ruses ; je n'ai obtenu d'elle qu'un peut-être. Elle m'a laissé ignorer si les Bourbons sont définitivement rejetés ou s'ils le sont conditionnellement. Elle semble reprocher à la famille de ne pas se convertir sincèrement au catholicisme sans aucun motif politique (voir ses lettres).
- Je
crois pourtant ma Sœur, que vous avez encouragé la princesse Amélie [fille
de Louis XVII] à espérer.
- Non, mon Père. J'ai reproché à la famille [Naundorff descendant de Louis XVII] de se convertir dans le but de remonter sur le trône. Ce motif ne plaît pas à Dieu.
- Alors
si l'héritier, l'aîné de la famille était un très bon chrétien, Dieu pourrait
lui rendre le royaume de ses Pères ?
- Peut-être (elle a positivement refusé de dire oui). »
Mélanie Calvat croit que Naundorff est Louis XVII.
Cependant, elle semble, à son époque, réservée sur la possibilité d’un retour des descendants de Louis XVII-Naundorff sur le trône.
La première des raisons, c’est que la plupart des correspondants et amis prêtres de Mélanie Calvat étaient naundorffistes, et que certains d’entre eux croyaient vraiment que le prétendant naundorffiste d’alors, Charles XI de droit, allait monter sur le trône. Et elle savait très bien que Charles XI n’allait pas monter sur le trône, que les temps n’étaient pas encore venus pour qu’un roi de nouveau règne.
De plus, certains des amis naundorffistes de Mélanie, étaient naundorffistes parce qu’ils croyaient à des voyantes qui avaient pris fait et cause pour Charles XI et qui voyaient en lui le Grand Monarque. Ces voyantes (Mathilde Marchat de Loigny, Marie-Louise de Diémoz et Joséphine Reverdy), croyait-elle, étaient abusées par le Malin.
Elle écrit ainsi par exemple à M. le Chanoine de Brandt :
« Galatina, 22 novembre 1892.
M. l’abbé Rigaud a été trompé par les Naundorff et par la voyante de Loigny. Je crois avoir fait auprès de lui ce que, devant Dieu, je croyais bon pour l’en détourner, et suis allée jusqu’à lui dire que je refuserais ses Annales, si j’y lisais encore de la politique. Je ne pouvais pas trop lui parler clair, à cause de sa précipitation à imprimer mes lettres, tout en atténuant certains passages qui ne lui plaisaient pas ! Que de fois il m’avait promis de ne plus rien écrire sur les Naundorff… mais la tentation était trop forte chez lui. Que Dieu l’éclaire et l’éloigne une bonne fois de sa Geneviève de Loigny. »[91]
Elle savait très bien que Mathilde Marchat de Loigny abusait ses partisans, quand elle prédisait que Charles XI serait le Grand Monarque.
Enfin, elle ne voulait pas que l’on s’occupe de politique pour faire monter un roi sur le trône, mais elle voulait et insistait d’abord sur l’importance de la pénitence, de notre propre conversion et la conversion des pêcheurs, avant de s’occuper de politique humaine. Comme elle l’écrit à un curé :
« Castellamare, 3 novembre 1881
Monsieur le Curé,
… Nous sommes trop dans le matériel, nous pensons trop à la manière humaine. Ce ne seront pas les hommes qui mettront le Roi sur le trône de France. Ce sera le bon Dieu qui le conduira quand la France aura été lavée ; elle en a besoin ; maintenant la boue lui couvre les yeux et elle n’est pas en état de comprendre et d’être dans la vérité… »
Les 4 principaux correspondants de Mélanie Calvat, et pour lesquels elle manifeste la plus grande vénération et la plus vive sympathie sont : le chanoine de Brandt, l’abbé Le Baillif, l’abbé I.-F. Roubaud, l’abbé Combe.[92]
Tous sont naundorffistes, sauf le chanoine de Brandt, qui est seulement survivantiste.[93]
Il faut ajouter également comme ami naundorffiste de Mélanie l’abbé Hector Rigaux (1841-1930), curé d’Argoeuves (diocèse d’Amiens)[94] ; Mgr Ernest Rigaud, prêtre du diocèse de Limoges, directeur des Annales des Croisés de Marie ; et le chanoine de Taxis.[95]
Ce sont des amis naundorffistes qui aidèrent Mélanie plusieurs fois. Voici un exemple :
Le procès en appel à Dijon[96] :
« Un second procès se préparait.
Revenue dans sa retraite, « au fond de l’Italie » Mélanie ignore que quelques journaux ont mis le public au fait du procès de Chalon. C’étaient, comme on peut s’y attendre, des organes de l’opposition à la République laïcisatrice. Dans ce nombre, une feuille périodique bataillait pour la cause royaliste et l’hérédité des Naundorff. C’était la Légitimité, revue mensuelle. Sa secrétaire, Mademoiselle Vernet, était la fille d’une employée des postes qui avait été receveuse à La Mûre (Isère). Mademoiselle Vernet avait été élevée dans la dévotion à La Salette. Elle prit fait et cause pour Mélanie, et lui écrivit pour se mettre, elle et son collègue de la Légitimité, Monsieur Schmid, à sa disposition pour préparer le procès en appel et lui assurer une publicité favorable. Isolée de tout, Mélanie fut touchée de cet intérêt manifesté gratuitement par des cœurs sincères. Santé délicate déjà marquée par une mort prochaine, Mlle Vernet avait une piété angélique qui colorait d’apostolat son utopie patriotique. Monsieur Schmid semble assez le type du publiciste catholique de l’époque, agressif dans ses écrits et timide dans ses actes, membre enthousiaste de sociétés éphémères, aussi rempli de bonnes intentions que dénué de talent, très brave homme au demeurant. Il donna à Mélanie – qui le nomme son vénéré Frère car il voulait s’affilier aux Apôtres des derniers temps – quelques joies et pas mal de déceptions.
Une correspondance suivie s’engage alors (du 21 avril 1894 au 2 septembre 1897) d’abord entre Mélanie et Mlle Vernet, puis entre Mélanie et M. Schmid.
Pour mieux étouffer sa défense, celui-ci lui pose mille questions sur sa vie privée, l’oblige à revenir sur les détails de l’Apparition et tire d’elle des confidences que, sans cela elle n’eut jamais livrées.
Par lui, la voilà, - elle si lointaine, si étrangère au monde – prise à témoin dans toutes les escarmouches et même les scandales du journalisme parisien de la fin du XIXème siècle. Elle est abonné à la Libre Parole, qui publiera Le Secret de La Salette en 1895, elle reçoit les publications de Léo Taxil ; son jugement est demandé sur Rochefort, Gaston Méry, etc. ; elle est consultée sur les formes de la lutte anti-maçonnique ; et, sans initiation préalable, la bergère de la sainte montagne est plongée dans les coulisses des Ligues religieuses et politiques qui sont le climat de ses correspondants… Surprenante, vivante correspondance.
C’est à travers elle qu’on peut suivre le procès de Dijon. Mélanie ne bougea pas de Galatina. Monsieur Schmid lui procura un avocat parisien, - collaborateur de la Légitimité – Robinet de Cléry. L’avoué de Dijon s’acquitta consciencieusement de son office. Le procès se plaida du 15 mai au 19 juin 1895. »
[…]
« Malgré déceptions et épreuves, le désir de revoir La Salette et sa patrie vivait toujours au cœur de l’exilée. Elle suivait les évènements de France avec émotion…
M. Schmid l’intéressait aux efforts des anti-maçons, à la Ligue du Labarum, à la compagnie des chevaliers de St-Georges, etc. »
« Elle ne reste à La Salette que la journée, revient à Marseille, et, de là, sur l’appel de Schmid, elle part pour Paris le 21 mai… Elle y séjourne onze jours bien remplis par la visite de toutes les églises que lui fait son guide, M. Schmid… Elle l’accompagna – avec la compagnie des chevaliers de St-Georges – au pèlerinage de Longpont. »[97]
Nous avons vu que Mélanie et Amélie de Bourbon se sont écrites.
Voici ces lettres :
Voici la lettre qu’Amélie de Bourbon écrivit à Mélanie[98] :
« 9 avril 1881
Chère Sœur Marie de la Croix,
Pour l’amour de Jésus, vous souffrez avec courage les persécutions des contradicteurs de la vérité céleste.
Pour l’amour de mon père, j’affronte le courroux de ses assassins politiques.
Votre mission est plus glorieuse : elle vient du Ciel.
La mienne, toute terrestre, y remonte par la foi.
Nous sommes sœurs par la souffrance, et comme telle comptez sur tout mon dévouement et mon entière affection.
Amélie de Bourbon
Petite fille de Louis XVI. »
Et voici la réponse de Mélanie :
« Castellamare (Italie) 23 avril 1881
Madame la Princesse,
Que Jésus soit aimé de tous les cœurs !...
Je prends une bien large part à toutes vos peines et souffrances. Puisse le divin Maître et la douce Vierge Marie les adoucir et avoir en même temps pitié de notre malheureuse France !
Mais, vous le savez, Madame la Princesse, les grandes âmes ne se forment que sous le manteau de la Croix, pour devenir plus dignes, au moment venu, d’être de vrais instruments, pour l’œuvre de Dieu, l’Eglise et le salut de la France.
Je ne cesse, malgré ma grande indignité, de prier tous les jours le bon Dieu, afin qu’il abrège les châtiments que méritent nos péchés et nous donne notre Roi, la Fleur de Lys, non parce que nous le méritons, mais par pure miséricorde.
J’espère que le Cœur de Jésus se laissera fléchir aux prières de tant d’âmes qui le prient, et que bientôt Madame la Princesse unira ses actions de grâces à la France régénérée par son Roi légitime.
Agréez l’hommage du plus profond respect avec lequel j’ai l’honneur d’être, Madame la Princesse, votre très humble et très soumise indigne servante.
Marie de la Croix, née Mélanie Calvat. »
Voici sur cette lettre ce que déclare Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
« Castellamare, 1er août 1881
J’ai lu la brochure de l’abbé Rigaud. Je crois qu’il va faire un petit ouvrage pour prouver l’existence des petits-fils du Roi-Martyr. Il m’a invité plusieurs fois à écrie à Mme Amélie de Bourbon ; je ne répondais jamais sur cette affaire ; alors, il a fait écrire une lettre par Mme Amélie, qu’il m’a fait parvenir ; j’ai du répondre à cette lettre, et, comme ma réponse devait être ouverte, j’ai écrit une lettre qui ne donne aucune lumière sur ce que l’on désirait savoir ; et malgré cela, on a pris copie de ma réponse, qui est arrivée à Rome. Dieu soit béni de tout. »[99]
Voici maintenant une deuxième lettre de Mélanie à Amélie :
« Castellamare, 21 novembre 1881
Madame la Princesse,
Je désire ardemment pour notre pauvre France la monarchie très chrétienne. Elle viendra, mais non par les hommes. Ce sera Dieu lui-même qui fera tout. C’est un roi, mais un roi très chrétien qu’il faut à la France. Travaillez à faire entrer dans le sein de l’Eglise les membres de votre famille. Confions-nous en Dieu et espérons que Notre-Dame de la Salette arrangera tout pour le mieux.
Je pense souvent à vous et compatis à toutes vos peines. »
Docile aux conseils de l’enfant de la Salette, Madame Amélie de Bourbon s’est employée avec zèle à la conversion des membres de sa famille, et non sans succès, grâce à Dieu.
2) Maximin Giraud
La rencontre Maximin et Richemont :[100]
A l’origine un certain Bonnefous, aveyronnais, qui devint frère mariste, fit la connaissance de Maximin au cours d’un pèlerinage à la Salette et s’intéressa à son avenir.
Dans ses mémoires Maximin semble attribuer à un pèlerin qu’il ne nomme pas, mais en qui on devine facilement le Frère Bonnefous, l’intention de le constituer fondateur d’un ordre qu’un de ses amis religieux défunt s’était cru appelé à créer. Le Berger s’en amuse : « Un fondateur de quinze ans ! ». Mais tout porte à bien à croire que Bonnefous fut le promoteur, au moins spirituel, du voyage à Ars.
Il envisageait de la faire entrer chez les maristes de Lyon. Un marchand orfèvre de Paris, Monsieur Houzelot, s’était engager à payer la pension. Il se trouve que Bonnefous et Houzelot étaient l’un et l’autre d’ardents partisans du Baron de Richemont, l’un des aventuriers prétendant être Louis XVII.
Le jeudi 19 septembre 1850, Eugène Verrier et (de) Brayer, présents à la Salette, organisent l’équipée à Lyon et Ars avec l’aide du frère mariste Bonnefous.
Après « l’incident d’Ars », ils font escale à Lyon. Le jeudi 26 septembre, le docteur Pictet, informé de la présence du berger à Lyon vient l’inviter à une réception que la Comtesse d’Apchier donnera chez elle, place Bellecour, le lendemain, en l’honneur – mais est-ce bien encore une coïncidence ? – du baron de Richemont dont les partisans semblent décidément s’attacher aux pas de Maximin.
A la réception de Madame d’Apchier, où sont présents le docteur Pictet, un M. de Leudeville, l’abbé Nicod, Maximin qui a identifié Richemont à cause de ses favoris fait devant lui le récit de l’Apparition. Mais il reste absolument muet sur son secret qui doit pourtant intriguer furieusement son auditoire. Personne cependant ne pose de questions.
Et brutalement, l’enfant qui se sent bien dépaysé dans cette réunion mondaine, dit à Monsieur Pictet : « Allons nous-en ! » et il gagne aussitôt la porte comme il avait coutume de la faire à Corps quand il avait été « embétéyé » toute une journée par les pèlerins. »
Maximin n’a donc nullement reconnu en Richemont le descendant de Louis XVI.
Dans une déclaration écrite par Maximin, et portée au curé d’Ars par Messieurs Rousselot et Mélin, député à Ars par Mgr de Bruillard, on peut lire :
« Je soussigné, Maximin Giraud, pour rendre hommage à la vérité et pour la plus grande gloire de Dieu, en l’honneur de la Sainte Vierge, atteste les faits suivants :
[…]
4) Que je n’ai jamais dit que mon secret concernait Louis XVII
[…]
Petit séminaire de Grenoble, le 2 novembre 1850. »
Il n’a jamais dit que son secret concernait Louis XVII, mais il n’a pas dit le contraire non plus. Comme il n’a rien dit de son secret (sinon ce ne serait plus un secret…), il n’a forcément rien dit sur Louis XVII.
En fait, il écrit ceci pour stopper les mensonges des richemontistes qui écrivent alors que lors de la réception chez la Comtesse d’Apchier, Maximin reconnue Richemont comme Louis XVII.
A propos des richemontistes qui avaient accompagné Maximin dans le voyage à Ars et Lyon, voici une lettre de la comtesse de Brye qui répondait à un prêtre qui lui avait demandé de publier la correspondance d’Eugène Verrier :
« Ranville (Calvados) 29 novembre 1905
Monsieur l’abbé,
Je ne suis que la nièce de monsieur Eugène Verrier, mais je ne doute pas que sa petite-fille, Mme de Préville ne vous donne toute latitude de publier les lettres. […]
Quant au descendant de Louis XVI, mon oncle avait cru le reconnaître dans un Baron de Richemont, auquel même il avait donné l’hospitalité. Il semble prouvé que c’était un imposteur et que le vrai est un Naundorff, je l’ai vu plusieurs fois à Riva Bella et chez le Comtesse Le Gonidec à Paris.
Veuillez agréer, Monsieur l’abbé, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Comtesse de Brye. »[101]
Le Secret de Maximin concerne-t-il Louis XVII ?
La princesse Amélie le croyait. Voici une lettre inédite, publié par La Légitimité d’avril-mai-juin 1920, pages 272-273 :
Lettre d’Amélie de Bourbon, à un des premiers prêtres convertis à la cause de la Survivance : M. l’abbé Emile Le Baillif, alors curé de Berville-en-Roumois (Eure), décédé le 1er mars 1898, qui avait écrit un ouvrage sur les voyants de la Salette :
« Le Logis, 24 octobre 1881
Monsieur le curé,
C’est avec un vif intérêt que j’ai suivi la marche de vos impressions, qui vous ont conduit, enfin, à une conviction entière de la vérité historique concernant le fils de Louis XVI. J’ai éprouvé une grande consolation ; et la pensée que les lumières que vous avez acquises sur la cause vous serviront à ramener beaucoup d’égarés, me réjouit également. Vous le savez, l’Eglise et la légitimité vraie, que le malheur a toutes les deux courbées dans la souffrance, sont prédestinées à se relever ensemble. Vous travaillez donc autant pour elle que pour nous, en répandant la vérité politique si longtemps défigurée aux yeux de la France.
Je suis heureuse de connaître Maximin tel que ses lettres le représentent, et je vous remercie de m’avoir procuré cette satisfaction. Il est admirable, mais je ne sais auquel des deux donner la préférence. La lettre que Mélanie vous a adressée à son sujet, porte un cachet que rien ne surpasse. C’est un cri de son grand cœur qui m’a fait verser des larmes d’admiration et d’attendrissement. Oh ! Que Notre-Dame de la Salette a célestement doué les âmes de ses Messagers !
Vous n’êtes pas content, Monsieur le curé, de ce que je ne désire pas que vous rendiez publique la lettre que Mélanie m’a adressée[102] ; mais voici mes raisons :
1e La pauvre enfant a déjà trop souffert pour ne pas empêcher que nos adversaires lui fassent du mal.
2e Il me répugne de me servir de ses paroles comme un moyen politique, tels que l’on fait les partisans de Richemont et de Chambord.
De plus, souffrez toute ma franchise, très honoré Monsieur le curé ; je ne regrette pas que le chapitre escamoté par Péladan n’eût pas paru, il n’est pas assez accentué. Lorsque vous parlerez de nous, veuillez le faire sans voile et telle que se montre la vérité à vos yeux. Il est évident que le ciel s’est manifesté en faveur de mon royal et si infortuné Père, la mission de Martin auprès de Louis XVIII en est une preuve ; et, comme jusqu’ici le secret de Maximin est resté lettre close, on peut présumer qu’il concerne un Prince qui n’a rien de commun avec le Comte de Chambord. S’il le concernait, on le saurait depuis longtemps. Or, la véritable légitimité ayant été conservée dans la Survivance du Roi-Martyr, le secret doit la concerner.
Recevez, Monsieur le curé, l’assurance de mes sentiments de reconnaissance et de haute estime pour vous.
Amélie de Bourbon,
Petite-fille du Roi-Martyr. »
Qu’en est-il réellement ? Il semble bien que oui.
Maximin Giraud, le Berger de la Salette avait reçu ordre de la Sainte Vierge de révéler la Survivance de Louis XVII et de sa descendance au Comte de Chambord.
En avril 1865, il se rendit donc à Frohsdorf, grâce à la Marquise de Pignerolles.[103]
A ce moment, le secrétaire du Prince était le Comte de Vanssay qui a rédigé pour sa famille – dont le Marquis de La Franquerie tiens la copie du document – le compte rendu de l’entretien :
« Je vis que le Comte de Chambord était ému et parla longuement et avec beaucoup de bonté au jeune voyant. Quand Maximin quitta la pièce, tout ému, le Prince se tourna vers moi : Maintenant j’ai la certitude que mon cousin Louis XVII existe. Je ne monterai donc pas sur le trône de France. Mais Dieu veut que nous gardions le secret. C’est lui seul qui se réserve de rétablir la royauté. »
Et le comte de Vanssay ajoute pour ses neveux et petits-neveux :
« Surtout qu’ils gardent l’espérance qu’un jour Dieu ramènera sur le Trône de France le descendant du lys à la tête coupée et que notre chère Patrie redevenue la Fille Aînée de l’Eglise retrouvera sa grandeur et sa gloire. »[104]
En 1873, Maximin rencontre pour la deuxième fois le Comte de Chambord à Frohsdorf : « Je suis venu vous dire qu’il ne fallait pas entreprendre de devenir roi de France, que cela ne se peut pas et vous savez pourquoi. » Cette entrevue est attestée par le Général de Cornulier-Lucinière, MM. Gabaudan et Canet et les R.P. Brisseau et Perrin.[105]
Cette entrevue est confirmée par le témoignage de M. De Montbel. Voici ce qu’écrit Mgr Rigaud, dans les Annales des Croisés de Marie, dont il est le directeur :
« Peu de temps avant sa mort, Maximin partit pour Goritz, où il eut une longue conversation, en présence de M. de Montbel, avec le Comte de Chambord, qui fut profondément troublé de cette entrevue.
M. de Montbel a répété ensuite à Adrien Péladan tous les détails de l’entrevue, en ajoutant : « Si certains, qui ont partagé les idées de Martin en 1817, savaient ceci, ils diraient que Maximin avait reçu pour Henri V la mission dont le laboureur de Gallardon fut chargé pour Louis XVIII, et m’est avis qu’ils auraient raison. »
Voici ce témoignage personnel, publié par de P. de Valamont (pseudonyme de M. de Montbel) :
« Je déclare sur la foi du serment, que le confident du Comte de Chambord m’a dit un jour ce que je répète. Il ajouta : « Si certaines personnes, qui ont partagé les idées de Martin, en 1817, savaient ceci, ils diraient que Maximin avait reçu pour Henri V la mission dont le laboureur Gallardon fut chargé pour Louis XVIII. »
Peu de temps après cet évènement, Henri V, de son exil, fit ériger un riche autel de marbre dans la basilique de la Salette. »[106]
Certains affirment que Maximin est resté jusqu’à sa mort partisan du Comte de Chambord, trompé qu’il fut sans doute par le nom d’Henry le Boiteux ?
Non, en fait, il ne se trompait pas.
En raison de l’engouement des royalistes pour le Comte de Chambord[107] ; en raison aussi de l’honnêteté et de la piété du Comte de Chambord, Léon XIII comptait sur lui, pour placer sur le trône la branche aînée ; quitte à se laisser lui-même, mettre en possession d’abord, afin que, une fois le pouvoir en main, et plus que jamais tenant réunis tous les vouloirs des royalistes, il ait, de suite, comme premier acte de justice, déclaré la vérité, la vérité toute entière, en désignant le fils de Louis XVII comme représentant le droit divin au trône… dont lui, Henri V, se serait hâter de descendre. En un mot, le Comte de Chambord devait prendre le trône, mais seulement comme lieutenant de son cousin, devant lequel les royalistes se seraient inclinés, du moment que l’ordre leur en eût été donné par celui en qui ils croyaient aveuglément !
Maximin disait au Comte de Chambord d’accepter le trône de France, puisqu’on le reconnaissait, mais à condition expresse de faire connaître le véritable héritier et de le placer lui-même sur le trône.[108]
Maximin Giraud est mort sans avoir publié son secret. Mais un jour, le cardinal Antonelli en remit une copie à la duchesse de Clermont-Tonnerre. Elle a été publiée par A. Péladan dans les Annales du Surnaturel en 1888. Mais cette copie est incomplète. Le cardinal Antonelli a jugé bon, pour des raisons à lui connues, d’en supprimer deux passages.[109]
L’analyse du secret a été faite d’une façon très complète par Mgr Rigaud, directeur des Annales des Croisés de Marie. Extrait :
« Avant de mourir, Maximin confia à sa mère adoptive, Mme Jourdain, que son secret concernait un descendant du Roi-Martyr. [...]
Il y a une soixantaine d’année, M. J. P…, consulteur de l’Index, écrivait à Mme Amélie, fille aînée de Louis XVII :
« Madame, le secret de Maximin concerne très réellement votre famille. »
Mgr Rigaud publia cette lettre dans ses Annales de juin 1889, et ne fut pas démenti par Rome. »
Voici également une lettre de Mgr de Brandt à l’abbé E. Rigaud :
« D’après mes renseignements puisés en haut lieu à Rome, on n’en fait plus mystère : le Secret de Maximin concerne le descendance de Louis XVI. »
Mgr Fava, évêque de Grenoble, a lu et connaît le secret de Maximin in extenso. Or, Mgr Fava a été en correspondance avec le Prince naundorffiste Adelberth. Connaître « in extenso » le Secret de Maximin, et correspondre avec les petits-fils méconnus du Roi-Martyr, pour un évêque de Grenoble, c’est de toute force !
Mgr Fava eut, avec plusieurs membres de la Survivance, des relations personnelles pleine de déférence et de sympathie. Il reçu à sa table la princesse Amélie.
Bref, tout nous confirme dans la conviction que dans son secret à Maximin, la Reine des Prophètes a très réellement annoncée la réhabilitation de la descendance méconnue, repoussée et proscrite de notre Roi-Martyr.
Certains pourraient peut-être nous dire : Comment expliquer que Mélanie Calvat soit Naundorffiste, et Maximin Giraud juste survivantiste, sans s’être prononcé pour ou contre Naundorff ?
Tout simplement parce que les deux voyants avaient chacun deux missions différentes.
Maximin n’a pas eu toutes les faveurs qu’a eu Mélanie.
De même que Mélanie, elle, a vu le visage de la Vierge et rencontré son regard ; lui, il n’a pu apercevoir, entre le corps et la coiffure, qu’une clarté qui l’éblouissait.
Pour terminer, petit signe de la Providence, Madame Prud’homme, abonnée à la Légitimité, est décédée à Grenoble le 21 juin 1921. Elle était la cousine de Maximin Giraud, le petit berger de la Salette et eut l’honneur de recevoir le prince naundorffiste Jean de Bourbon à l’un de ses pèlerinages au céleste sanctuaire.[110]
VII] Le Comte de Chambord
Nous avons vu que Maximin avait donné au Comte de Chambord la certitude que Louis XVII vivait et avait une descendance.
Voici d’autres témoignages qui confirme les doutes, puis la certitude qu’a eu le Comte de Chambord sur la survivance de Louis XVII.
D’après une déclaration de M. Alexandre de Monti, rapportée par M. Le marquis de Clancarthy et confirmée en 1909 par M. de la Roche-Billou, le Comte de Chambord avait un jour chargé son chambellan et confident Edouard de Monti, frère d’Alexandre, de faire toutes les recherches nécessaires pour établir si l’évasion avait eu lieu véritablement ; et, celui-ci, après les recherches les plus consciencieuses, avait rapporté à son Prince que le Dauphin avait été en effet enlevé du Temple et conduit en Vendée, et ensuite qu’il avait été là (aux Sables-d’Olonne) embarqué... pour une destination inconnue...[111]
« Voici les paroles de monsieur du Verne au chanoine Chapeau, de Blois, qui nous les a citées bien des fois :
C’était au cours d’un voyage en 1853 ; l’un des fidèles du Comte de Chambord lui dit ex abrupto : « Il serait temps, Monseigneur, que vous fassiez connaître au Peuple Français que vous êtes prêt à faire son bonheur en montant sur le trône ». Le Prince resta pensif quelques secondes et répondit : « Pour cela, mon cher ami, il me faudrait être bien-sûr de mon droit ». Stupeur des personnes présentes, dont Monsieur du Verne, mais aucune n’osa demander des éclaircissements. »[112]
Il y avait doute chez ce Prince, mais, semble-t-il, pas une certitude, par manque d’information. Il n’eut de certitude absolue qu’après la visite de Maximin en 1865.
Nous avons le témoignage d’un chanoine, ancien secrétaire de Mgr Pie, évêque de Poitiers. Après la guerre, vers 1873, Mgr Pie rencontra en Suisse le Comte de Chambord et il lui demanda d’accéder au désir qui se manifestait, à cette époque, de le voir revenir en France, pour s’emparer du pouvoir. Mais le prince, à plusieurs reprises, lui aurait répondu : « Non, non, je ne puis ; ce n’est pas ma place, elle appartient à un autre ! »[113]
Voici ce dialogue :
« _ Monsieur le chanoine, que pensez-vous de la survivance de Louis XVII ?
_ Cher abbé, j’ai peine à y croire. Cependant, voici sur cette question un fait assez étrange et dont je fus témoin. Etant secrétaire de Mgr Pie, j’accompagnai Sa Grandeur en Suisse, où Elle voulait voir Mgr le Comte de Chambord.[114]
Le Prince daigna m’admettre à l’entrevue avec Sa Grandeur. Je vois encore la scène : le Prince était assis à la droite de la cheminée, Mgr Pie à gauche et moi entre les deux, en face.
_ Prince, dit Sa Grandeur, revenez en France. La France vous attend.
_ Non, Monseigneur, je ne le puis pas.
_ Mais, Prince, je vous donne l’assurance, la France est prête pour vous recevoir, le moment ne saurait être plus favorable pour vous de monter sur le trône de vos ancêtres.
_ Monseigneur, je ne régnerai jamais.
_ Mais, Prince, me serait-il permis de demander quel obstacle s’y oppose ?
_ Eh bien ! Monseigneur, le voici : c’est qu’il en est un autre qui, par sa naissance, approche plus près du trône de France que moi.
... Le chanoine a ajouté en terminant l’entretien : « Cet héritier du trône de France, Pie IX le connaissait et Léon XIII le connaît. »
L’entrevue, autant qu’il peut s’en souvenir, eut lieu à Lucerne en 1873. »[115]
Le Comte de Chambord aurait dit la même chose, dans son fumoir de Goritz, à son filleul M. De Guiry, quelques mois avant la tentative de restauration.[116]
Voici le témoignage de la révérende Soeur G. de Cléry, religieuse du Sacré-Coeur, fille de M. Robinet de Cléry :
« Figurez-vous – dit-elle dans une lettre du 25 janvier 1911 – que je rencontre ici (en Belgique) une religieuse française ayant eu autrefois comme supérieure à Marseille la Révérende Mère de Ferry, plus convaincue encore que la Révérende Mère de Pichon... La même religieuse a vécu à Montfleury avec une des nôtres... la Mère Antoinette Giraud, qui, elle, avait été lectrice de la comtesse de Chambord, tant à Frohsdorf qu’à Goritz... et c’est là qu’elle avait appris la vérité sur Louis XVII...
Quand j’ai demandé : Le comte et la comtesse de Chambord le savaient-ils ? Il m’a été répondu à peu près textuellement : « D’abord ils ne savaient rien. Puis ils ont été tout à coup occupés de cette pensée qu’ils ne pouvaient ni ne voulaient accepter. » Qu’est-il arrivé ? Quelles preuves ont-ils eues ? Mais ils ont fini par la certitude. Les princes, qui se dévoilent plus devant ceux de leur maison que devant de grands politiques, ont parlé ouvertement, et le Comte de Chambord a dit une fois devant cette Antoinette Giraud : « Je n’ai pas de descendants. Mais il y a un rejeton... »[117]
Voici la lettre qu’adressa la marquise de Maleissye, comtesse d’Osmond par son mariage, à l’historien allemand le professeur Friedrichs, pièce publiée en sa plaquette de quelques pages : M. J.-C.-Alfred Prost et la question Louis XVII (Paris, Daragon,1906, pages 13-14) :
« Le 29 août 1905, Vermenton (Yonne)
Monsieur,
Etant à Frohsdorf en 1858, Monseigneur le Comte de Chambord proposa de faire une promenade à cheval. Il me fit l’honneur de m’appeler près de lui, ce que voyant, son chambellan, le comte de Monti, se tint d’une encolure en arrière.
Après avoir causé d’une façon banale pendant quelques instants, Son Altesse Royale me dit : « Madame Osmond, j’ai beaucoup aimé votre grand-père, le marquis de Maleissye ; je vais donc vous répéter ce que je lui ait dit plusieurs fois.
Je ne reviendrai jamais en France, Louis XVII n’est pas mort au Temple ; il s’est marié, et il a eu des enfants. Je ne suis donc qu’un cadet. »
Je ne pus m’empêcher de m’exclamer : « Mais Louis XVIII ? Mais Charles X ? _ La Raison d’Etat, me répondit Son Altesse. Il paraît que cela prime tout. Moi, voyez-vous, j’ai une âme bourgeoise, ma conscience avant tout, bien avant la Raison d’Etat. Attendez ma mort pour répéter ce que je viens de vous dire. Ce jour-là, vous ferez ce que vous voudrez. »
Je revins deux autres fois à Frohsdorf ; Son Altesse ne me parla plus de cette conversation. Une fois seulement, il me dit : « Vous êtes une femme discrète, c’est bien. Attendez que je ne sois plus là, et vous reprendrez toute votre liberté. »
Voilà, Monsieur, ce que Son Altesse Royale me fit l’honneur de me confier. Je jure que je n’ajoute ni ne retranche un mot de cette conversation. J’étais absente quand votre lettre est arrivée de Paris. Veuillez m’excuser d’avoir tardé de quelques jours à vous répondre, et agréez l’expression de mes meilleurs sentiments. »[118]
Le duc de Parme, neveu du Comte de Chambord, ayant osé nier ces paroles – qu’il n’avait pas entendues et qu’il était naturellement intéressé à nier, – Mme de Maleissye a formellement maintenu ce qu’elle avait écrit.[119]
L’écrivain Maurice Constantin-Weyer a d’ailleurs témoigné en son ouvrage Louis XVII ou Naundorff ? que le même propos du Comte de Chambord avait été tenu par celui-ci au duc de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, son oncle, au témoignage direct de celui-ci.[120]
Le Comte de Chambord mourut le 24 août 1883. Le Comte de Paris, qui briguait sa succession politique, fut empêché par la comtesse de Chambord de figurer au premier rang du cortège funèbre. Et surtout, sur le cercueil du défunt fut déployé un vieux drapeau blanc des guerres de Vendée portant en gros caractères cette inscription : Vive Louis XVII ! Et cela, a-t-on dit[121], à la stupéfaction générale, comme si c’en était fait de la Monarchie chrétienne descendue au tombeau avec le Comte de Chambord, à moins que la France ne se retournât vers la descendance de Louis XVII, la survivance du Roi-Martyr !
Pourquoi le Comte de Chambord n’a rien fait en faveur des Naundorff ?
Deux hypothèses :
1) Voici l’hypothèse de l’historien Otto Friedrichs :
« Le Comte de Chambord savait la vérité au sujet de l’existence de Louis XVII. Et s’il n’a pas poussé cette certitude jusque dans ses extrêmes conséquences, c’est que le Comte de Chambord, lui aussi, n’était qu’un pauvre être humain, c’est-à-dire doué de faiblesses. Il n’osait pas renoncer tout à fait à son prestige et à sa fortune ; il n’osait publiquement déshonorer sa famille, ses oncles Louis XVIII et Charles X ; il reculait surtout devant l’obligation de flétrir la mémoire de sa tante, la « sainte » Duchesse d’Angoulême qui l’avait adopté et élevé ! Et ainsi, de faiblesses en faiblesses, de concessions en concessions, de lâchetés en lâchetés, il s’est contenté d’être non le plus honnête de tous, mais le moins malhonnête de tous, en ne bravant pas le Dieu, auquel il croyait, pour se faire sacrer à Reims. »[122]
2) Deuxième hypothèse : tout simplement parce qu’il savait que Louis XVII avait survécu, mais il ne savait pas que Naundorff était Louis XVII.
Mgr le Comte de Chambord avait le devoir, aussi longtemps qu’il n’était pas convaincu et certain des droits de Naundorff, de ne pas laisser entrevoir le moindre doute sur son propre droit.
Il croyait à l’évasion, comme y croyait sa tante, la duchesse d’Angoulême, et très probablement aussi la prétendue indignité de Naundorff ne lui a pas permis de reconnaître en ce « criminel » et en cet « aventurier » le chef de sa race.
Ajoutons que M. le Comte de Chambord, mort en 1883, n’a pas eu connaissance de tous les nouveaux documents publiés par la Légitimité, documents qui auraient pu lui ouvrir les yeux sur bien des points.
Pour terminer, nous retrouvons dans les papiers du Marquis de Meckenheim, qui fut le secrétaire de Charles XI, deuxième fils de Louis XVII, les notes suivantes écrites de la main du Marquis, qui sans être très importantes, peuvent être intéressantes :
« En mars 1872, Monsieur le Comte de Chambord est descendu à l’hôtel de la Couronne, à Bréda, où il avait loué tout le premier étage pour un mois. Monsieur de la Barre a écrit au Comte une lettre jointe à une brochure, en priant Monsieur van Alphen père de se charger de les lui faire remettre. Celui-ci a accepté volontiers, promettant que la commission serait faite. En effet, le fils de Monsieur van Alphen, qui est actuellement maître d’hôtel à la Couronne, se chargea de placer la lettre et le paquet près du couvert du Comte de Chambord. En se mettant à table, le Comte trouva ces deux objets devant lui ; il prit connaissance de la lettre et passa le tout à Monsieur de Blacas qui était auprès de lui.
Le soir même, TREIZE JOURS après son arrivée, le Comte de Chambord faisait faire les préparatifs de départ et partait le lendemain matin de bonne heure (Rappelons que son appartement à l’hôtel était retenu pour un mois).
N. B. – Monsieur van Alphen avait recommandé à Monsieur de la Barre dans le cas où il voudrait faire parvenir quelque chose au Comte de Chambord, de la faire à la dérobée, parce que, dit-il, aux heures où le facteur arrive, il y a toujours quelqu’un en bas, pour demander s’il n’y a rien pour le Comte de Chambord.
Pendant le séjour du Comte de Chambord, à Bréda, l’hôtel de la Couronne, en mars 1972, une lettre fut présentée à plusieurs reprises par le facteur. Chaque fois, Monsieur de Blacas voulant signer pour le Prince, le facteur remportait la lettre.
Le Comte de Chambord quitta Bréda sans en avoir pris possession. Après son départ, une autorisation du ministre arriva à la direction de la poste, permettant de laisser Monsieur de Blacas signer pour le Prince. Il était trop tard, la lettre avait été réexpédiée au Comte de Chambord à sa nouvelle résidence, où Monsieur de Blacas recevait toujours sans difficulté les lettres en son nom.
Pendant son séjour à Bréda, Monsieur le Comte de Chambord, passait souvent cher un libraire de Bochstraat, Monsieur de Nieuvenhuijs. Celui-ci avait en vente les ouvrages de Monsieur Gruau de la Barre ; l’un de ces messieurs qui l’accompagnaient dit à Monsieur de Nieuvenhuijs : « Surtout, ne mettez jamais aucun de ces ouvrages dans les envois que vous faites à l’hôtel de la Couronne, parce que tout serait retourné et on ne prendrait plus rien chez vous. »
Au bas de cette note de Monsieur de Meckenheim, il y a ceci : Question : dans votre pensée, cet ordre venait-il du Prince ou seulement de ce Monsieur ? Réponse : Ma pensée, comme celle de tous les habitants de Bréda était que l’entourage du Comte de Chambord cherchait à l’empêcher de connaître la vérité sur les descendants de Louis XVII. »
Monsieur le Comte de Chambord n’avait, semble-t-il, pas la liberté de son courrier. Peut-être, il est vrai, par sa volonté, pour être libéré de lettres importunes, mais quand on pense qu’au jour de sa mort, les deux-tiers de son entourage à Frosdhorff, se révélèrent Orléanistes qu’ils étaient depuis longtemps, on reste rêveur quant à la sûreté d’information dont jouissait le Prince. »[123]
VIII] La Duchesse d’Angoulême
La Duchesse d’Angoulême était assurée que son frère n’était pas mort au Temple.
Nous le savons par ses démarches, ses tristesses et remords, ses aveux implicites et ses aveux explicites, et par de nombreux témoignages.
Pour ne pas alourdir cet ouvrage, nous renvoyons les lecteurs sur le site http://naundorffisme.free.fr
Voici juste, pour ce chapitre, les suprêmes aveux de la Duchesse d’Angoulême.
Six semaines avant sa mort, dans les premiers jours de septembre 1851, elle reçoit à Frohsdorf le général Auguste de Larochejaquelein.[124]
Voici ce qu’elle lui déclara :
« Général, j’ai un fait grave, très grave, à vous révéler ; c’est le testament d’une mourante : mon frère n’est pas mort (au Temple) ; c’est le cauchemar de toute ma vie... Promettez-moi de faire toutes les démarches nécessaires pour le retrouver. Voyez le Saint Père, voyez les enfants de Martin, courez par terre et par mer pour trouver quelques vieux serviteurs ou leur descendants, car la France ne sera heureuse et tranquille que lorsqu’il sera sur le trône de ses pères. Jures-moi (ici, des larmes abondantes) que vous ferez tout ce que je vous demande. Je vais mourir au moins tranquille et il me semble que le poids que j’ai sur la poitrine est moins lourd. »
Or, Martin de Gallardon n’a jamais reconnu que Naundorff. Il s’agit donc bien de lui.
Ce témoignage nous est connu par les enfants de Martin de Gallardon, notamment le docteur Antoine Martin, qui fit cette déclaration en 1893 au journal la Légitimité. Ce témoignage a été maintes fois publié depuis.
Cette visite fut contestée plus tard par la Marquise de Larochejaquelein, veuve du général, affirmant que son mari n’avait jamais fréquenté Frohsdorf, donc il n’avait pu entendre la duchesse.
Eh bien ! La marquise a altéré volontairement la vérité. Le carnet du Comte de Chambord lui-même, publié par un adversaire des naundorffistes, François Laurentie, note la présence du marquis à ses chasses du 1er au 8 octobre 1851, et la duchesse d’Angoulême est morte le 19 octobre !
Les aveux sont donc bien authentiques. Du reste, on ne s’est acharné contre le témoignage de M. Antoine Martin que parce qu’il gênait. Il prouve, en effet, que cette même Dauphine qui, sous la Restauration, avait dit au chevalier de Cointoux : « Mon frère m’a écrit de Prusse », pensait encore à Naundorff quelques semaines avant de mourir.[125]
IX] Diana Vaughan
Une très bonne étude a été faite sur Diana Vaughan, une ancienne grande prêtresse luciférienne dans la haute-maçonnerie, puis convertie au catholicisme : L’Affaire Diana Vaughan – Léo Taxil au scanner, Athirsata, Editions Sources Retrouvées, Paris, 2002.[126]
Pour faire taire ses contradicteurs, elle annonça qu’elle apparaîtrait en public et qu’alors elle montrerait de nombreux documents démontrant tout ce qu’elle raconte dans ses Mémoires. Or, dans la liste des documents qu’elle promis qu’elle montrerait, voici ce que nous pouvons lire : « … ; un curieux rapport du Souverain Directoire administratif de Berlin, sur la question Naundorff, etc… ».[127]
C’est, semble-t-il, la seule fois où Diana Vaughan évoque en public la question Louis XVII-Naundorff.
Diana Vaughan serait-elle naundorffiste ?
Sûrement de part son passage chez les plus grands initiés maçons, au Palladisme, dont elle eu ainsi accès à de nombreux documents maçonniques, comme ce rapport du Souverain Directoire administratif de Berlin.
Remarquons également que la mère de Diana Vaughan se nommait Léonie de Grammont.[128]
Or, Xavier de Roche écrit : « Mentionnons encore parmi les anciens prisonniers du Temple que Naundorff amena à croire en lui par l’exactitude et la précision de ses souvenirs, un autre officier royaliste, le chevalier de Grammont. Lui aussi reconnut le fils de son Roi en la personne de Naundorff. »[129]
Diana Vaughan fait-elle partie de la même famille que ce chevalier de Grammont ?
Dans tous les cas, malheureusement, la secte maçonnique l’assassinat peu avant qu’elle fasse son apparition au grand jour. Tous les documents qu’elle devait montrer sont donc retournés à la secte.
Diana Vaughan fut assassiné deux ans après sa conversion au catholicisme. En deux ans, elle publia des ouvrages, dont ses Mémoires. Tous sont consacrés à la question de la haute-maçonnerie bien-sûr, c’est son cheval de bataille, puisqu’elle en vient, et elle a de nombreuses révélations à faire sur ce sujet. Elle n’a donc pas abordé d’autres questions historiques. Peut-être l’aurait-elle fait si elle avait vécu plus longtemps.
En privé, parla t-elle de la question Naundorff ? Isolée et cachée par protection, elle ne vu que très peu de personnes. Parmi celles qu’elle a vu, nous pouvons mentionner son éditeur A. Pierret, qui connue très bien Diana Vaughan et publia ses Mémoires.
Or, A. Pierret assistait aux messes en la mémoire de Louis XVII, organisé par les naundorffistes.[130]
Jules Doinel, qui avait été patriarche gnostique, martiniste et rose-croix, avait abjuré ses erreurs et était revenu à la religion catholique. Il fut mêlé à l’affaire Diana Vaughan. Il avait, sous le pseudonyme de Jean du Val-Michel, adressé à la Légitimité, deux communications (n° du 1er juin 1898, page 148, et n° du 1er août 1898, page 194) relatives à la question Louis XVII.[131]
En outre, nous savons que Diana Vaughan voulu aller à Loigny, voir la communauté de sœurs dirigées par la voyante Mathilde Marchat.[132] Or, Mathilde Marchat était surnommée la « Jeanne d’Arc des Naundorff ».
Pour terminer cette hypothèse, remarquons que le premier à avoir stigmatisé la supercherie de Taxil après la « disparition » de Diana Vaughan, dans son opuscule : La Vérité sur Miss Diana Vaughan la sainte, et Taxil, le tartuffe, se nomme l’abbé La Tour de Noé, et que cet abbé est naundorffiste et qu’il fut un abonné de la première heure à la Légitimité.
X] Marie-Julie Jahenny
De nombreuses prophéties, nous l’avons montré, prédisent que la Grand Monarque descendra de la survivance de Louis XVII.
Nous nous sommes demandés si des prophéties prédisaient le contraire et plus précisément si des prophéties affirmaient que Naundorff est un imposteur.
Nous n’avons trouvé que Marie-Julie Jahenny.
Michel Morin, sans préciser sa source, écrit que Marie-Julie Jahenny, le 23 janvier 1926, affirma : « Le Roi Sauveur ne descendra ni d’un Bourbon d’Espagne, ni d’un Orléans, ni de Naundorff, mais de Louis XVII »[133]
Autrement dit, Naundorff n’est pas Louis XVII…
Or, voici le vrai texte, extrait de Marie-Julie Jahenny, deuxième recueil d’extases, par Bourcier (La Fraudais, 44130 Blain) page 32 :
« Extase du 28 juillet 1926 :
_ Le Sacré-Cœur : « J’ai un Roi caché dans mon Sacré-Cœur qui aura les belles vertus d’un Saint Louis et surtout sa belle foi ; son nom ne sortira qu’à l’heure de ma sainte volonté. Il ne faut pas compter sur les Naundorff, ni sur les Orléans, ni même sur la famille des Bourbons ; celui que je choisis pour l’heure de ma Sainte Volonté n’est pas encore connu sinon de quelques âmes que j’aime bien, mais pas plus. »
La date n’est pas la même, et la phrase radicalement différente…
Cependant il faut croire apparemment d’après Marie-Julie que le Grand Monarque ne descendra pas de Naundorff.
Il reste une question : pouvons nous croire aux extases de Marie-Julie Jahenny ?
Lisons ce texte, extrait de : Henri de la Croix le sauveur de la France. Extases et entretiens de Marie-Julie Jahenny sur la vocation de la France et la mission d’Henri de la Croix, publié par Henri Bourcier, en 1979 :
En 1878, l’Archange Saint-Michel dit à Marie-Julie :
« Ce sera un Roi blanc, un nouveau Saint Louis, plus grand et plus saint. Il sera gardé sain et sauf, car la Mère de Dieu le protège comme son propre fils. Elle l’a réservé pour être l’héritier d’une couronne méritée et qu’on lui a ravie. C’est un descendant de la branche coupée des Fleurs de Lys des Capétiens, branche restée si longtemps sans représentant sur le trône de France. »
Et maintenant, voici une extase du 29 septembre 1882 :
Notre-Dame : « Mon enfant, j’ai cherché par toute la France, le germe du Lys, principalement dans la famille du Roi, et je n’ai pas pu le découvrir ; il faut que ce germe soit consumé en terre. Puisque le germe de pureté est perdu, j’ai bien lieu d’être triste ! Ce sera une grande peine pour mon divin fils, car quand il va créer une nouvelle génération, il sera obligé de créer un nouveau germe de pureté. »
N’y a-t-il pas contradictions ?...
Voici une lettre de l’abbé Combe au directeur de la Légitimité, du 20 novembre 1895 :
« … Marie-Julie, dont il prend davantage la défense, a fait 8 à 10 prophéties qui ne se sont pas vérifiées ; mille fois, dans ses extases, elle a prédit le retour du Comte de Chambord sur le trône. N’est-elle pas ce qu’on nomme une fausse visionnaire ? Si votre lecteur croit que l’épithète attaque la piété de ces filles, il a tort. Même une sainte peut être illusionnée par son imagination ou par Satan et être une sainte. Marie-Julie et Joséphine Reverdy, fussent-elles des saintes, ont fait de fausses prophéties dont nous n’avons pas à nous occuper. »
Voici une réponse, faite par le père Bourcier[134], extrait de Marie-Julie Jahenny. 1er recueil d’extases, page 56 :
« Pourquoi l’abbé Combe a-t-il rejeté Marie-Julie Jahenny ?
Il y a apparemment deux motifs plausibles à ce sujet. La première, c’est le silence de Mélanie Calvat au sujet de Marie-Julie Jahenny. En cela, comme pour son compte personnel, elle laisse au prêtre de s’éclairer lui-même.
L’abbé Combes n’avait à cette époque-là aucun écrit, aucun dévouement sérieux en mains. Il n’est pas venu à la Fraudais, ni personne de sa connaissance. Par contre, il n’échappe pas aux ragots qui circulent sur le dos de Marie-Julie. Il n’a aucun moyen d’éclairer sa lanterne.
En second lieu, il se lie au Père Parent, qui, sur sa demande a obtenu de Mgr Laroche, évêque de Nantes, vers 1894, l’autorisation de visiter et d’étudier le cas de Marie-Julie Jahenny. »
Seulement, Mélanie Calvat, contrairement à ce qu’il affirme, n’est pas restée silencieuse au sujet de Marie-Julie. Voici quelques extraits de lettres de Mélanie :
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Castellamare, 3 février 1882.
« L’abbé Rigaud est très zélé, mais il manque de sagesse et de prudence. Son livre est théologique pour qui retient le bien d’autrui ; mais il reste à savoir si le Comte de Chambord est de ce nombre : il y a tant d’intrigues dans les cours des rois ! Il est difficile de savoir la vérité sans les lumières d’en-haut ; ensuite, un prêtre ne devrait pas entrer dans ces détails, qui n’aboutissent à rien de bon. Dieu soit béni de tout.
[…]
Moi, je suis plus que persuadée que Marie-Julie est dans le faux : c’est déplorable. »[135]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Castellamare, 7 novembre 1881.
« Avez-vous vu, lu la brochure de Monsieur l’abbé Rigaud : Cas de conscience posé au Comte de Chambord ? Je suis désolée qu’un prêtre entre dans ces choses-là ; je ne puis rien dire, il y est enfoncé. Monsieur Pennacchi par ses conseils voulait aussi écrire quelque chose ; je l’ai prié de n’en rien faire pour le moment. Dieu soit béni de tout.
Je suis affligée du nombre de fausses visionnaires qui existent. Il ne me convient pas de parler, ni de rien faire connaître : il y a déjà bien assez de mal dans le monde. Je crois cependant devoir vous dire à vous seulement ; comme appartenant à la Mère de Dieu : que vous ne devez pas fonder ni porter foi aux visions, révélations de celle que l’archange a rendu infirme, ni à Marie-Julie. Mgr Fava se fourvoie, c’est malheureux, prions pour lui. »[136]
XI] Mathilde Marchat
La voyante Mathilde Marchat (1839-1899) est la fondatrice des Épouses de Jésus-Pénitent de Loigny. Son histoire fut une des sources des Caves du Vatican d'André Gide.
Seule survivante de six enfants, son père se remarie après la mort de sa mère en 1849. Très pieuse, se disant persécutée par sa belle-mère et poursuivie d'assiduités par son père, elle quitte sa famille en 1870. Ayant des apparitions du Christ et de la Vierge à partir de 1875 mais surtout à partir de 1883, elle vit grâce à Joséphine Duchon[137] qui l'aide à surmonter son infirmité oculaire. Mal accueillie par le curé de Saint-Bazile (diocèse de Chartres) auquel elle demande l'établissement d'une Association du Sacré-Cœur de Jésus-Pénitent (1883), elle se tourne vers le curé de Loigny qui reste réservé (1884), puis s’installe à Chartres avec un début de communauté (1887). Les Annales du surnaturel d'Adrien Péladan la font connaître (« Avertissements divins », septembre 1887 à avril 1888).
Vers la fin de 1887, les prédictions de Marchat ne se confinaient plus dans le domaine religieux, mais revêtaient aussi un caractère politique. Elle enseignait la survivance du jeune Louis XVII, l’infortuné prisonnier de la Tour du Temple, pendant la Révolution, et la légitimité des Naundorff. Bientôt, disait-elle, arriveraient le roi Charles XI, le petit-fils de Louis XVI, le Roi-Martyr.
Louis Glénard[138] et Eugène Vérité de Saint-Michel[139] l'encadrent à partir de janvier 1888.
L'évêque de Chartres, Mgr Regnault, déclare ses révélations fausses et demande la dissolution de la communauté des Épouses du Sacré-Cœur de Jésus Pénitent.
Mais elle s'installe dans une maison achetée par Glénard à Loigny (avril), sous le nom de Marie-Geneviève du Sacré-Cœur Pénitent, avec une dizaine d' « Épouses du Sacré-Cœur », J. Duchon étant supérieure. Ses visions organisent la vie commune (cérémonies, cantiques, etc.)[140]
Vérité de Saint-Michel, profitant de sa fonction de camérier, intervient auprès du pape pour faire lever la condamnation, mais celui-ci défère la question au Saint-Office. La voyante s'explique à Rome mais part avant la fin de l'enquête. Le Saint-Office confirme la décision épiscopale, alors qu'ont été lancées les Annales de Loigny, publiant visions et justifications et tirant bientôt à 10 000 exemplaires.
Alexis Jordan[141] subventionne la communauté, défendue de Bologne par le barnabite Bernardino Negroni et sa Tromba Apocaliptica (deux de ses ouvrages avaient été mis à l'index). L'audience est suffisante pour que la presse religieuse publie largement les sanctions et que le Saint-Office intervienne de nouveau (1889) ainsi que Mgr Lagrange, nouvel évêque de Chartres. Les partisans multiplient les défenses (Vérité de Saint-Michel, Glénard, et un catholique de Lyon qui défend La nouvelle Jeanne d’Arc, la nouvelle Marguerite-Marie, 1889). Des tentatives d'occupation de l'église de Loigny aboutissent à deux instructions judiciaires en 1889. L’une se termine par un non-lieu, les inculpés, après examen psychiatrique, étant considérés comme faibles intellectuellement et aliénés. L’autre voit la condamnation du comte Gaudin de Saint-Rémy et de sa mère. A cette occasion une perquisition a lieu au couvent, mais aucun délit n'est constaté.
Eugène Vérité de Saint-Michel proclame en 1889 La Vérité sur les condamnations qui frappent Mathilde Marchat, mais il est englobé dans les sanctions qui frappent les résistants (il organise les pèlerinages), et perd ses titres et fonctions vaticanes (1890).
Les Annales et une partie de la littérature loygniste sont mises à l'index, les prêtres se rendant à Loigny sont suspens (1891). Des Epouses abandonnent la communauté, mais la propagande des Annales en permet la reconstitution. Des pèlerinages réguliers drainent les fidèles qui font des dons conséquents.
Pour tourner l’obstacle qui arrêtait la cause de Mathilde Marchat, au printemps 1891, Glénard (Allons au Pape et mort au schisme...) et l'abbé Xaé s'installent à Rome (les abbés Gaget et Le Blanc le remplaçant à Loigny) afin de faire appel à un Léon XIII trompé par une hiérarchie schismatique.
La libre-pensée et la franc-maçonnerie, dirigées par l’enfer, ont, disaient-ils, des adhérents secrets dans l’entourage du Pape. Ces disciples de Satan, assez nombreux dans le Sacré-Collège, aspirent à remplacer le Saint-Père par un des leurs, le cardinal Monaco. Voilà pourquoi, malgré le voyage à Rome de la voyante en 1888, et malgré les efforts persévérants des défenseurs de Loigny, Léon XIII, esprit droit et élevé, pourtant, mais caractère faible, n’a rien su, pendant trois ans, de ce qui concernait les apparitions. Les quelques mots et faits parvenus jusqu’à lui, ont été dénaturés et présentés sous un faux jour.[142]
Glénard et l’abbé Xaé se mirent en chemin, accompagnés de trois autres délégués. Arrivés à Rome, quelques jours avant la Saint-Léon, 11 avril, ils espéraient, à l’occasion de la fête du Pape, être admis en sa présence et solliciter la levée de l’interdit qui pesait sur eux. Mais le cardinal Monaco, l’antipape, racontent les représentants de la voyante, écartait du Vatican les personnes « infectés de Loigny ». Aussi, ce jour-là, les portes du palais furent fermées pour tout le monde, sous prétexte que Léon XIII était indisposé. En réalité, dit Glénard, parce que, ce 11 avril, on avait vainement essayé d’empoisonner le Saint-Père.
Ne pouvant réussir par les moyens ordinaires, les ambassadeurs de Loigny recoururent à la ruse. Grâce à la connivence d’un domestique du Vatican, grassement payé, un des envoyés du pseudo-couvent put voir le Pape et lui parler librement. Léon XIII connut les complots de ses ennemis et fut instruit de la vérité qu’on lui cachait. Après cet entretien, écrivent les sectaires, le Souverain Pontife, pleinement convaincu de la divinité de l’œuvre de Loigny, était résolu à l’approuver publiquement. C’était dévoiler en même temps les fourberies dont il était victime. Il n’attendait que le moment opportun. Mais les traîtres de son entourage, las de le voir enclin à des pensées si menaçantes pour eux, ont prétendu que la Saint-Père était frappé de démence et l’ont enfermé dans les caves du Vatican. Il y est resté un an, de Pâques 1892 à Pâques 1893.
Il aurait été délivré par le général Duc de Bustelli-Foscolo et Vincenzo Salvucci. Depuis, Sa Sainteté a jusqu’à présent gardé le silence, par crainte du scandale.
Qui aurait enfermé le pape ? Selon l’abbé Joseph Xaé et Louis Glénard, ce fut par « le cardinal Monaco-Lavaletta, le chef de la bande, les cardinaux Rampolla, Parocchi, le traître Sallua, etc. Ils sont une bande terrible, composant presque tout l’entourage de notre très bon Saint-Père, le pape Léon XIII, dont, depuis longtemps, ils usurpent l’Autorité Pontificale et lequel, après avoir tenté de l’empoisonner, ils ont emprisonné pendant un an. Aujourd’hui, encore, ils le traitent moralement comme un esclave. »
Pendant que Léon XIII était ainsi séquestré, disaient encore la voyante et ses partisans, un grand Calabrais, qui, par sa tournure, ses traits, le son de sa voix, ressemblaient beaucoup au vrai Pape, le représentait devant la chrétienté et figurait dans les occasions solennelles.
Cet état de choses aurait duré longtemps, si les amis de Loigny, en janvier 1893, n’avaient appris l’indigne traitement infligé au Souverain Pontife. Décidés à y mettre fin, ils achetèrent pour 60 000 francs, dit-on, les geôliers du Saint-Père, et, par un hardi coup de main opéré la nuit, parvinrent à le remettre dans ses appartements sous la garde de ses fidèles Suisses.
Il est facile de comprendre que d’astucieux personnages, habiles à jouer tous les rôles, avaient escomptés la crédulité des ambassadeurs de Loigny et encaissé leur argent.[143]
Glénard et son compagnon ainsi mystifiés, pensèrent que le Pape, reconnaissant de leurs services, accueillerait publiquement les partisans de Loigny et proclamerait la justice de leur cause. Hélas ! Non. Le Saint-Père, racontaient-ils, les fit remercier en secret ; mais trop indulgent et par crainte d’ébruiter cette scandaleuse affaire, il n’osa pas sévir contre les cardinaux coupables et se contenta de leur apparente soumission. Aussi, deux mois plus tard, les hypocrites avaient de nouveau levé la tête, et, par leurs intrigues, accaparé le gouvernement de l’Eglise. Si bien que le Pape n’était plus emprisonné dans un souterrain, il est vrai, mais enfermé dans ses appartements et réduit à la plus désolante inaction.
Alexis Jordan, informé de la délivrance du pape à Pâques 1893, en avisa un de ses amis, le Dr Jean de Pauly (célèbre hébraïsant, traducteur du Zohar), qui se précipite à Rome et dévoile la supercherie. Mais il se refuse à croire à l'escroquerie, continue ses subventions et refuse de porter plainte.
Jean de Pauly partit pour Rome où il demandait audience à Léon XIII, dont il avait l'honneur d'être personnellement connu. Jean de Pauly tenta les démarches nécessaires pour l'arrestation des escrocs. Il publia la brochure : Le Faux-Pape ou les Effrontés fin de siècle stigmatisés et livrés à l'indignation et au mépris de tous les honnêtes gens (1893).
Les partisans de la voyante de Loigny publièrent, eux, la brochure : Compte rendu de la délivrance du Pape. Cette publication intempestive effraya un des escrocs nommé Perrazelli, qui, pour éviter le châtiment dont il se sentait menacé, dévoila tout dans une lettre à la police italienne. En conséquence la bande fut arrêtée au mois d’octobre 1893 et mise en prison préventive. Le procès commença devant le tribunal de Rome le 31 mai 1894 ; les mensonges et les roueries des inculpés parurent au grand jour.
L’organisatrice de cette lucrative filouterie était la fameuse comtesse de Saint-Arnaud, aventurière aux mœurs équivoques, qui prétendait avoir engagé ses joyaux de famille et ses tableaux pour délivrer Léon XIII, enfermé dans un cachot des catacombes.
C’est elle qui, moyennant une forte somme, dit-elle, a persuadé à l’archiduc Jean-Salvator de Lorraine, chef des geôliers du Pape, de laisser rendre la liberté au Saint-Père et de se dérober ensuite à la colère des cardinaux en fuyant loin de Rome.
Quant aux autres complices, le soi-disant duc de Bustelli-Foscolo avait déjà été condamné à Paris à un an de prison pour escroquerie. Martinucci, en imitant l’écriture de Léon XIII, avait fabriqué les fausses pièces sur lesquelles s’appuyait la puérile crédulité des sectaires de Loigny pour affirmer la captivité du Saint-Père et de se dire ses enfants bien-aimés. Enfin, le prétendu chevalier Salvucci, un vieillard jadis cuisinier des Bonaparte et des Torlonia, reconnaissait s’être prêté à cette scandaleuse mystification en jouant le rôle de témoin. Il était venu affirmer d’abord aux représentants de Loigny qu’il avait vu le Pape dans les chaînes et, plus tard, la nuit, assisté à sa délivrance.
Les trois premiers accusés se virent infliger quinze mois de réclusion, plus une amende, le quatrième n’eut que sept mois ; mais une amnistie, accordée à l’occasion des noces d’argent du roi, abrégea de beaucoup la peine et enleva l’amende. Le dénonciateur Perrazelli fut mis hors de cause.
Glénard et son compagnon auraient voulu faire citer comme témoins au procès les cardinaux et le Pape lui-même. Ils demandaient surtout que Léon XIII vînt en personne affirmer, devant le tribunal, la réalité de son incarcération. Les juges refusèrent…
Les deux ambassadeurs de Loigny gardèrent intactes leur confiance aux condamnés, qu’ils appelaient des victimes (ils furent drogués selon eux), et leur foi aux fables extravagantes dont on les avait leurrés.
Ils protestèrent dans un Rapport présenté par les deux pèlerins de Loigny aux membres du tribunal correctionnel de Rome, pour servir de défense aux accusés, leurs amis, et confondre les accusateurs secrets, vrais coupables, s.d., Protestation de MM. l'abbé Joseph Xaé et Louis Glénard, contre la fausse accusation d'escroquerie, portée contre les auteurs de la délivrance de S. S. Léon XIII, qui a donné lieu à leur détention préventive.
Malgré toutes les condamnations civiles et religieuses, Mathilde Marchat maintenait opiniâtrement toutes ses déclarations précédentes. Oui, selon elle, le vrai Pape continuait d’être réellement séquestré ; oui c’étaient des affidés de l’enfer qui voulaient tuer Loigny à coup de décrets.
Ce qui entretenait l’esprit de prosélytisme et l’aveugle confiance dans l’avenir chez les disciples de la voyante, c’est qu’à Rome le comtesse de Saint-Arnaud, sortie de prison en novembre 1894, avait repris son ascendant sur les crédules ambassadeurs du Sacré-Cœur et réussissait à exalter leurs espérances.
Elle leur fit croire que des gardes nobles et autres personnages du Vatican portaient ses lettres au Pape séquestré et lui transmettaient les réponses de l’auguste Pontife.
Elle pouvait même, disait-elle, le voir dans ses appartements quand elle le voulait.
Aussi, pour faciliter tous ces services, un loygniste de marque, le riche M. Jordan, de Lyon, payait bientôt, 50 000 francs pièce, deux machines phonographiques Edison qui enregistraient automatiquement les conversations tenues dans le cabinet du Saint-Père.
Un consistoire devait se tenir à Rome le 2 décembre 1895. Mathilde Marchat, informée de cette décision, s’empressa de faire espérer à tous qu’en ce jour privilégié, vingt-cinquième anniversaire de la célèbre bataille, le Pape approuverait solennellement, à la face du monde entier, les manifestations surnaturelles et la communauté de Loigny.
A cet effet, deux messages destinés au Saint-Père furent écrits comme ayant été dictés par le Sacré-Cœur de Jésus-Pénitent, à Mathilde Marchat, sa fidèle servante, dans les apparitions des 17 et 27 octobre. On chargea la comtesse de Saint-Arnaud de les faire parvenir directement à leur adresse. Chaque fois il était enjoint au Souverain Pontife de proclamer la divinité de l’œuvre de Loigny. Un groupe de pèlerins, accompagnant la voyante, devait, par ordre du Ciel, se retrouver à Rome au jour fixé pour la levée de l’interdit.
Dans le consistoire secret qui eut lieu le 29 novembre, le vrai Léon XIII, libre pour un moment, imposa sa volonté aux cardinaux rebelles et déclara officiellement sa foi aux visions de Marie-Geneviève du Sacré-Cœur de Jésus. Le 2 décembre suivant, dans le Consistoire public, le Pape ne put parler à cause d’une extinction de voix, mais il fit lire une déclaration écrite de sa main par laquelle il bénissait la communauté et les œuvres de charité des Epouses du Sacré-Cœur de Jésus à Loigny, et reconnaissait comme divines les visions de Marie-Geneviève du Sacré-Cœur.
Le jour même, un texte latin de cette déclaration, écrit tout entier, affirmait-on, par Léon XIII, et signé de lui, était remis, comme preuve indiscutable, aux pèlerins de Loigny venus à Rome.
Mme de Saint-Arnaud fut naturellement le guide des pèlerins de Loigny pendant les trois semaines de leur séjour à Rome. Ceux-ci doutèrent bien parfois de la sincérité de leur confidente, surtout quand ils la virent impuissante à leur procurer une audience privée du Saint-Père.
Mais la rusée comtesse sut détourner leur courroux sur Rampolla, « Secrétaire d’Etat des princes de l’enfer ». C’est ce cardinal franc-maçon, disait-elle, qui leur fermait toutes les avenues.
Aussi rentrèrent-ils en France contents, somme toute, de leur voyage, parce qu’ils rapportaient l’approbation papale, bien authentique, de la sainte communauté de Loigny.[144]
La communauté perdure cependant (une dizaine de membres), alimentée par la fortune de Mme Trouillet (d'Angers) qui permet des constructions, accueille des orphelines et ouvre une école (une des Epouses ayant un brevet d'enseignement), malgré l'hostilité de la commune mais avec la bénédiction du Conseil départemental. A la mort de J. Duchon (remplacée par une demoiselle Bourgoin, Soeur Sainte-Marie Emmanuel, décédée le 05.02.1907), ses héritiers réclament ses biens et obtiennent finalement une transaction (03.1896). Toujours à Rome, de nouveaux bernés Glénard et l'abbé Xaé dénoncent une nouvelle séquestration du pape, remplacé par un sosie, affirment que Léon XIII les approuve. Mais le Saint-Office recondamne (1896), ce qui n'empêche pas la croissance de la communauté (une vingtaine d'Epouses) entretenue par des dons (plus de 400 000 F et la constitution d'une Société civile de Loigny gérant les dons et les propriétés (notamment une ferme et l'abbaye de Noirlac) achetées sous plusieurs noms.
Le riche Jordan s’aperçut à la fin que sa fortune, comme neige au soleil, fondait à vue d’œil et commença à être moins prodigue. Il mourut le 7 février 1897.
A Rome, non seulement on ne parvenait pas à obtenir du vrai Léon XIII la confirmation publique de ce qu’il était censé avoir fait pour le couvent, mais la Saint-Arnaud devenait de plus en plus exigeante et mendiait même des suppléments à son allocation mensuelle.
Glénard ne se lassait plus de répéter que la comtesse était un être sans conscience, sans mœurs, un demi-démon féminin aux ordres des diables du Vatican. Il accusait aussi son associé, l’abbé Xaé de lui cacher toutes ses démarches, d’être de connivence avec les ennemis de Loigny, de dilapider la caisse de l’Ouvre, et même de chercher à lui extorquer de l’argent en lui présentant une fausse lettre du Pape ; si bien que ce jour-là, une lutte avait eu lieu entre les deux frères d’ambassade. Par contre, son associé le menaçait, lui, Glénard, de le faire enfermer dans une maison de fous.[145]
Mathilde Marchat essaya de ramener la paix entre ses partisans, sans succès. Elle mourut le 18 avril 1899.
Après la mort de la voyante, Glénard persévère dans le prophétisme apocalyptique (L’Avenir très prochain : révélations contemporaines comparées, leur concordance…, 1901). Condamné à une amende avec les autres partisans en 1902 pour appartenance à une congrégation non autorisée, il participe à l'appel, au pourvoi en cassation et bénéficie de l'amnistie (1902-1905). Il est de toutes les batailles juridiques contre le liquidateur (notamment la maison qu'il a achetée en 1888 est disjointe en 1907 des autres biens de la congrégation, mais étant considérée comme de l'usage exclusif de la communauté, la propriété ne lui en est pas reconnue). Seule la mort arrête son ardeur, toujours persuadé que les cardinaux avaient séquestré le Pape.
Par contre, l’abbé Xaé eut le courage de reconnaître ses fautes. Il fit son abjuration à Rome le 10 octobre 1899, reçut le pardon du Saint-Siège, fut mis plus tard à la tête d’une paroisse dans son diocèse, Giriviller, et répara ses erreurs passées par un dévouement exemplaire au salut des âmes.
Pour terminer, faisons ces quelques remarques :
La voyante M. Marchat a été persécutée seulement depuis qu’elle annonça la venue de Charles XI. Auparavant, plusieurs évêques l’avaient visité et l’avaient surnommée la seconde Marguerite-Marie.
Dès le début, Charles XI et le journal la Légitimité, mirent en garde leurs partisans contre la voyante de Loigny. La Légitimité publiait à chaque fois les décrets du Saint-Office au sujet de Mathilde Marchat.
Il n’a été question, dans les décrets de la Sacré Congrégation du Saint-Office, que des prétendues visions et extases de Mathilde Marchat.
Dans ses fausses visions Mathilde Marchat ne s’occupe que de Louis XVII et de sa descendance. Or le Saint-Siège déclare ne condamner que ces visions en elle-même et refuse de porter un jugement quelconque sur la thèse historique qui s’y trouve accidentellement mêlée.
Le Saint-Office déclare en termes officiels qu’il n’entend nullement impliquer dans sa condamnation la thèse historique que défendent les naundorffistes. Nous sommes loin de la phrase de Grégoire XVI « qui falso Normandiae ducem se jactat ». Grégoire XVI fut trompé, Léon XIII ne l’est pas.
Sous Grégoire XVI, aucune publication n’était venue apprendre la vérité au Saint-Siège, tandis que, sous Léon XIII, plus de vingt ouvrages traitant de la question Louis XVII ont été publiés.
XII] Le Dossier Rouge
Il existe au Ministère des Affaires Etrangères, un « Dossier Rouge » contenant des documents de première importance sur l’identité Naundorff-Louis XVII.
Robert Ambelain écrit, dans son livre : Crimes et secrets d’Etat, (Robert Laffont, Paris, 1980), pages 142-143 :
« Le Dossier Rouge des Affaires étrangères rendit naundorffiste Clemenceau, Aristide Briand et Pierre Laval.
M. Augustin Chaboseau, qui fut grand-maître d’un des divers ordres martinistes et tenait de ce courant initiatique la tradition de la Survivance de Louis XVII, fut le secrétaire de Clemenceau avant la 1ère guerre mondiale.
M. Chaboseau avait pris connaissance, comme secrétaire de Georges Clemenceau en 1906, du célèbre dossier. Il nous confirma en 1942 l’extrême intérêt des pièces le constituant. Ayant par la suite initié Aristide Briand au 3ème degré du Martinisme traditionnel, il lui conseilla la lecture du « dossier rouge », et c’est ainsi que Briand devint naundorffiste. Quant à Pierre Laval, ce fut Briand qui lui révéla l’existence du célèbre dossier, comme une arme de 1ère force pour briser, en cas de danger sérieux, toute tentative de renversement de la République au profit de la Maison d’Orléans. »
Voici des extraits d’un article de M. Alain Decaux, paru dans l’hebdomadaire Quatre et Trois du 1er août 1946 :
Le Dossier Rouge existe. Nous possédons à cet égard trois témoignages qui concordent parfaitement entre eux :
1° Jules Favre qui, fut ministre des Affaires Etrangères et aussi avocat de Naundorff, dit à M. Naquet, député, qui en a témoigné par écrit le 18 mai 1887 :
« Ma conviction se fonde sur des pièces diplomatiques que j’ai vues lorsque je suis passé aux Affaires Etrangères et dont il ne m’est pas possible de me servir… »
2° M. Girard de Rialle, ministre plénipotentiaire de France qui en parla à M. Foreau, rédacteur au Petit Journal, qui en a témoigné quand celui-ci lui confia qu’il s’occupait de la question Louis XVII au point de vue historique :
« - De quel Louis XVII ? demanda M. de Rialle.
- De Naundorff, parbleu.
- Eh bien, vous avez raison.
- Je le sais bien, que j’ai raison.
Vous le savez bien. Mais pas si bien que moi, reprit M. de Rialle. J’en ai vu toutes les preuves dans un dossier des Affaires Etrangères. »
3° La marquise d’Horschel, lors de son premier passage à la Présidence du Conseil, vint prier Clemenceau de lui dire si, oui ou non, existait un dossier secret de la question Louis XVII, et dans le premier cas, de bien vouloir le lui communiquer. Clemenceau demanda quelques jours et à la Marquise, revenue le voir, fit cette réponse :
« Le dossier est ici, dans mon cabinet, mais il n’en sortira pas, car il y a là un secret d’Etat. Pourtant, je vous promets que la vérité sera dévoilée. »
Clemenceau est mort sans avoir satisfait la curiosité de la Marquise. M. Bidault va-t-il non seulement satisfaire la notre, mais aussi, mais surtout accomplir un geste qui peut avoir pour la France une importance extrême. Nous l’espérons.
A cet article, il y eut une réponse… du chef de cabinet de M. Bidault, qui annonçait au journal Quatre et Trois qu’il ordonnait des recherches immédiates et qu’il en suivrait le cours pour qu’elles soient menées à bien.[146]
En 1948, une lettre de Monsieur Georges Bidault, alors ministre des Affaires étrangères, adressée au conservateur du Donjon de Vincennes, M. Hurtret, déclarait que ce dossier avait été égaré pendant l'Occupation.[147] Et depuis, le dossier demeure introuvable, qu'il ait été réellement égaré, ou qu'il demeure délibérément occulté sous un prétexte fallacieux Il n'en reste pas moins que cette dernière lettre prouve qu'il a bien existé. C'est ce dossier fantôme que l'on a appelé le dossier rouge, et ensuite le dossier vert.
Voici maintenant trois articles, parus dans Flos Florum :
« Au cours d’un séjour fait en Belgique au mois de juillet 1948, nous eûmes l’occasion de rencontrer dans le Hainaut, à une réunion de famille, un jeune cousin français qui se trouvait en villégiature. Nous le savions sorti de l’Ecole des Chartes et occupant la situation d’archiviste au Ministère des Affaires Etrangères à Paris. Quelle belle aubaine que de parler du « dossier rouge » à ce jeune parent bien que rencontré pour la première fois, mais dont nous avions connu la famille.
A notre question : Connaissez-vous le « Dossier Rouge » ? Quelle ne fut pas notre agréable surprise de l’entendre nous répondre tout de go : le « Dossier Rouge » ? Mais c’est dans notre service, et nous l’avons manié tout récemment, et dernièrement encore, notre Chef nous a dit : « Il vous faudra ne pas oublier d’ouvrir ce fameux dossier ».
Puis, comme nous demandions quelques précisions, elles nous furent données tout aussitôt :
« Le Dossier Rouge consiste en un coffret de 40 à 50 centimètres, recouvert de velours cramoisi et scellé de 12 cachets de plomb aux armes Pontificales. Il fut envoyé du Vatican au Ministère des Affaires Etrangères, vers 1850, pour être ouvert seulement 100 ans plus tard. »
Nous trouvons la preuve de ce que nous avançons dans la lettre que nous écrivait, le 15 mars 1948, du 159 avenue de Suffren, Monsieur Sylvain Bonmariage (Comte B. de Cergy d’Erville) et dont nous citions le passage suivant :
« Monsieur Clemenceau, Président du Conseil, dont je fus le collaborateur, reçut en 1906 la visite de la Duchesse d’Uzès, qui était son amie et de la Comtesse de Martimprey.
Elles le supplièrent de lire ce dossier et d’en divulguer le contenu. Il le lut, et se retrancha derrière un secret d’Etat.
Lors du Traité de Versailles, il se fit apporter l’anneau de Naundorff, honoraire symbolique de ce dernier à Jules Favre, extrait du Dossier Rouge. Il scella de ce chaton le Traité. Pourquoi ? Parce que c’est de même que Jules Favre signa le Traité de Francfort… »[148]
M. Cercy d’Erville rapporte que d’après Hanotaux, le dossier se composait : 1) d’un rapport de police et de pièces prélevées sur Naundorff arrêté (les fameuses 202 pièces) ; 2) de communications de la Cour de Prusse et de la Cour de Rome à la Chancellerie française ; 3) du dossier de Jules Favre. Au Dossier Rouge, « ont été jointes toutes les pièces qui servirent à Jules Favre pour plaider et l’anneau donné à cet avocat par son client. Le fait a été affirmé par Clémenceau devant le directeur de son cabinet, M. Fontin, trésorier-payeur-général du Var, M. Cahen, rédacteur au « Temps » et devant moi-même. »
« Notre correspondant l’avait bien vue de ses yeux de myope (il porte des lunettes) et enfermée dans la chambre forte, et par suite, une pièce assez obscure. Il avait vu les cachets intacts, mais ne s’était pas rendu compte que les liens qui les rejoignaient avaient été coupés.
C’est qu’en effet, d’après les explications qu’il put obtenir plus tard, il apprit que, lors de l’approche des troupes d’occupation, ladite cassette avait été jugée trop encombrante, vidée de son contenu, et les papiers, comme tous les autres dossiers précieux des affaires étrangères, transportés en Touraine, précisons au Château de Rochecotte.
Les dits dossiers réintégrèrent les archives du Ministère des Affaires Etrangères en 1944, mais hélas, ceux que contenait précédemment la fameuse cassette furent-ils aussi rapportés ? On peut en douter, car, d’après l’inventaire fait par notre jeune ami, ceux qui restent datent du temps de Louis-Philippe, et sont dénués de tout intérêt.
Les plus importants, les plus anciens tout au moins, ont-ils disparus ? Cela paraît probable. »[149]
« Où est ce dossier, existe-t-il vraiment ?
Le 3 février 1919, un des descendants de Naundorff, le Prince Louis, adressait une lettre à M. Raymond Poincaré, lui demandant l’autorisation de « prendre connaissance de toutes pièces et documents qui se trouvent… depuis 1874, lorsque Jules Favre nous les fit connaître, au Ministère des Affaires Etrangères… ».
Le 14 février 1919, le Ministre plénipotentiaire, chef de service, signé illisible, répondait : « en ce qui concerne les archives des Affaires Etrangères, je dois vous informer que les recherches faits à l’occasion du débat soulevé au Sénat en 1911 sont demeurées sans résultat. Je fais toutefois procéder à de nouvelles investigations et, s’il est possible de trouver au dépôt des Affaires Etrangères des documents relatifs à la question qui vous intéresse, je ne manquerai pas, après avoir recueilli l’avis de la Commission des Archives diplomatiques, de vous faire connaître la décision que j’aurai prise… ».
Officiellement, il n’est pas répondu que « rien n’existe », mais qu’on soumettra l’éventuelle communication de ces pièces à l’avis de la Commission des Archives Diplomatiques… Ce qui n’empêche pas certains adversaires de la Survivance, denier farouchement l’existence de ces documents, qui disent-ils, n’existent que… dans l’imagination des Survivantistes.
Nous livrons à la méditation ces deux lettres reçues ces jours derniers par le Président du Cercle Louis XVII, qui tait les noms des signataires, sur leur demande d’ailleurs, pour des raisons faciles à deviner, en lisant ces lettres.
Voici la première :
Le 16/12/1953.
Monsieur,
Quelques années avant la guerre 1935-1945, à la suite d’une conversation sur la question Louis XVII, un de mes amis, Monsieur F… B…, magistrat à Paris, me narra les faits suivants :
Alors qu’il était à la Chancellerie, Clemenceau, alors ministre, le fit appeler, lui dit qu’il venait d’être saisi d’une demande d’enquête (enquête privé) sur la question de la survivance possible de Louis XVII et sur Naundorff et son identité avec le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il le chargea de cette enquête ; c’est-à-dire de vérifier et d’examiner, pièce par pièce, le « Dossier Rouge » du Ministère des Affaires Etrangères, ou du moins le dossier connu sous ce nom.
M. F… B… effectua ce travail et fut, d’après l’examen des documents, entièrement convaincu et de la survie de Louis XVII et de son identité avec Naundorff.
Il fit un rapport dans ce sens qu’il remit à Clemenceau. Celui-ci après en avoir pris connaissance, dit à M. B…. : « C’est bien, faites disparaître cela et qu’on m’en parle jamais plus. »
Par ce curieux enchaînement de hasards fâcheux qui semble s’attacher toujours à l’affaire Naundorff, M. F… B… mourut brusquement peu après cette conversation et je n’ai jamais vu les documents en question.
Qu’il me soit cependant permis de vous signaler ceci : M. F… B… possédait une propriété à Saint-X… Après la guerre de 1939-1945, la maison fut cambriolée sans qu’aucun vol n’ait été commis, mais la bibliothèque et tous les papiers avaient été renversés et jetés dans le plus grand désordre. Quand le cambriolage me fut conté, je m’écriais : « qui sait si quelqu’un ne cherchait pas les papiers Naundorff ? »
Personne de la famille ne comprit d’abord de quoi il s’agissait, car M. F… B… n’avait pas raconté aux siens la mission dont il avait été chargé. Ce qui n’avait d’ailleurs rien de surprenant, étant donné le moment où elle avait eu lieu. Mais mon exclamation intéressa M. J… D…, gendre de M. F… B…, avocat… (Ancien magistrat et fils d’un conseiller à la Cour de Cassation). A lui, je racontais à mon tour ce que m’avait narré son défunt beau-père. Il chercha vainement dans les papiers de celui-ci les copies en question et n’en retrouva pas la moindre trace.
Voilà, Monsieur, un témoignage malheureusement bien incomplet mais qui pourra peut-être un jour vous être utile dans les intéressantes recherches historiques que vous poursuivez. Veuillez croire à ma considération la plus distinguée.
B.M., agrégé d’Histoire, Paris.
Et voici un extrait de la seconde lettre qui confirme, point par point, la précédente :
« … Clemenceau ouvrit les deux portefeuilles de marocain, le rouge et le vert, qui se trouvent scellés au Ministère des Affaires Etrangères et il déclara à son neveu, mon beau-père, le Comte de B… qu’il y avait là de quoi faire sauter des trônes d’Europe et qu’il ne fallait jamais livrer au public ces documents.
Csse de V…
Tout commentaire affaiblirait la portée de ces lettres émanant de personnes ne se connaissant nullement l’une l’autre, le signataire de ces lignes s’en est assuré.
Qu’en disent nos adversaires ?
B. de Gravel. »[150]
Louis XVII-Naundorff raconte, pages 68-69 de l’Abrégé des infortunes :
« Dans les temps de mon emprisonnement à la tour du Temple, avec mon père et Cléry, de nombreux amis songeaient à me délivrer des mains qui me tenaient enchaîné. Ma bonne mère partageait ces espérances. En conséquence, elle écrivit elle-même toutes les marques que je portais sur mon corps, afin qu’en cas d’évasion, je fusse en tous les cas infailliblement reconnu. Ce papier se trouvait avec d’autres preuves entre les mains de Montmorin, et pour les mettre en sûreté, il les avait cousus dans le collet de ma redingote, en me recommandant avec instance de ne les confier à personne, parce que ce serait la constatation irrécusable de mon identité devant les rois et leur justice. C’est de là qu’est venu le bruit que la reine de France avait marqué ses enfants, tantôt par la bague, tantôt par un tatouage, tantôt par d’autres moyens ; et surtout qu’elle avait fait à la cuisse gauche de son fils l’image du Saint-Esprit en forme de pigeon, les ailes ouvertes et plongeant. Ce signe, dessiné par des veines, a été parfaitement décrit par ma mère ; et mon père, en confirmant la description de sa conformité, l’a scellé de sa signature et de l’empreinte du cachet dont il se servait à la tour du Temple. »
Ces divers papiers que Montmorin avait cousus dans le collet de sa redingote, ce sont ceux-là mêmes que Louis XVII, décousant ledit collet, présenta plus tard au conseiller Lecocq, chef de la police de Berlin, papiers qui, présentés au ministre de l’Intérieur, ne furent jamais restitués, et que le prince August-Wilhelm de Prusse attesta avoir retrouvés par hasard, après la Première Guerre mondiale, dans les archives de la Wilhelmstrasse à Berlin. Ce fait fut encore attesté par la prince Charles-Edouard de Saxe-Cobourg et Gotha le 27 mars 1950, et la 4 mai 1950, Me Willem-Aric Schmidt, notaire au siège de La Haye (Pays-Bas), enregistrait officiellement par devant témoins un troisième témoignage, celui de M. Carel-Joseph-Anton Begeer, directeur général de la firme royale néerlandaise de métaux précieux Van Kempen-Begeer-Vos S.A., à Voorschoten (Pays-Bas).
Robert Ambelain a reçu de vive voix le témoignage de M. Begeer, et aussi d’autres renseignements manuscrits, au sujet de ces papiers.
Voici le texte notarial en question :
« Devant moi, Willem-Aric Schmidt, notaire au siège de La Haye, aujourd’hui 4 mai 1950, a comparu M. Carel-Joseph-Anton Begeer, directeur général de la firme néerlandaise de métaux précieux Van Kempen-Begeer-Vos S.A., à Voorschoten. Le comparant a déclaré en la présence des témoins ci-après mentionnés ce qui suit :
« Le vendredi 19 août 1949, je rendis visite à S.A.R. Charles-Edouard duc de Saxe-Cobourg et Gotha, en son château de Callenberg près de Cobourg. Durant notre conversation fut abordé le sujet Naundorff-Louis XVII. Je fis part à S.A.R. de circonstances relatives à mes recherches en cette affaire, et je lui montrai les résultats de mes travaux bio-généalogiques. A propos de cet exposé, S.A.R. me fit part que feu son beau-père, le prince August-Wilhelm de Prusse, lui avait dit que, lorsqu’il s’était occupé,après la Première Guerre mondiale, de recherches dans les archives, le dossier de cette affaire lui était tombé entre les mains par hasard. Il y avait constaté l’existence, en plus de lettres adressées par Louis XVII au président de police Lecocq, au chancelier d’Etat von Hardenberg, et à S. M. Le roi Frédéric-Guillaume III, de documents probants et souvent recherchés, qui avaient été mis en dépôt par Louis XVII au président de police Lecocq (à l’époque conseiller d’Etat, plus tard président de gouvernement et de police), documents d’où ressortait clairement l’identité Louis XVII-Naundorff.
Le comparant a, devant moi, notaire, affirmé par serment l’exactitude de cette déclaration, en la présence des témoins ci-après. Etc. »
Cette déclaration de M. Begeer a ensuite été confirmée le 22 mars 1950 par S.A.R. le duc de Saxe-Cobourg et Gotha lui-même.
On comprend maintenant comment les documents prouvant cette identité suffirent – renseignements pris – au roi de Hollande pour restituer au malheureux Naundorff sa véritable identité. Toutes les preuves possibles ne peuvent rien contre la Raison d’Etat, d’où l’aveu de M. Delaborde, membre de la Cour de cassation, rendant un arrêt dans le procès plaidé en 1874 par Jules Favre :
« Nous ne pouvons rendre un arrêt qui changerait toute l’histoire de France... »
XIII] Le faux Dauphin Richemont
Voici juste quelques informations à propos d’un des plus fameux faux Louis XVII.
Nous savons aujourd’hui que Richemont n’est autre que Claude Perrin, né à Lagnieu le 7 septembre 1786.
Pour se défendre, Richemont affirme : « Claude Perrin, qu’on nous désigne sous le nom de Perrin le bossu, avait une épaule plus haute que l’autre. »
Peut-être, dans son enfance, mais cette infirmité était si peu sensible, qu’elle ne l’empêcha pas d’être soldat et qu’en 1816, tout Lagnieu est là pour l’attester, elle avait complètement disparu.
Richemont dit aussi : « Perrin est mort en 1846 chez son fils, libraire à Turin. »
Or le seul Claude Perrin mort à Turin, y est décédé en 1869. Il avait 64 ans et était né à Tournon. Son père s’appelait Antoine. (Renseignements communiqués par l’archevêque de Turin en 1883).
Richemont a écrit et publié par lui-même en 1831 ses Mémoires du Duc de Normandie, fils de Louis XVI.
Douze ans après, il écrit : Mémoires d’un contemporain, qui contredit ses Mémoires du Duc de Normandie, fils de Louis XVI.
Dans les Mémoires du Duc de Normandie, fils de Louis XVI, le faux dauphin Richemont n’était encore que très imparfaitement instruit ; et voilà pourquoi il n’ose indiquer ni date, ni nom, ni désignation précise d’aucun lieu ; il ne connaît même pas l’époque ni le mode de l’évasion, entasse les uns sur les autres des énormités.
Richemont ne tardera pas à désavouer la publication de 1831. Il tardera beaucoup trop. Douze ans. Il supprima par exemple les Sauvages. (Il écrivait qu’il resta « plus de 6 ans, tout seul, nu comme eux, le corps peint, etc. Ces Sauvages s’appelaient les Mamelucks. »)
Richemont prétend avoir eu la petite vérole dans la Tour du Temple. Voilà encore une bévue capitale : le fils de Louis XVI avait été inoculé et n’eut jamais cette maladie.
Les richemontistes affirment que Richemont bénéficia de nombreuses reconnaissances émanées de personnes semblant également fort qualifiées : Mme Bequet, qui avait été au service de Marie-Antoinette jusqu’au 10 août ; Mme Fillette, qui avait été fille de garde-robe du Dauphin ; que Mme de Rambaud elle-même après avoir déclaré que Naundorff était Louis XVII, certifie que Richemont l’était aussi, « s’en remettant au ciel pour faire un choix. »
Nous répondons : Richemont a eu des partisans, mais il n’a pas eu de témoins compétents. La Cour a dû retenir les plus importants de ceux-ci, comme elle l’a fait pour Naundorff. Or, Mme Bequet et Mme Fillette, dans leurs dépositions écrites et signées d’elles, respectivement les 20 décembre 1842 et 15 juillet 1844, avouent n’avoir vu Richemont qu’une seule fois : « le Prince me quitta et je ne l’ai pas revu depuis… »
Quelle différence entre ces « reconnaissances » effectuées en quelques minutes de conversation seulement, et jamais renouvelées, et celles résultant de 3 années de vie commune, comme pour Naundorff et les serviteurs de la Cour de Louis XVI qui sont de grands et hauts personnages et non d’obscurs serviteurs subalternes…
Quant à Mme de Rambaud, qui a affirmé que cette phrase avait été prononcée ? L’intéressé lui-même, c’est-à-dire Richemont, qui a fait le récit de la rencontre qu’il eut, en 1843, en tête-à-tête avec Mme de Rambaud (Mémoires d’un contemporain, Paris, 1846, page 370). Mais, chose curieuse, il n’a « pas revu cette dame depuis ce jour », écrit-il lui-même. Mme de Rambaud est morte le 18 octobre 1853, âgée de 89 ans. Elle n’a jamais varié dans sa croyance à l’identité de Naundorff et des lettres de sa petite-fille, Ernestine de Rambaud, élevée par elle, le prouvent surabondamment : 26 janvier 1884 : …Elle (Mme de Rambaud) n’en a jamais reconnu d’autre (que Naundorff). Le 9 juin 1849 : « Encore aujourd’hui elle ne doute pas de son identité », etc.
Louis XVII avait les yeux bleus. Or nous savons tous que Richemont n’avait pas les yeux bleus. De tous les principaux personnages qui se sont affirmés être Louis XVII, seul Naundorff avait les yeux bleus.
En 1826, Richemont reçut, à Toulon, tous les grades maçonniques jusqu’à celui de 32e.
Richemont n’a pas de descendance légitime. Il a eu une relation avec Céline Orloff et de cette relation il a eu 4 bâtards connus.
Le baron de Richemont a vu une fois le pape.
Pie IX, convaincu de la survie de Louis XVII, mais ne voulant pas se prononcer sur la question de l’identité, aura pu croire tout d’abord à la sincérité de Richemont, sans s’engager absolument, il aura laissé quelques bonnes paroles à l’imposteur et félicité ses compagnons, dont le dévouement désintéressé méritait quelque éloge.
Pie IX a dit plus tard à M. l’abbé Blanchet : « Eh ! Oui, je savais que c’était un imposteur, et je l’ai béni tout de même. »
Tous les faux dauphins se sont démentis à un moment ou à l’autre, y compris Richemont, qui a avoué son imposture à M. Pictet.
Par une lettre publiée dans la Légitimité du 18 mai 1884, M. l’abbé Delaigue, curé-archiprêtre de Lagnieu, déclare formellement que le prétendant affublé du nom de Richemont, a été reconnu pour le sieur Claude Perrin, de Lagnieu, né en 1786, de Jean Perrin, boucher, et de Louise Morel. Il donne le témoignage de plusieurs personnes de sa paroisse et en particulier d’une propre nièce de Perrin.
Voici l’extrait de la lettre publié dans la Légitimité du 1er juin 1884, de l’abbé Pictet : « C’est bien mon père qui a reçu de Richemont en personne les susdits aveux. »[151]
XIV] Des faux prétendants mystiques
Nous allons voir maintenant deux exemples de faux prétendants mystiques, qui ont mystifié beaucoup de providentialistes.
Premier cas :
« Il existe une coterie mystique à Provins, qui se compose de vagues abbés, de religieuses ou soi-disant telles, etc. Ce personnel annonce que le duc de Normandie, issue de Louis XVII évadé du Temple, actuellement religieux cistercien, est le « Grand Monarque » prédit par les prophètes. Le futur grand monarque attend son heure dans les ombres du cloître et pour faire prendre patience à ses partisans, la Mère X… de Provins, leur fait vendre au prix réduit de mille francs des talismans infaillibles, destinés à les garantir de tout mal pendant la période de calamités qui se prépare.
Cette coterie a pour organe une feuille dirigée par un certain M. de S. B., de Nantes, auquel s’est adjoint dernièrement un M. D. d’Amiens. Un troisième personnage, M. S. de Nanterre, une « stigmatisée » ou soi-disant telle, qui depuis de longues années vaticine aux environs de Nantes, tels sont avec quelques autres, les principaux agents de la Mère X…, connue sous le nom poético-médical de « la Rose de Provins ». Ils font propagande, non pas pour Mgr le Duc de Normandie, mais au profit d’un « prétendant caché », « connu de Dieu seul », « époux mystique de la Rose. »[152]
Il s’agit en fait de :
1) Charles
de Gimel, se disant Prétendant[153]
Ce personnage fut cité par Monsieur Raoul de Warren dans son ouvrage « Les Prétendants au Trône de France ». L'auteur écrit :
« Charles de Gimel est connu sous les pseudonymes de « Lion de Judas », « Le Roi caché », ou « Le Roi du Sacré-Cœur ». Il ajoute : « Le prétendant n'a pu être identifié avec certitude, en raison du mystère dont il s'entoure. Ses partisans sont nombreux et le désignent habituellement par les noms cités précédemment, mais aussi sous celui de Duc de Normandie. Selon ses partisans, il descendait à la fois de Clovis, de Charlemagne, de Charles VII, de Louis XVI et ... du roi David… »
Depuis plus de six ans, Charles de Gimel est décédé, et son acte de décès lève définitivement les incertitudes qui, durant des années, alimenteront des hypothèses plus ou moins cohérentes.
Charles, Marie, Bernard de Gimel, retraité, était né à Châlons sur Marne, le 4 avril 1891.
Fils de Pierre Marie Joseph de Gimel et de Geneviève Marie Louise Jumeau, il aurait épousé Marie Camille le Guern de Montfort. Il est décédé en son domicile, 1 rue Tournefort à Nantes, le 31 janvier 1982 à 6H30.
Ainsi, comme il sera montré en final, la généalogie de Monsieur Charles de Gimel démontre qu'il n' y a aucune liaison possible entre ce prétendant et le véritable duc de Normandie.
Or, trompé précisément par le titre du duc de Normandie, M. Jacques Valdour a écrit une petite brochure très curieuse, intitulée « Une Mystification », parue en 1931, dans laquelle il prétend que Ch. de Gimel était un descendant de Naundorff. Cette hypothèse ne résiste pas à l'examen. Il n'en reste pas moins que « Le Lion de Judas » affirmait avoir dans ses veines du sang de Louis XVI, ce qui implique de sa part la prétention de descendre d'un quelconque « faux dauphin » évadé du Temple, qu'il se garde bien de nommer.
C'est en 1929, que le Prétendant caché commença à faire parler de lui. Selon M. Valdour, la grande animatrice du mouvement est une femme d'origine Bretonne, à allure de moniale, la mère X, qui, malgré l'intervention de l'évêque dont elle relève, s'habille en religieuse et fonde un peu partout des communautés de femmes pieuses, qui portent par là même, indûment, le costume monacal.
La mère X se dit cousine du duc de Normandie, appelée un jour à devenir son « épouse mystique », et propage partout que le prétendant mène une vie recueillie et pénitente au fond d'un monastère, en attendant le grand jour de sa restauration, jour de la venue du Grand Monarque.
L'organe du parti est « le Lion ».
Le drapeau du parti est fleurdelisé, et porte déjà 88 fleurs de lys. Cet emblème peut être contemplé par les parfaits initiés dans une chapelle secrète laquelle est située clans le sanctuaire mystique de l'organisation à Provins. Les 88 fleurs de lys du drapeau correspondent au psaume 88, dans lequel Dieu permet à David que sa race règne éternellement. Les adeptes invoquent sans arrêt « Notre clame de la Salette », et le « Christ Roi ».
Au cours de la guerre 1939-1945, l'organisation tomba en sommeil, mais vers 1947, ce mouvement reprit une recrudescence nouvelle.
Pour en savoir davantage sur ce mystérieux prétendant, il fallait faire une enquête.
En 1971, un ami de Maurice Etienne lui donna l'adresse d'un certain M. Winckler, qui avait été reçu par Monsieur Charles de Gimel à Provins.
Une visite à cette adresse fut stérile, mais le jardinier qui fut l'interlocuteur, confirma, d'une part, que cette propriété était bien celle de M. de Gimel, mais que ce dernier n'habitait plus Provins, mais Nantes, en compagnie de ses deux belles-soeurs, Madeleine et Louise Le Guern de Montfort.
Pour pouvoir entrer en rapport avec le prétendant, il fallait écrire à M. Jean Vaquié, écrivain catholique, lequel demeurait à Lyon.
Le nom du prétendant était bien Charles de Gimel, et ce dernier était veuf de Camille Le Guern de Montfort, son épouse.
Or, Camille Le Guern est la religieuse dont parlait Raoul de Warren.
La « mère Camille » fut interdite par l'évêque de Meaux, Monseigneur Gaillard, dont elle relevait.
Ayant quitté Meaux, la mère Camille et le Prétendant s'installèrent à St Symphorien Les Tours, au domaine de Beaumanoir. En 1973, une partie du domaine fut vendue, et l'une des belles-soeurs du prétendant y dirigea une « maison pour vieux ».
Pendant l'occupation allemande, le domaine de Beaumanoir ne fut pas réquisitionné, alors que toutes les propriétés importantes sises aux alentours le furent.
Pourquoi ???
Il s'y tenait de nombreuses processions en l'honneur du Christ Roi, et de la Vierge Marie, et elles ne furent jamais interdites par l'occupant.
Le prétendant vivait au milieu de ses partisans, et participait à ces processions, les partisans se désignant « les Chevaliers du Roi ».
La chapelle mystérieuse dont parle M. De Warren se trouve dans la crypte de l'église Saint-Quirias, à Provins. En 1974, l'on pouvait encore y voir la statue de Jeanne d'Arc.
Le drapeau de l'organisation portait douze fleurs de lys, et non 88 comme le soulignait M. de Warren. Au centre de ce drapeau, est un sacré-coeur.
Maurice Etienne a tenté de rencontrer M. de Gimel à Nantes, mais ce dernier n'a pas souhaité le recevoir.
M. Etienne, l'ayant toutefois aperçu conserve le souvenir d'un monsieur grand et fort, ayant une fière allure, c’était un ancien officier.
En guise de conclusion :
Ce fut un personnage mystérieux et mystique. De plus, il a aussi entretenu volontairement « l'étrange ».
Des recherches généalogiques permettent d'affirmer que ce prétendant ne descend pas de Louis XVII.
Généalogie succincte de M. Ch. De Gimel :
Pierre Laurent Marie de Gimel
Né à Montpellier, le 5 août 1776
Décédé à Embrun (Hautes Alpes), le 4 novembre 1825
Epoux de Marie Bouet
_
Charles Pierre Joseph de Gimel
Né à Yvrée en Piémont, le28 janvier 1815
Décédé à Paris 6ème, le 27 décembre 1889
Epoux de Emilie Legrand
_
Pierre Marie Joseph de Gimel
Né à Auch (Gers), le 2 février 1859
Epoux de Marie-Louise Jumeau
_
Charles de Gimel
Né à Châlons-sur-Marne, le 4 avril 1891
Décédé à Nantes, le 31 janvier 1982.
Voici maintenant le cas de Léon Millet.
2) Léon
Millet, le Roi Blanc[154]
Après de nombreuses recherches, ce prétendant a pu
être identifié, Toutefois, l'on n'a pas encore retrouvé son acte de naissance,
Il se nommerait Léon Millet et serait
né vers 1920.
Il est le fils de Xavier, Charles, François Millet et de
Placida de Barueta, et est l'aîné de quatre enfants. L'on a retrouvé
l'existence de ses frères et soeurs permettant ainsi de connaître le lieu de
naissance de l'une de ses soeurs. C'est Marie-Thérèse, née le 15 août 1923, à
Chaux-Besançon, dans le Doubs. Cette même Marie-Thérèse se maria à la Sainte-Trinité
de Marseille avec Henri-Antoine Chanuel, le 5 juillet 1947.
Léon Millet, plus connu
sous le nom de « Chevalier Blanc », de « Prince Blanc »,
ou de « Roi Blanc », a fait le voeu de ne jamais se marier. Ce
qualificatif qu'on lui a donné viendrait de la pâleur de son visage.
D'après ses partisans, il descend de Saint-Louis
et de Louis XVII. Il a répondu à une personne qui l'interrogeait
sur sa famille : « Ma mère est une noblesse » et nous
avons vu précédemment qu'elle se nommait de son nom de jeune fille : Placida de
Barueta.
Le Prince Blanc est très mystique ; il a une
grande dévotion pour Notre Dame de la Salette, ainsi que pour Saint-Michel et
aurait eu la révélation de ses origines en 1941.
Devant l'avance des Allemands, la famille Millet, d'origine Lorraine, vint s'installer à Lourdes
en 1940. Le jeune Léon venait souvent prier à la Grotte Miraculeuse. Un jour,
il y rencontra un père, du Sacré Coeur d'Amiens, qui prétendait, dans la nuit
de Noël 1942, avoir reçu de Dieu, l'ordre de fonder « La Croisade du
Rosaire » et du Magnificat.
Il devait grouper des jeunes gens, très fervents,
pour en faire les « Croisés des temps nouveaux », avec, comme devise
« Dieu le veut ». Ce père, originaire de Lorraine, se nommait Michel
Collin. Il était
arrivé à Romans (Drôme) en septembre 1940, avec un convoi de réfugiés, expulsés
de Lorraine. Monseigneur Pic, évêque de Valence, lui fit offrir les locaux
paroissiaux de Sainte-Croix de Romans, où se trouvait déjà un prêtre hollandais,
fort original, et aussi quelques religieux de la Sagesse de Niederbronn.[155]
Dans le quotidien Le Monde du 7 décembre 1955, un témoin raconte :
« Très vite, avec le père Collin, régna dans cette petite communauté, une sorte de
fièvre mystique et visionnaire. Tous les soirs, il y avait des prières
publiques dans l'église ; quand on chantait le Miserere, à certains jours,
la statue de la Vierge pleurait. .
Il y eut rapidement un noyau de fidèles, persuadés
qu'allaient se produire là, des phénomènes miraculeux extraordinaires, dont
dépendrait le salut de la France.
Le jeune Léon Millet suivit le
père Collin, et, avec sa famille, vint s'installer à Oullins,
aux environs de Lyon. Son père y exerça d’ailleurs, les fonctions de
sacristain.
Léon Millet fut
consacré chef spirituel de la Croisade. Dans le courant de l’hiver 1942-1943,
il est présenté à Romans comme un religieux se faisant appeler « Frère
Marie Bernard ». De sang royal et appelé à être le Grand Roy, il aurait
été reconnu, disait-on par le Vatican, comme prétendant au titre de lieutenant
du Sacré Coeur au royaume de France. Le groupe de fidèles et quelques ecclésiastiques,
qui étaient avec le père Collin, devinrent ses partisans.
Le père Collin, comme aumônier, allait de village en village, le
chapelet à la main, entrant dans les églises, et suivi par les populations
enthousiastes. Avec le Prince Blanc, il prenait la parole, même en présence des
hautes autorités ecclésiastiques, sans que personne intervienne pour les
contredire.
De bouche à oreille, les fidèles vous glissaient
des nouvelles surprenantes. Il s'agissait d'un prince d'Anjou, pour d'autres,
c'était un Valois, et pour la plupart, c'était un jeune homme de sang royal, un
descendant de Louis XVII. Les révélations allaient se multipliant,
l'ensemble allait dans le sens d'une libération prochaine de la France, en
dehors de la Résistance, et par une monarchie très chrétienne. Ses prophéties
se répandaient sur toute la vallée du Rhône. »
Le Roi Blanc se révéla officiellement en 1943
clans la région de Montmeyran, village de la Drôme. En juin 1943, lors de la
fête du Sacré Coeur, il y eut une grande procession au cours de laquelle le
« Roi Blanc » fit embrasser à toute l'assemblée le drapeau de la
France : blanc orné du Sacré Coeur.
Le jeune homme était vêtu de blanc. Un pantalon de
cheval, chaussettes montant jusqu'aux genoux, une tunique avec l’effigie du
Sacré-Coeur sur la poitrine, tout était blanc. Le roi blanc réunit autour de
lui de nombreux jeunes gens qui jurèrent de ne pas retourner dans leurs
familles avant de l'avoir rétabli sur le trône de France. Ils avaient fait voeu
de rester célibataire et s'intitulaient entre eux « ses chevaliers
croisés ».
Ils se connaissaient entre eux, sous le nom
« d'Apôtres des Derniers Temps. »
Dans les mois qui suivirent, il y eut une grande
cérémonie à la cathédrale de Valence.
Monseigneur Pic, évêque de Valence, avait organisé
une cérémonie à la cathédrale. Le « Roi Blanc » y assistait avec ses
fidèles ; son mouvement avant été au début encouragé par Monseigneur
Pic ; il monta en chaire pour y lire une déclaration, mais l’évêque ayant
peur d'avoir des ennuis avec les Allemands, demanda que l'on fit descendre le
Prince Blanc.
A cette même époque, une personne considérable, dit-on,
se rendit auprès du Cardinal Gerlier pour obtenir l'autorisation de lui
présenter le « Roi Blanc », et pour le père Collin, la permission de prêcher dans la cathédrale de
Lyon. L'accueil du Cardinal manqua de cordialité.
Il a été affirmé que le « Roi Blanc »
avait eu de nombreux entretiens avec de très hautes et éminentes personnalités
du Gouvernement de l'Etat français. Il est rigoureusement exact que le jeune
« Prince Blanc » rencontra à Lyon, rue Vaubécourt, chez le général
Marotte, Monsieur Jacques Chevalier, ministre du Maréchal Pétain,
avec lequel il eut
plusieurs entretiens. Il est possible qu'il y ait également rencontré un ou deux
autres ministres.
Le 19 septembre 1943, entouré de ses fidèles, le
Roi Blanc se rendit au pèlerinage de la Salette.
Par la suite, vers mars ou avril 1944, un disciple
du Père Collin, curé de Montvendre près de Valence, eut des
apparitions de la Vierge !
On organisa des processions, des prières
publiques, et, un beau dimanche, Il y eut une grande manifestation avec le
« Roi Blanc », escorté d'une dizaine de « Chevaliers du Sacré
Cœur ». Les choses se gâtèrent lorsque le clergé de Montvendre annonça le
débarquement prochain. La Milice ayant eu vent de l'affaire, arriva à Montvendre
pendant la manifestation, et emmena à la prison de Valence le « Roi
Blanc » et ses acolytes.
Relâchés quelques semaines après, ils trouvèrent
refuge dans une propriété près de Lyon, chez Madame Neyron de Champollon. Dès lors,
commença pour eux une vie clandestine de prières et de sacrifices.
Le Cardinal Gerlier, d'abord Pétainiste, puis
Gaulliste, apprit qu'un groupe de jeunes gens, accompagné du père Collin, vivait
ainsi dans son diocèse, sans lui en avoir demandé l'autorisation ; il fut
très mécontent. Il leur signifia de quitter immédiatement leur demeure. Après
bien des aventures, tous se réfugièrent au Couvent de la Compassion de Lyon,
qui avait, comme supérieure générale, une femme admirable : Mère Elisabeth
Rivet. C'était une grande mystique qui avait annoncé la
guerre de 1940 et l'envahissement de la France par les Allemands.
Convaincue de l'authenticité de la mission du père
Collin, la mère Elisabeth, supérieure générale de la
branche féminine des « Apôtres des Derniers Temps » n'hésita pas
devant le danger que cela représentait pour elle, à recevoir ces jeunes gens
dans son couvent, et à les y cacher. Elle fut trahie plus tard, et emmenée par
les Allemands au fort Saint-Luc où elle fut torturée, puis dirigée sur le camp
de Ravensbruck. Là, elle prit la place d'une mère de famille, et mourut dans la
chambre à gaz.
La Gestapo étant venue pour enquêter, nos croisés
clandestins durent se disperser et retourner dans leurs familles respectives.
Le père Collin s'installa
chez le général Marotte, à Lyon. Ce
fut le quartier général pour tous les croisés et amis du père.
A la Libération, le père Collin, le Roi Blanc, et un de leurs compagnons, furent
arrêtés chez un ami qui avait été arrêté lui-même par les F.T.P.
Cependant, le jour de la fête de Notre Dame de la
Merci, nos trois prisonniers furent libérés d'une façon inattendue. Ils
s'enfuirent à travers la forêt, et arrivèrent dans un village où le curé les
réconforta et leur donna de quoi prendre le train.
Le « Roi Blanc » a, à son actif, des
interventions extraordinaires dont voici l'une d'elles : Monsieur Jacques
Bergier, chef d'un réseau de la Résistance fut averti que
le Roi Blanc était attendu par la Gestapo dans une villa isolée. Un commando
fut monté pour le protéger, mais il arriva trop tard. Le bouclage de la Gestapo
était déjà fait. Bergier dit qu'il vit alors le Roi Blanc pénétrer dans la
villa. La Gestapo s'y précipita, chercha et ressortit bredouille. Après le
départ des Allemands, le commandant Bergier fouilla la villa sans rien y
trouver. Bergier n'eut plus de nouvelles du « Roi Blanc ».
Pour revenir au père Collin et au Roi
Blanc, ils revinrent à Lyon chez le général Marotte, grâce à la générosité du curé qui leur avait
payé leur voyage en train.
En janvier 1946, Léon Millet, alias le Roi Blanc, et le père Collin, retournèrent à Lourdes.
Le père Collin y vécut en
Saint-Prêtre, si l'on en croit certains de ceux qui l'approchèrent. Il y subit
l'ostracisme, partagé, il est vrai, par un autre prêtre, membre comme lui de la
Confrérie de l'Ancien Infini, et prononcé contre lui par l'Evêque d'alors du
lieu. La sanction fut rapportée en 1947 pour le père Collin. Cependant, le père
Collin fut condamné par l'Eglise, et rendu à l'état laïc par décision du Saint
Office.
Quant au « Roi Blanc », il a quitté le
père et ne fait plus partie de l'équipe. Il habite à Rome, ou il travaille
comme chauffeur de taxi. Il vivrait dans la prière, et il n’y a rien à lui
reprocher, car il reste un bon chrétien ne songeant, paraît-il, à poser sa
candidature en aucune façon, à quoi que ce soit.
Il vivrait ignoré, et sous la direction de prêtres
qui le dirigent, dans les voies divines comme on doit diriger tous les fidèles.
En 1950, le père Collin et le Roi
Blanc se rencontrèrent à Rome. Ce fut leur dernière entrevue, après tant
d'aventures qu'ils ont eues en commun.
Il y a quelques années, le Roi Blanc revint en
France. Accompagné par une carmélite, Ils passèrent quelques jours dans le midi
de la France, chez l'un des anciens partisans du « petit Roi ». Avant
de partir, la carmélite donna l'adresse de son couvent à Rome, mais par la
suite, l'on devait s'apercevoir que celle-ci était fausse et qu'il n'y avait
pas de Carmel à l'adresse indiquée.
Depuis, le prétendant n'a plus donné de ses
nouvelles. Cependant, nombreux sont ceux qui parlent encore de lui, et qui
sont persuadés de la sincérité et de la bonne foi du Roi Blanc.
En guise de
conclusion :
A l'état civil de la mairie de Chaux-Besançon, et à
d'autres communes du territoire de Belfort, il a été répondu que le nom de Léon
Millet était inconnu.
Quant aux origines royales du Prétendant, ou prétendues telles, il a été impossible
de les déterminer.
. Et comme Monsieur Raoul de Warren, dans son
excellent ouvrage « Les Prétendants au Trône de France », nous
conclurons que le Roi Blanc eut un impact extraordinaire sur des foules
entières, sans distinction d'opinion politique et de croyance.
Une dernière remarque est à faire :
Le prêtre hollandais qui vivait avec le père
Collin avait un
certain talent pour les fresques. Il a décoré l'église des Balmes, annexe
rurale de la paroisse de Saint-Jean Bosco de Romans,
et sur une fresque, on voit la belle collégiale de Romans, au bord de l'Isère
et sur le pont, un magnifique cavalier blanc, étendard déployé.
En ce qui concerne le père Collin, voici une petite biographie :
Clément XV (Michel Collin). Né le 13/09 /1905. Ordonné prêtre en 1933, il dit avoir des visions. En 1943, il soutient Léon Millet dit le Chevalier blanc ou le Roi blanc qui doit sauver la France. En 1946, il quitte sa congrégation des prêtres du Sacré Cœur de St-Quentin et en 1951 il est réduit à l'état laïc pour doctrines erronées. En novembre 1960, il s’installe à Clémery (Meurthe-et-Moselle), se dit le pape Clément XV. A la mort de Jean XXIII, il se fait couronner à Clémery le 9 juin 1963. Il s'assure la succession apostolique en étant consacré en 1965 par l'évêque d'une Petite Église (de la lignée Vilatte), Cyprien Damge. Sa résidence de Clémery est dénommée « Le Petit Vatican ». Il constitue un collège international de Cardinaux. Le 15 août 1964, il annonce au Sacré-Cœur de Montmartre, devant l'assistance médusée, la « consécration de la France au Sacré Cœur de Jésus, par Louis XIX, le futur roi », présente le Vicomte Gilles Arthur de La Villarmois († 1971, prétendant descendre de Jean I er le Posthume). En septembre 1969, il déclare, sous l'Arc de triomphe, « le Christ empereur de la France ». Il meurt le 23 juin 1974 à 69 ans. Il avait, disait-il, 150 000 fidèles (en fait quelques centaines en France).
Son règne est émaillé de multiples procès et condamnations avec l'Eglise, mais aussi avec la justice. Une période où Clément XV excommunie à tour de bras, ministres, inspecteurs des impôts, journalistes, communistes et francs-maçons.
A sa mort, le mouvement connaît diverses scissions, en particulier avec le schisme du groupe américain et une séparation entre conservateurs et progressistes (à la suite du stigmatisé Robert Fontaine). Un groupe canadien s'était déjà séparé de Clémery en 1968, et rapproché des « Apôtres de l'Amour Infini » (ou « Église Catholique des Apôtres des Derniers Temps »), groupe fondé en 1952 par Gaston Tremblay (« Père Jean-Grégoire »). Les anciens fidèles de Clément XV proclameront Pape G. Tremblay sous le nom de Grégoire XVII.
Aujourd'hui,
malgré un essai de résurrection de Clément XV par une « lettre du
ciel » envoyée après sa mort, l'Église se réduit à une vingtaine de Pères
et Soeurs qui continuent à célébrer à Clémery la messe de Saint Pie V. Différentes revues ont jalonné la route de
cette Petite Église : La Vérité, Lettre Mariale, Les glanes spirituelles.
XV] Naundorffisme et
« extrême-droite »
1) Drumont
Drumont fut un des « Maîtres à penser » de Maurras. Comme nous allons parler de Maurras, il est bon de rappeler l’opinion de Drumont sur la question Louis XVII.
Drumont fut survivantiste, comme il l’écrit par exemple dans la Libre parole du 18 août 1892 :
« Je n’en suis toujours pas encore arrivé à croire à l’identité de Naundorff et de Louis XVII, mais j’ai toujours été persuadé que Louis XVII n’était pas mort au Temple. »
Libre parole du mardi 11 octobre1904 :
« J’avoue, quant à moi, que je suis évasionniste comme Sardou, comme Lenôtre, comme tous ceux qui ont étudié attentivement, d’après les documents récents, l’histoire de la révolution. »
Et encore, dans Libre parole du 23 février 1911 :
« Je n’en suis pas encore arrivé à croire à l’identité de Naundorff et de Louis XVII, mais j’ai toujours été persuadé que Louis XVII n’était pas mort au Temple. […] Les Bourbons savaient que Louis XVII n’était pas mort au Temple. Voilà ma conviction. Je vous le dis parce que j’ai toujours dit ce que je pensais. »
Rappelons l’opinion de Mélanie Calvat, voyante de La Salette, à propos de Drumont :
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Galatina, 19 mai 1895.
« Cela m’étonne, mon très Révérend Père, que vous ne lisiez pas le journal : La Libre parole : c’est le plus intéressant et surtout le plus véridique de tous les journaux ; il n’est pas sous le joug, il est libre ; et, sans rancune, sans fiel, il flétrit le mal, le scandale de qui que ce soit. »[156]
Lettre de Mélanie à M. le Chanoine de Brandt
Saint-Pourçain, 11 janvier 1900.
« Mais, voici un homme comme les autres, qui, sans parler de vision, parle avec droiture et avertit la nation française des trames que ses ennemis lui préparent, or, cet homme providentiel, ce M. Edouard Drumont prêche depuis peut-être plus de huit ans, dans son journal, et nous montre l’ennemi !... Depuis, qu’ont fait les Français ? Marie a dit la CAUSE pour laquelle DIEU va nous frapper ; Drumont, inspiré de Dieu, nous dit les châtiments produits par la cause annoncée par la Reine des Prophètes. »[157]
2) Naundorff et
Maurras
L’aveu de Maurras :
Il écrit, dans l’Action Française du 22 janvier 1923, page 1, colonne 4, à propos de l’anniversaire de la mort de Louis XVI :
« Il nous parait que l’accession de la branche cadette à la légitimité est un fait destiné à rallier un jour tous les partis, toutes les familles, toute la postérité française à celui qui unit à la plénitude du droit, le souvenir de cette part douloureuse prise aux pires erreurs révolutionnaires. Un Chambord, quelle que fut la droiture de son cœur, pouvait toujours être accusé de ne rallier que les descendants des Français fidèles.
Le Duc d’Orléans peut dire : « Vous voyez, tout autant que le Martyr et ses Petits-fils, j’ai le droit, la Tradition, le programme d’ordre, de conservation, de réforme et de rénovation. Et je suis en même temps dans la faute, le regret, la réparation et la réaction que cela exige. »
Le « Martyr » est ici et ne peut être que Louis XVI, à la mort duquel est consacré tout le contexte, en raison de l’anniversaire du 21 janvier 1923. Le fils du Martyr ne peut être que Louis XVII. Et les petits-fils du Martyr ne peuvent être que les fils de Louis XVII et leurs descendants.
Voici ce qu’écrit que le Prince Charles de Bourbon, dans Flos Florum de juillet-août 1939 :
« Quelqu’un me rappelait, il y a quelques jours, la phrase écrite par M. Charles Maurras, dans le journal l’Action Française, du 22 janvier 1923 – quand parlant du duc Philippe d’Orléans, il parlait aussi du martyr (Louis XVI) et de ses Petits-fils !!!
Ceci m’amène à préciser et à publier des souvenirs anciens, tant de mon regretté frère Jean III que de moi-même, et qui sont restés nets et vivants dans ma mémoire.
En 1898, le mariage du Prince Jean de Bourbon, à Lunel, fit grand bruit dans la région, bruit qui gagna non seulement la Provence, mais l’Europe entière. Dans le même temps, se constituait aux environs d’Aix en Provence, une initiative royaliste comprenant l’élite de la jeunesse et qui prenait le nom de « Groupe royaliste provençal ». Le grand poète Mistral en était président et ses plus actifs collaborateurs étaient :
Jean Carrère, héros du soulèvement du quartier latin en 1893 à propos de l’affaire Nuger et qui devint correspondant du journal Le Temps à Rome.
Hugues de Molins, de grande activité royaliste.
Charles Maurras, académicien en herbe et déjà helléniste distingué.
Joachim Gasquet, poète de valeur reconnue.
Mme Marie Gasquet, sa charmante femme qui, à cette époque, était justement reine du félibrige ;
Et quantité d’autres qui ne participèrent pas à l’ambassade dont il va être question.
Environ un mois après son retour de voyage nuptial, le prince Jean – Jean III de Jure – fut sollicité de donner une audience à une délégation du groupe royaliste provençal. Elle était composée des personnes précitées, à l’exception de Mistral et de Charles Maurras.
Ce fut le poète Joachim Gasquet qui prit la parole, disant :
« Mgr, nous avons l’honneur de nous présenter à Votre Altesse Royale en qualité de représentants de l’unanimité du groupe royaliste provençal. Nous avons décidé de tout faire, au besoin de tout sacrifier de nos intérêts personnels, pour rendre à la France son roi légitime afin de la sauver du désordre dans lequel elle est tombée. Nous connaissons à fond l’histoire des tribulations subies par votre aïeul Louis XVII. Pour tout dire, nous sommes tous convaincus que le soi-disant Naundorff était le fils de Louis XVI et que, par conséquent, Votre Altesse Royale chef de la branche aînée de la descendance du roi martyr est bien le roi de droit.
Pour mener à bien notre action royaliste, nous avons besoin, oh ! moralement seulement, d’être approuvés et soutenus par notre Prince, aussi, sommes-nous chargés de venir demander respectueusement à Votre Altesse Royale de consentir à encourager notre mouvement, en un mot : à être notre étendard. Si votre Altesse y consent, une grande fête sera prochainement donnée, sous sa présidence, au domicile de notre Président, le poète Mistral, à Maillanne, et ce sera pour nous non seulement un immense honneur, de faire entendre à Votre Altesse Royale de toutes nos voix unies pour le salut de la France, la première acclamation du roi Jean III. »
Jean III accepta et, peu après, la grande et première réunion avait lieu. En un magnifique banquet, plus de soixante couverts réunissaient, chez Mistral les plus fervents royalistes de Provence et même d’ailleurs.
La vice-présidence était donnée à Sa Grandeur Mgr d’Aix et M. Charles Maurras était du nombre.
Jusqu’à l’année 1903, ces banquets se renouvelèrent et, chaque fois, Jean III y était acclamé, tandis que des serments étaient prononcés de lui rendre le trône de ses ancêtres.
Cette année 1903 se trouve aux environs de la fondation de la Revue Grise par Charles Maurras et Vaugeois, qui précéda celle, plus importante, de l’Action Française.
Qui ne connaît les difficultés qui empoisonnent la vie des revues et des quotidiens, surtout aux environs de leur naissance. Pour la Revue Grise, elles furent grandes. Si grandes, qu’un beau, ou pour mieux dire : un mauvais jour, une sorte de conseil de guerre fut tenu, au cours duquel fut examiné le cas de l’inculpé Jean III, qui était dans l’impossibilité de fournir les fonds, ainsi que le cas d’un autre inculpé, absolvable, celui-là, et nommé duc Philippe d’Orléans, absolvable parce que capable de « financer » l’entreprise.
Les débats furent serrès. D’après des indiscrétions, l’ont su que Vaugeois soutenait la légitimité et les droits de Jean III, tandis que Charles Maurras, jugeant sous l’angle « finances indispensables » défendait le duc Philippe. La « finance » l’emporta. Et c’est ainsi que les précurseurs et fondateurs de l’Action Française passèrent avec armes et bagages au camp orléaniste après avoir acclamé Jean III, à cette époque héritier légitime de la couronne capétienne par le sang d’Henri IV et de Louis XVI le Martyr.
Ils ne semblent pas en avoir été bien récompensés ! »
3) Un important
témoignage, sous l’Occupation
Nous nous rappelons la fameuse phrase de Sartre (écrite après la deuxième guerre mondiale !) : « On n’a jamais été aussi libre que sous l’occupation ».
Sous l’Occupation, délivré des forces occultes, certaines langues pouvaient enfin se délier, sans crainte de représailles.
A la première page du numéro 178 de l’hebdomadaire collaborationniste La Gerbe, dirigé par l’excellent Alphonse de Chateaubriant, un grand article d’André Castelot affirme que « Naundorff était Louis XVII ».[158] Cet article fait suite aux expertises du professeur Locard. Cinq mois plus tard, dans La Gerbe du 23 mai 1944, est insérée une lettre du Prince Louis de France. André Castelot présente le prince :
« Louis de France, prince d’Anjou, qui vient de nous adresser une importante déclaration, descend de Charles d’Anjou, frère de Saint Louis, qui devint roi de Naples et de Jérusalem. Cette branche dite des Capétiens directs est alliée à toutes les familles royales européennes. Le petit-fils de Charles d’Anjou fut appelé au trône de Hongrie. Il collectionne même les couronnes… et fut reconnu roi de Pologne en 1339. Sa fille épousa Jagellon dont la dynastie remplaça en Pologne celle des Capétiens. Sans vouloir entrer dans trop de détails, disons simplement que l’origine capétienne de la famille du prince d’Anjou a été reconnue par le roi d’Espagne en 1911, par le Tsar Nicolas II après avis du département héraldique du Sénat français. Cousin de l’empereur de Russie par différentes alliances, le prince d’Anjou demeure à Nice, où son père vint de s’installer au moment de la Révolution russe. Disons pour terminer qu’un récent arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 1942 reconnaît au prince Louis la qualité de prince d’Anjou de France.
Si nous vous parlons aujourd’hui de ce petit-neveu de Saint-Louis, ce n’est pas pour suivre la mode. Non ! Mais le prince d’Anjou est, comme nous, un passionné de l’affaire Louis XVII.
Voici la déclaration qu’il vient de nous envoyer. Déclaration sensationnelle, puisque pour la première fois un prince de France aborde ouvertement la question.
André Castelot. »
Voici la déclaration du Prince :
« J’appartiens à la Maison de France, mes grands-parents ont vécu à la cour et ont connu bien des hommes d’Etat, des diplomates, confidents et amis de souverains qui, pour la plupart, ont été dans le secret des secrets. J’ai eu ainsi le privilège qui manquait aux historiens et aux gens. Ce que j’ai appris, je le sais non seulement après avoir consulté les archives secrètes de notre Maison et recueilli bien des traditions orales, mais aussi de mon grand-père, le prince pierre de France, qui vécut à la cour de Russie où il était maître des cérémonies, conseiller du tsar et son grand écuyer. Le prince de Bismarck, futur chancelier, était alors ambassadeur en Russie et très lié d’amitié avec mon grand-père. Tous les deux aimaient l’Histoire et en parlaient souvent. Bismarck était certain que Naundorff était Louis XVII. Il déclara à maintes reprises au prince Pierre que les documents conservés en Allemagne ne laissaient aucun doute à ce sujet.[159]
Personnellement, la question du Dauphin, cet enfant martyr qui est de mon sang, m’a toujours ému comme un de ses proches. Je me suis toujours tu jusqu’à présent, car je craignais de mécontenter mes cousins… Soulever cette question, même en étant sincère, même en alléguant des preuves, c’est atteindre le Comte de Paris qui a toujours montré une certaine attitude défavorable à ce sujet… Cependant, mon premier devoir est d’être loyal. Je savais la vérité ; mais elle pose une quantité de problèmes qui auraient pu faire rejaillir le discrédit sur des personnes et compliquer leur situation. Devais-je parler ? Me désolidariser d’une opinion officielle dans la Maison de France ? Platon m’est cher, mais la vérité m’est plus cher encore ! J’ai donc résolu de faire ce que d’autres ont omis. J’ai consulté mon confesseur habituel qui est royaliste et fidèle au Comte de Paris, il m’engagea lui-même à bien réfléchir aux conséquences d’une telle déclaration, mais à n’écouter que la voix de ma conscience. Je puis donc vous dire aujourd’hui que j’ai bien étudié la question Naundorff à l’aide de documents inédits et confidentiels d’une authenticité absolue. J’en viens à la conclusion suivante : Naundorff était bien Louis XVII.
Voilà ce que je vous déclare sur mon honneur et avec une certitude parfaite en ma qualité de prince de France. Vous pouvez me croire.
Mes paroles ne doivent avoir aucun sens politique. La France traverse une crise bien douloureuse. La fidélité au gouvernement du Maréchal est une règle impérieuse et vitale. Avec Louis XVI la civilisation française est montée à l’échafaud… Joseph de Maistre a vu très juste lorsqu’il a soutenu que les souffrances de son époque étaient l’expiation du sang versé sous la Terreur.
Louis de France, Prince d’Anjou. »[160]
4) Hitler naundorffiste
Les dossiers secrets (cf. le chapitre sur le Dossier Rouge) furent certainement examinés par Adolf Hitler lui-même pendant la dernière guerre. Ayant essuyé un refus de la part du prince Bonaparte quant à restaurer un empire satellite en France, il se tourna vers le prince naundorffiste Louis-Jean-Henri-Charles, duc de Normandie, résidant alors aux Pays-Bas. Deux officiers de l’Etat-Major allemand vinrent lui proposer de lui confier la couronne après la guerre, et de restaurer en sa personne la monarchie en France.
Malheureusement, ayant une mauvaise vision des enjeux contre-révolutionnaires, le Prince refusa.
Un mois plus tard, rentrant un soir chez lui, il rencontra des voisins venus l’avertir que les SS l’attendaient en sa demeure pour l’arrêter. Alors membre de la Résistance hollandaise, le prince prit la fuite et devint un des héros de cette dernière.
Par contre, Adolf Hitler a stigmatisé en son journal quotidien, à la date du 3 septembre 1942, les offres de service du Comte de Paris. (Cf. Libres propos de Hitler, recueillis par Martin Bormann, Flammarion, collection temps présent, vol II, page 317.)[161]
Les descendants de Louis XVII-Naundorff possèdent dans leurs archives de famille ces documents de la reconnaissance par Hitler du prétendant naundorffiste.
XVI] Des naundorffistes, entre orthodoxie
et hétérodoxie
Nous allons maintenant voir l’histoire de certains naundorffistes, qui ont marqué leur temps, histoire peu connue, parfois peu glorieuse, mais qui constitue une page de l’histoire du naundorffisme.
Comme le rappelait Otto Friedrichs[162], « nous ne pouvons empêcher la vérité historique de s’imposer à tout le monde sans distinction d’opinion. »
1) Mme Bouche
Bouche Marguerite-Thérèse, née des Isnard, dite sœur Marie-Salomé. Principale visionnaire de la Société de Saint-Jean-Baptiste. Née en 1759.
Issue d’une vieille famille provençale, Mlle des Isnard est l’épouse d’un M. Bouche, négociant, lorsqu’elle reçoit des révélations surnaturelles dans l’église Saint-Pierre d’Avignon le 12 septembre 1810 qui lui confèrent un rôle prophétique sous le nom de sœur Salomé. Ordre lui est donné de ne rien écrire, de ne rien laisser publier de ses visions, et de porter connaissance de son œuvre aux « conducteurs des peuples » : souverains, ministres, ambassadeurs, prélats et hommes marquants par les sciences. Sa mission est de réunir en « trinité » ceux qu’elle parviendrait à convaincre de sa mystérieuse mission ; elle affirme avoir réussi par des démarches auprès du roi Charles IV d’Espagne et sa femme, prisonniers à Marseille, et de Pie VII, prisonnier à Savone. Mme Bouche aurait informé Napoléon de sa défaite avant la campagne de Russie, et aurait échoué dans ses démarches auprès de Louis XVIII après 1815.
En septembre 1819 elle est à la cour du tsar Alexandre : elle affirme plus tard ce qu’aurait été son rôle dans les démarches de l’empereur pour instaurer une alliance européenne sur des « bases révélés ». Mais, supplantée à la cour par la baronne de Krüdener (1764-1824), elle revint à Paris en 1821.
C’est alors qu’elle prend parti pour Naundorff et s’affilie à la Société de Saint-Jean-Baptiste, fondée en 1772 par Loiseaut, qui avait reçu du Précurseur la révélation de la venue du Saint-Esprit et de son règne sur la terre. La Société (ou Œuvre de Miséricorde), alors dirigée par Legros, a annoncé le prochain rétablissement du « prince légitime » ; elle est en contact avec le visionnaire Martin de Gallardon. A la mort de Legros, à qui elle succède en 1832, Marguerite-Thérèse Bouche forme une association avec trois consoeurs, « les trois Marie de l’Evangile » : elle devient la sœur Marie-Salomé, une dame Mauduit est Marie-Marthe et la comtesse de Sérione Marie-Madeleine. Mais, entrée en contact avec Vintras par l’intermédiaire de Ferdinand Geoffroy, elle lui transmet ses pouvoirs et reconnaît en lui le continuateur de l’Œuvre annoncé par le Ciel.[163]
2) Ferdinand
Geoffroy
Membre du Conseil suprême de l'Œuvre de Miséricorde (Poitiers, 17.11.1791 - ?).
Il est issu d'une bonne famille : son père a été procureur au présidial de Poitiers puis avocat et une tante est la fondatrice de la communauté des dames du Sacré-Cœur à Niort. Il est lui-même notaire et a huit enfants. Négligent en affaires, accablé de dettes, il est poursuivi à partir de 1823 par le tribunal correctionnel de la Vienne pour détournement d'argent et condamné en 1824 à deux mois d'emprisonnement malgré la défense assurée en Cassation par Odilon Barrot (1791-1873). Démissionnaire, Geoffroy est recommandé par les dames du Sacré-Cœur au baron de Razac, vice-gouverneur des pages du roi à Paris et ami du dernier ministre de l'Intérieur de Charles X, Peyronnet (1778-1854) ; il devient son secrétaire comptable jusqu'en 1830. Lors du changement de régime, Geoffroy est nommé percepteur à Chefboutonne (Deux-Sèvres) mais refuse le serment aux Orléans. Il est remarqué pour sa piété et son légitimisme fervent ; réfugié auprès de sa tante à Niort, il se fait employer par le préfet en qualité d'archiviste.
Lors de son séjour parisien, Ferdinand Geoffroy s'était attaché à la Société de Saint-Jean-Baptiste de Legros, où il avait rencontré madame Bouche. Il fait la connaissance de Naundorff en 1833 et devient son agent pour le Sud-Ouest. Mais les poursuites pour escroquerie contre le prétendant conduisent le préfet des Deux-Sèvres à se séparer de Geoffroy, alors inquiété, en 1837. Celui-ci rencontre Vintras, l'année suivante, lors d'un pèlerinage à la Vierge Noire de la Délivrance à Caen. Il s'associe à lui dans un cabinet d'affaires puis, son fils Alexandre Geoffroy ayant acheté une fabrique de cartons à Tilly-sur-Seulles, il en confie la gérance à Vintras. Il le présente enfin à madame Bouche et à son groupe parisien en 1839, ce qui lui vaut de devenir l'un des trois membres du conseil suprême de l'Œuvre de Miséricorde avec son fils (qui recueille les discours du visionnaire de Tilly) et « Pierre-Michel », sous le nom de Hirphamael ou de « frère Jean ».
Geoffroy suit dès lors le sort de la septaine de Tilly, où il s'est installé avec sa famille. Il est arrêté avec Vintras en avril 1842, accusé de détournement de fonds au préjudice d'un adepte fortuné (le baron de Razac), et condamné à deux ans d'emprisonnement. Lorsqu'il est libéré en 1845, il se rallie à la « Sainte Liberté des Enfants de Dieu », établie à Tilly par l'abbé Maréchal en l'absence de Vintras, qui autorise les dépravations sexuelles. Cette erreur, et la défection d'Alexandre Geoffroy, expliquent peut-être qu'il n'est plus fait mention du « frère Jean » après le retour (et la remise en ordre) de Vintras, en 1846.[164]
3) Vintras
Eugène Vintras
Visionnaire, fondateur de l'Œuvre de la Miséricorde (Bayeux, 7.04.1807 - Lyon, 7.12.1875).
Certains ont été frappés par la photographie « noir et blanc » de Vintras, publiée par M. Garçon en 1928 : debout, une main sur la poitrine, un homme à la longue barbe argentée porte une robe sacerdotale blanche recouverte d'une chasuble (rouge en réalité) dont deux larges bandes forment une croix inversée, « symbole de la fin du Christ souffrant et de l'avènement du règne du Christ sauveur ».
Issu d'un milieu très modeste, abandonné par une mère blanchisseuse, Vintras, après un apprentissage comme tailleur, exerce plusieurs petits métiers à Paris et en Normandie. Il a plusieurs fois affaire à la justice dans les années 1830 pour des faits d'escroquerie, avant de s'installer comme « agent d'affaire » à Caen puis d'être sollicité par un de ses clients pour gérer une fabrique de carton installée dans un moulin, à Tilly-sur-Seulles (Calvados), en 1839.[165]
L'année précédente, Vintras a rencontré le père d'un des associés de l'affaire, Ferdinand Geoffroy, lors d'un pèlerinage. C’est à son contact que Vintras, devint naundorffiste convaincu.
Eugène Vintras, contremaître dans la fabrique de papier-carton de Tilly-sur-Seulles, n’avait pas d’histoire, lorsque, le 5 août 1839, lui arriva l’aventure que, dans Le Livre d’or[166], il raconte ainsi :
« A 9 heures environ, j’étais occupé à écrire sur mes registres et me pressais assez pour terminer, ayant l’intention d’assister à une messe dont on venait de sonner la dernière volée.
On frappe à la porte de la chambre où j’étais à écrire. Croyant que c’était un ouvrier qui avait affaire à moi, je réponds assez brusquement : Entrez. Je fus bien surpris, au lieu d’un ouvrier, de voir un vieillard déguenillé. Je lui demandai sèchement ce qu’il me voulait.
Il me répondit bien tranquillement : « Ne vous fâchez pas, Pierre-Michel » (noms dont jamais personne ne se sert pour me nommer ; dans tout le pays on m’appelle Eugène, et même, lorsque je signe quelque chose, je ne mets jamais ces deux prénoms).
Cette réponse de mon vieillard me fit une certaine sensation, mais elle augmenta lorsqu’il me dit : « Je suis bien fatigué ; partout où je me présente, on me regarde avec mépris ou comme un voleur. »
Ces dernières paroles m’effrayèrent beaucoup, quoique dites d’un air triste et malheureux. Je me levai et pris devant moi non pas de la monnaie, mais une pièce de dix sous que je lui mis dans la main en lui disant : « Je ne vous prends pas pour cela, mon brave homme. » Et en lui disant cela, je lui fis apercevoir que je voulais l’éconduire. Il ne demanda pas mieux et me tourna le dos d’un air peiné.
A peine eut-il mis le pied sur la dernière marche que je retirai la porte sur moi et la fermai à clef. Ne l’entendant pas descendre, j’appelai un ouvrier et lui dis de monter à ma chambre. Là, sous prétextes d’affaires, j’y espérais lui faire parcourir avec moi tous les endroits que je jugeais possible de cacher mon vieillard que je n’avais pas vu sortir. Cet ouvrier monte à ma chambre, je sors avec lui en fermant ma porte à clef et je parcourus tous les plus petits réduits. Je ne vis rien.
J’allais entrer dans la fabrique quand tout à coup j’entends sonner une messe. J’éprouvai du plaisir pensant que, malgré le dérangement de mon vieillard, je pourrais assister à une messe. Alors, je courus à ma chambre pour prendre un livre de prières. Je trouvai, à la place où j’écrivais, une lettre adressée à Mme de Generès, à Londres. Cette lettre était signée par M. Paul de Montfleury, à Caen, et contenait une réfutation d’hérésie et une profession de foi orthodoxe.
Cette lettre, quoique adressée à Mme de Génèrès, était destinée à remettre sous les yeux du Duc de Normandie (C’est-à-dire Naundorff) les plus grandes vérités de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine. Sur la lettre était posée la pièce de dix sous que j’avais donnée à mon vieillard. »
Naundorff, réfugié à Londres, « avaient des opinions religieuses qui frisaient l’hérésie. On le suppliait de ne pas s’éloigner de la vérité enseignée.
Interrogée aussitôt, Mme de Génerès répondit qu’elle avait mis cette lettre à la poste à Caen, le 3 octobre 1838, c’est-à-dire presque un an auparavant. Elle n’était jamais parvenue. Sa découverte sur la table de Vintras commençait un ténébreux mystère. »[167]
Par l'intermédiaire de Geoffroi, il est dès lors en contact avec les milieux naundorffistes de la capitale et la Société de Saint-jean-Baptiste de la visionnaire Mme Bouche. Celle-ci reconnaît en lui un prophète, favorisé de visites de saint joseph depuis le 9 août 1839, et son continuateur dans l'Œuvre de la Miséricorde. Revenu à Tilly, Vintras a des visions quotidiennes (Joseph, puis Marie et le Christ), ce qui attire de plus en plus d'adeptes, dont quelques prêtres comme l'abbé Charvoz qui devient le véritable théologien du mouvement.
Les messages concernent d'abord les prétentions de Naundorff au trône de France, et le souci de rester dans l'orthodoxie catholique romaine.
Vintras, à ses débuts, affirmait que « le fils de Louis XVI devait renoncer aux graves erreurs religieuses professées par lui, sous le nom de Doctrine céleste, et devenir un des plus sincères et plus fervents défenseurs de l’Eglise catholique. »
Le constat est fait de l'état désolant où la religion est tombée, et la nécessité de voir apparaître un peuple régénéré derrière « un saint pontife et un monarque fort… selon le cœur de Dieu » pour rétablir toute chose, l'Œuvre servant aux hommes a se préparer aux grands événements a venir, c'est-à-dire le règne du Saint-Esprit prédit par saint jean. L'accent est mis sur la miséricorde de Marie Immaculée, « co-rédemptrice du genre humain ». Les fidèles reçoivent un nom d'ange, les êtres humains étant tous des anges déchus incarnés dans des corps et devant expier la déchéance sur Terre afin de jouir de la gloire céleste. Une croix de grâce, pratique héritée de Naundorff, est censée les protéger, et des « septaines » (groupes de fidèles) sont organisées dans toute la France, plus particulièrement dans l'Ouest, l'Orléanais, la Lorraine, la côte méditerranéenne, la région toulousaine et Paris. Enfin, a partir de 1841, des hosties miraculeusement sanglantes (la tâche prenant parfois la forme d'une croix) apparaissent dans le moulin de Tilly : elles sont censées avoir été consommées par des impies, et trouver ainsi refuge en un lieu béni par Dieu.
Dès la fin de 1841, l'évêque de Bayeux condamne l'association et transmet un rapport à Rome. En avril 1842, Vintras est arrêté et jugé avec Geoffroy pour détournement de fonds ; il est emprisonné en août pour cinq ans.
Il fut défendu par Hippolite Bérard de Pontlieue.[168]
En novembre 1843, un bref de Grégoire XVI, envoyé à l'évêque de Bayeux, condamne à la fois les doctrines de Vintras et de Naundorff. Les condamnations romaines sont renouvelées pour Vintras seul en 1851.[169]
On disait, chez les vintrasiens, que Mgr Paysant,
évêque d’Angers, était mort subitement au cours d'une tournée de confirmation «
sans que la médecine ait bien pu expliquer la cause ». Le fait s'était passé au
presbytère de Bocé, le 5 septembre 1841, alors qu’il sortait de table après
avoir, pendant le dîner, qualifié « les communications et leur organe de
la manière la plus révoltante dans les termes. »
De même Mgr Varin, évêque de Strasbourg qui, en 1842,
avait attaqué Vintras dans l'Ami
de la Religion, était
mort, expliquait-on, en écrivant un second article contre l'Œuvre de
Miséricorde.
Me Bardout, l'avocat de Caen, avait renoncé à la
défense de Pierre-Michel pour ne pas
être pris pour un fou. Or, Me Bardout devint réellement fou peu après, et
interné avec la camisole de force à l'asile du Bon-Sauveur à Caen. Il ne revint
chez lui que pour mourir « dans un état d'imbécilité totale sans recouvrer
aucunement ses facultés. »
Dans la prison, l'attitude du condamné était celle
d'un martyr soumis.
Il écrivait à ses amis, prêchait et vaticinait
éperdument. Le jour même de la mort du duc d'Orléans, il fut informé de la
catastrophe « d'une manière surnaturelle » et en avertit, dit-on, les
autres détenus avant même que la nouvelle officielle fut parvenue à Caen par le
courrier.
Dans l'intérieur de la prison, une lutte homérique
s'engagea entre lui et les deux aumôniers, les abbés Léhéribel et Olivier.
Ceux-ci prêchaient dans la chapelle contre l'OEuvre de Miséricorde.
Un nommé Duclos, neveu de Mgr Affre, était détenu
pour banqueroute frauduleuse, C'était un voltairien. Il tomba malade. Vintras l'assista
et le prêcha. Il mourut dans la dévotion. Un autre détenu, Villard, communia à Pâques,
sur les exhortations de Pierre-Michel. Un autre, ancien soldat vendéen de la campagne
de 1832, condamné pour avoir pris part à l'affaire de la duchesse de Berry, fut assisté jusqu'à sa mort par le prophète qui
parvint à le ramener à la religion.
Un nommé Lemarchand avait été condamné à mort. Il
repoussait tout sentiment religieux, Vintras eut voulu
le voir et lui parler, mais on ne lui permit pas d'accéder au cachot. Il se
jeta alors à genoux dans la chapelle, et demanda à Marie la conversion du
malheureux « avec une ferveur telle, que le condamné, changé tout à coup
en agneau, fit la mort la plus consolante possible, et qu'il alla à l'échafaud
avec des sentiments séraphiques, à l'étonnement de toute la prison. »
Bien mieux, un prévenu nommé Lafond, ayant été
acquitté par le tribunal, parla de refuser de quitter la prison pour ne pas se
séparer de l'homme près de qui il avait retrouver une nouvelle vie.
En même temps, on disait que la colère du ciel
s'abattait sur ceux qui contrariaient la mission de l'Organe. On a vu
l'interprétation donnée à la mort d'un avocat et de deux évêques. Les deux
aumôniers, qui avaient tourmenté Vintras à la prison
de Caen, ne furent pas mieux traités. L'abbé Léhéribel mourut à la fin de mars
1844, et l'abbé Olivier en mai 1845, après d’atroces souffrances et
hallucinations.[170]
Pour eux, Grégoire XVI est mort subitement pour avoir condamné l’œuvre de la Miséricorde.
L’abbé Maréchal, à l’imitation de Vintras, en juillet 1845, se déclara brusquement inspiré,
et prétendit recevoir lui aussi les communications du ciel. Il avait institué
par révélation la Sainte Liberté des
Enfants de Dieu.
Ferdinand Geoffroi, sorti de prison le 1er juin
1845, s’était rallié avec enthousiasme à la doctrine de la Sainte Liberté. Sa
femme également.
Après les révélations de Gozzoli[171] sur cette Sainte Liberté des Enfants de Dieu, l’abbé Maréchal prit la
fuite.
A en croire deux renégats de la secte, Gozzoli et Alexandre Geoffroi, les disciples de Vintras se livraient aux pratiques les plus obscènes ; ils célébraient dans leur chapelle particulière des messes sacrilèges auxquelles les élus assistaient dans un état complet de nudité. Et cela se terminait par les scènes que vous supposez.
Il faut dire que ces accusations n’ont jamais été prouvées, et que, d’autre part, on ne trouve rien dans les écrits de Vintras qui semblent les corroborer.
Tout porte à croire que les autres groupes de
l’œuvre, disséminés un peu partout dans la France, ignoraient la gangrène qui
avait pénétré la Septaine Sacrée. Ainsi, le mal ne s’était pas étendu, il
restait circonscrit à Tilly.
Il était temps encore de rétablir les choses selon
la bonne doctrine : on appela l’abbé Charvoz.[172]
Depuis 1843, l’abbé Charvoz, curé de Montlouis,
avait envoyé sa démission à son archevêque. Il avait vendu ses meubles et muni
ainsi de quelqu’argent, il était parti pour Londres en septembre de la même
année. Il avait résolu d’y opérer la conversion de Naundorff de plus en
plus hérétique. Charvoz avait été
bien reçu au début, puisqu’il venait avec un peu d’argent.[173] Après quelques temps,
l’abbé était parti pour Rome. Il voulait éclaircir les conditions dans
lesquelles avait été rédigé le Bref de Grégoire XVI.
Il en avait rapporté, disait-il, l’assurance
formelle qu’au lieu d’un Bref, c’était une simple lettre particulière qui avait
été envoyée par le pape à l’évêque. Cette lettre, affirmait-il, voulait qu’on
ne la considérat que comme un premier pas, dans l’information à venir. Il
affirmait que le père Vaur, pénitencier français, lui avait dit :
« la lettre n’a point été donnée en forme de Bref, et Sa Sainteté a blâmé
vivement la publicité qui en a été faite en France… Elle n’emporte donc aucune
obligation de conscience ».[174]
Vintras a été
libéré en mars 1848. Après avoir réglé par l'abbé Charvoz des dissidences
internes, il entreprend la réorganisation de l'Œuvre désormais rejetée par l'Église :
« Pierre-Michel » incarne désormais le prophète Élie, « pontife
adorateur et pontife d'amour », et crée sept pontifes en mai 1850, qui lui
imposent à leur tour les mains.
Un pape, selon eux, doit bientôt proclamer le dogme de l’Immaculée Conception comme article de foi, et alors l’heure du règne du Saint-Esprit est proche. Aussi, qui n’a été témoin de la joie des vintrasiens lorsque Pie IX adressa, en 1851, son encyclique aux évêques relativement à cette croyance.[175]
Mais le 2 mars 1852, l'ordre est donné par le ministère de l'Intérieur du nouveau régime bonapartiste de disperser la septaine de Tilly. Vintras a fui en Belgique, puis est rejoint par quelques disciples à Londres où il ouvre un « carmel éliaque » et intègre à ses pratiques le spiritisme.
Vintras s’élevait de terre devant témoins lorsqu’il priait, dit M. Jules Bois, et des craquements se produisaient autour de sa présence.
Vintras a des sueurs de sang, dit Eliphas Lévi, et son sang apparaît sur les hosties, où il dessine des cœurs avec des légendes… ; des calices vides paraissent tout à coup pleins de vin, puis où le vin tombe apparaissent des gouttes de sang. Les initiés croient entendre une musique délicieuse et respirer des parfums inconnus ; des prêtres appelés à constater ces prodiges sont entraînés dans le courant de l’enthousiasme. Nous avons vu un de ces prêtres. Il nous a raconté les merveilles de Vintras avec l’accent de la plus parfaite conviction, il nous a montré des hosties injectées de sang d’une manière inexplicable, il nous a communiqué des procès-verbaux signés de plus de cinquante témoins, tous gens honorables et bien posés dans le monde, des artistes, des médecins, des hommes de loi, un chevalier de Razac, une duchesse d’Armaillé.
Les médecins ont analysé le fluide vermeil qui coulait des hosties et ont reconnu que c’était véritablement du sang humain ; les ennemis mêmes de Vintras et il en a de cruels, ne contestent pas les miracles et se contentent de les attribuer au démon. »
Les signes imprimés en caractères sanglants sur les hosties de Vintras étaient ceux qui, dans la magie noire, sont absolument reconnus pour les signatures des démons.
Malgré l’importance donnée au mal et au diable, nous sommes loin
alors de la réputation de satanisme que se chargea de lui faire Eliphas Lévi, repris par Guaïta, Jules Bois (1868-1943) et Huysmans…[176]
Des juifs, des fouriéristes comme D. Laverdant et le peintre Justus, des écrivains catholiques quelque peu marginaux furent des
leurs comme Jean-Antoine Madrolle[177] (1792-1861).
À partir de 1862, Vintras visite la vingtaine de centres qui subsistent ou ont été créés en France, en Espagne et en Italie, Lyon devenant peu à peu le centre initiatique du mouvement. C'est là qu'après le décès de « l'Organe » l'abbé Boullan prétend lui succéder, non sans réticences.
Vintras mourut le 7 décembre 1875, jour de la fête de l’Immaculée Conception.
Sur l’affaire Vintras, faisons quelques remarques :
L’abbé Jean-Baptiste Laprade, dévoué au Prince Naundorff, en vint à croire au prétendu prophète Vintras.
« Mon cher M. Appert, écrivit-il à un autre prêtre le 20 avril 1841, depuis que j’ai confiance en Pierre-Michel (Vintras), mes sentiments à l’égard du Prince sont modifiés, car il annonce que ce malheureux homme est complètement sous l’empire du démon. »
Il n’est que trop vrai qu’après avoir longtemps douté de la réalité des visions de Martin de Gallardon, le prince méconnu, une fois Martin mort, avait cru aux paroles d’un ange des ténèbres qui se disait Jeanne d’Arc, lui apparut plusieurs fois et lui inspira, pour le perdre, son livre quasi arien de la Doctrine Céleste. Pierre-Michel Vintras, au contraire, gardait les dogmes catholiques en y ajoutant les siens. Vintras prêchait le plus pieux catholicisme avec quelques additions personnelles et hérétiques, tandis que les écrits de Naundorff, tout en reconnaissant le Christ pour le Messie, niait sa divinité.
A un moment donné Mme de Saint-Hilaire était tombée dans l’erreur vintrasienne. Mais à l’époque le vintrasianisme n’était point encore condamné par le Saint-Siège et Mme de Saint-Hilaire pouvait se croire et se croyait de bon droit dans le plus pur catholicisme.
A propos de l’existence du fils de Louis XVI, il se trouva que la plupart des témoins croyaient à cette existence avant même de connaître Pierre-Michel.
Naundorff n’a jamais vu Vintras, et il le traitait de farceur.
Naundorff est venu en France en 1833, alors que Vintras n’a commencé son Oeuvre de la Miséricorde qu’en 1839 et que, depuis 3 ans, Naundorff était exilé en Angleterre. Donc rien de commun. Vintras croyait à Louis XVII-Naundorff. C’était son droit et même son devoir après avoir entendu les témoignages décisifs fournis par Geoffroy qui était un honnête homme tenu en grande estime par le Baron de Razac.[178]
Vintras conduisit l’infortuné M. Bérard en Hollande pour demander la main de Madame Amélie. Elle refusa. C’est la seule fois que Vintras fut en rapports avec la famille Naundorff. Jamais il ne renouvela l’expérience.
4) Boullan
Joseph-Antoine Boullan. (1824-1893)
Prêtre déviant, successeur autoproclamé de Vintras.
Ordonné prêtre à Montauban, il séjourne tout d’abord à Rome, au sein de la Congrégation des Missionnaires du Précieux Sang, où il devient docteur en théologie. Il part en Alsace, où il est nommé Supérieur aux Trois Epis, près de Turkheim. C’est là qu’il compose sa Vie divine de la Sainte Vierge, ouvrage inspiré de la Cité Mystique (1670) de la sainte espagnole Marie d’Agreda. En 1854, la révélation de l’apparition de la Vierge à Notre-Dame de La Salette le bouleverse Il quitte sa congrégation et en 1855 il s’installe à Paris où il devient rédacteur de la revue Le Rosier de Marie, et où il crée les Annales du Sacerdoce. Deux ans plus tard, à La Salette, il rencontre Adèle Chevalier, une jeune nonne d’origine belge, miraculée des lieux et guérie de sa cécité. Adèle déclare à Boullan que la Vierge lui a annoncé la venue d’un réformateur. Persuadé d’être celui-ci, le prêtre commence à rédiger avec son égérie la règle d’un Ordre nouveau, en grande partie orientée vers des actions thérapeutiques. L’évêque de Versailles, Mgr Mabille, lui donne l’autorisation d’ouvrir la première session de son « ordre de la Réparation des Ames » à Sèvres.
Mais peu à peu, les choses commencent à déraper. Boullan et Adèle Chevalier devenus amants, la mystique qui orientait l’œuvre de la Réparation fait une place de plus en plus grande à l’érotisme. Puis l’érotisme se colore de transgression, et s’ouvre à des pulsions de nature scatologique qui inspirent de curieux « rites » de guérison, comme l’emploi d’urine et d’excréments pour faire des emplâtres. En 1860, la Congrégation quitte Sèvres pour Triel : c’est là que Boullan célèbre sa première messe noire. Condamné par Rome la même année, il comparaît devant le Saint-Office, et jusqu’en 1864 est emprisonné avec sa compagne. Il écrit alors sa « Confession », document déposé aux Archives Vaticanes, et se voit réhabilité en 1867. A Paris, les années suivantes, il fonde les Annales de la Sainteté au XIXe siècle, revue dans laquelle il exploite la fibre du surnaturel, toujours friand de visions et de révélations extraordinaires. Pris d’une subite passion pour l’exorcisme, il enseigne aux possédée des méthodes d’auto-hypnose, et les incite à s’unir en rêve avec les saints et avec Jésus-Christ, puis avec son propre corps astral, afin qu’elles soient sauvées. Pour son prestige personnel, il en vient à escroquer des familles endeuillées, en prétendant que leurs défunts les invitent à offrir de l’argent à sa Congrégation. En février 1875, l’archevêque de Paris lance sur lui l’anathème : il est suspendu de ses fonctions par l’Eglise, et sa Congrégation est interdite.
Il cherche alors à contacter Pierre-Eugène Vintras, fondateur de l’Œuvre de la Miséricorde, dite « Le Carmel », une correspondance s'en suit et c'est à Bruxelles en août 1875 qu'ils se rencontrent pour la première fois.
Suite à une nouvelle rencontre à Paris, l'abbé s'adonne au vintrassisme. A la mort de Vintras en 1875, il proclame être le successeur de celui qu'il considère comme son maître, bien qu'il ne l'ai rencontré qu'à deux reprises. Il s'installe alors à Lyon chez un de ses adeptes, l'architecte Mismes, et se choisit le pseudonyme d'Elie-Jean-Baptiste (successeur désigné par le ciel selon la doctrine). Nous trouvons maintenant au côté de Boullan, une vintrasienne convaincue Julie Thibault « la Femme Apostolique », elle participe à toutes les activités du groupe, aux unions spirituelles, aux unions de vie, elle guérit les malades « dans son ministère de Melchisédech Féminin ».
Arrivé à Lyon le 20 février 1876, Boullan tente de conquérir les disciples de Vintras, orphelins depuis la mort du « prophète » en décembre 1875. Il rencontre de nombreuses résistances parmi les fidèles du Carmel vintrasien notamment de la part d'Edouard Souleillon, « Pontife de prudence et conservateur des archives de Œuvre » tout en obtenant la confiance de M. Soiderquelk, « Pontife de cordiale et de sainte unification » qui le reconnaît comme l'élu de Dieu et le successeur du « prophète de Tilly ». En janvier 1877, il s'installe à Lyon, 60 route d'Heyrieux, dans la maison même de la famille Soiderquelk et y poursuit sa propagande. C'est dans cette maison qu'est signalée la présence de Lazzaretti à la fin de l'année 1877. En fondant le « Carmel Trématique Eliaque », Boullan se sépare de facto des autres vintrasiens : trois Pontifes sur un total de dix-neuf se séparent du Collège des Pontifes carméléens pour le suivre.[179]
Il y reprend à sa façon les rites de Vintras, et développe sa mystique érotique dans une orientation très concrète, en professant qu’il faut racheter le péché originel d’Adam et Eve par des actes d’amour « religieusement accomplis », au cours desquels il semble s’investir à part entière…
En 1877, ses pratiques provoquent un schisme dans la secte : avec ceux qui le suivent désormais, il trouve refuge chez un ancien vintrasien, Pascal Mime, au 7 rue de la Martinière, toujours à Lyon. Boullan s’entoure alors de deux voyantes qui le guident dans ses actions : Mme Laure et Mme Thibauld. Son personnage va bientôt défrayer la chronique.
Dans les années 1890, les milieux ésotériques et occultistes entendant parler de ce prêtre sataniste, et commencent à mener l’enquête sur l’impulsion du secrétaire de Stanislas de Guaïta : Oswald Wirth. Sous la plume de Guaïta, dans Le Temple de Satan, Boullan sera décrit comme « un pontife d’infamie, une basse idole de la Sodome mystique, un magicien de la pire espèce, sorcier et fauteur d’une secte immonde ». L’écrivain J.-K. Huysmans, qui semble avoir été témoin de « rites » noirs, dresse le portrait de Boullan (sous les traits de Johannès) dans son livre Là-Bas, paru en 1891. Mais 20 ans plus tard, dans sa préface de A Rebours (1903), il écrit que dans ce livre il n’a rien dit : « les documents qu’il recèle sont, en comparaison de ceux que j’ai omis et que je possède dans les archives, de bien fades dragées. »
Péladan, Guaïta et Wirth dénoncent les actes d’impudeur et de bestialité que Boullan prône pour le salut des âmes. Ils somment le prêtre de comparaître devant le tribunal initiatique de la Rose-Croix. Celui-ci refuse. Le Tribunal se réunit pourtant, et vote une condamnation magique contre le dévoyé. De 1891 à 1893, craignant les attaques des Roses-Croix, Boullan lança à son tour force maléfiques et envoûtement, encouragé par Huysmans qui, se sentant lui-même menacé par les fluides mortels, ne s’endort plus qu’après avoir mis sous son oreiller une pâte de protection spéciale. C’est dans ce climat oppressé que l’ex-abbé, sans doute pris au piège de ses propres jeux dangereux, finit par mourir dans une extrême angoisse : la voyante Mme Thibault venait de lui révéler une vision, celle de Guaïta jetant sur lui un sort mortel. Ainsi, sa fascination pour les « visions » lui fut fatale. Jean-Jacques Gabut nous apprend même qu’il ne reste pas le moindre vestige de sa tombe, au cimetière de la Croix-Rousse…[180]
Boullan avait offert au prétendant Naundorff un saint chrême spécial, fait du sang de souris blanche, nourries d’hosties consacrées. Mais ni le Prince, ni ses amis n’ont entretenu de relations avec ce magicien.
5) Alexandre Appert
Alexandre Appert (1783-1852)
Ordonné prêtre en 1807. Curé à Saint-Arnoult en 1831, il entre en relation avec Martin de Gallardon, dont il note les révélations, et avec Mme Pasquier (habitant Saint-Arnoult).
Apprenant l’existence de Naundorff en août 1833, il le rencontre (09.1833) et l’aide financièrement, puis le met en contact avec Martin et la famille Pasquier. Il lui donne la première communion et le fait confirmer par son évêque, Mgr Blanquart de Bailleul, sans que celui-ci soit au courant (11.1833). En 1836, il transmet la révélation de la croix de grâce à l’archevêque de Paris et à son évêque, qui lui interdit de donner les sacrements à Naundorff, voit en la dévotion un signe de ralliement politique et lui intime l’ordre de récupérer les croix distribuées, en usant au besoin du refus de l’absolution. Mais il résiste : la dévotion est orthodoxe, met en valeur des éléments peu appréciés jusque-là, n’est pas politique ; il ne fabrique pas les croix ni ne les donne. Après l’expulsion de Naundorff vers l’Angleterre, Mgr Blanquart de Bailleul le suspend de toute fonction. Se sentant menacé, il abandonne sa cure et se réfugie en Suisse (10.09.1836). Il lui est appliqué les sanctions pour mauvaises conduites : son traitement est réduit puis suspendu (1837), un remplaçant étant affecté à la paroisse. Naundorff lui communique ses révélations, qu’il publie tout au long de 1838 avec l’abbé Laprade (Aux archevêques de Cologne, Gnesen et Posen ; A MM. Les Archevêques et Evêques ; Au clergé catholique). Ayant rejoint Londres après avoir séjourné en Allemagne, assigné à comparaître par son évêque, il devient assistant du conseil de l’Eglise du Seigneur dont Naundorff est le protecteur (Aux catholiques d’Angleterre et d’Irlande, 30.10.1838). Jugé par contumace alors qu’il adresse une lettre à son évêque en disant n’avoir plus rien à faire avec la prétendue discipline romaine (12.1838), il est démissionné canoniquement (06.04.1839). Persuadé que 1840 sera marqué de grands évènements, il relit les avertissements de Naundorff selon les perspectives de Martin. Durant les tensions entre les partisans du prophète en août, il demeure fermement à ses côtés. Ne suivant pas une partie de l’entourage naundorffiste dans la rupture du 21 janvier 1841, par manque de ressources selon les partants, il demeure à Londres. Il s’installe avec la famille Naundorff à Bréda après la mort du prétendant et aurait sombré dans la sénilité. Il y est enterré dans le cimetière calviniste après avoir refusé de se réconcilier avec le catholicisme.[181]
6) Gruau de La
Barre
GRUAU Modeste, dit Gruau de La Barre - Conseiller de
l'Église catholique évangélique (La Châtre [Saint-Martin-de-Connée, Mayenne],
25.03.1795 - Bréda [Pays-Bas], 28.01.1883).
D'une famille légitimiste (son frère est garde du corps du roi et suit Louis XVIII à Gand en 1814), il est substitut près du tribunal de première instance d'Angers (03.01.1822), puis procureur du roi au tribunal de Mayenne (22.12.1824, avec l'appui de trois députés de Sarthe, du préfet de Maine-et-Loire, du marquis de Rosanbo, pair de France). Il est bien intégré aux notabilités locales, mais, lors de la révolution de 1830, il se serait enfui ou aurait immédiatement démissionné ; il est en tout cas le seul magistrat à être rapidement remplacé. Il essaye de rentrer en contact avec Martin de Gallardon. Pieux (retraites a la Trappe de Port-Salut), il se marie (1830 ou 1831) mais perd sa femme et un enfant après deux ans et demi de mariage.
Intéressé à Naundorff lorsque celui-ci intervient dans le procès Richemont (1834) et par un avocat de ses amis, il s'y rallie (1835 ou 1836) après s'être entretenu avec lui. Devenu son homme de loi attitré, il défend inlassablement ses revendications politiques et religieuses, ce qui lui vaut d'être annobli par le prétendant qui le titre comte de La Barre (31.01.1838). Coadjuteur du conseil de l'Eglise du Seigneur (31.10.1838), il aurait réécrit les révélations dictées par son ange à Naundorff en allemand et devenues la Doctrine céleste (1839). Avocat des éditeurs de la Doctrine céleste, il revendique une part de responsabilité dans le livre, mais échoue à se faire inculper et à obtenir l'acquittement. Lors du procès, il cite des auteurs annonçant comme Naundorff une régénération (Lamennais, Lamartine, Fourier, Considérant, Maistre, Swedenborg, Strauss, Santo-Domingo, Llorente). Conseiller de l'Eglise catholique-évangélique, attendant la réalisation des prophéties catastrophiques pour septembre 1840, il est contesté (août) par une partie de l'entourage du prétendant, devenu sceptique sur les révélations après leur échec. Il reste quant à lui irréductiblement croyant. Avocat du procès contre Le Capitole ayant présenté Naundorff comme un juif prussien, il réside à Paris toute la fin de l'année 1840. Aussi est-il absent de Londres lors de la rupture du 21 janvier 1841. Resté fidèle au prétendant, il assume l'Histoire de la création devenue Salomon le Sage fils de David ; sa renaissance sur cette terre et Révélation céleste, publié par M. Gruau de La Barre, Ancien Procureur du Roi. Deuxième et Troisième parties, Faisant suite à la première, intitulée : Révélations sur les erreurs de l'Ancien Testament (1841), mis à l'index en 1842 - Gabriel de Bourbon-Busset, sous le pseudonyme de Dr Le Cabel, Sept chapitres en vers, pour faire suite à « Douze petits chapitres » en prose au sujet d'un certain ouvrage faussement attribué au duc de Normandie et intitulé : « Révélations Sur les erreurs de la Bible », le vise peut-être comme auteur de l'ouvrage. Lors de l'emprisonnement de Naundorff pour dettes en 1843, il colporte An abridged account of the misfortunes of the Dauphin pour subvenir aux besoins de la famille.
Après la mort de Naundorff, devenu « vice-père » des enfants du prétendant, il s'installe à Bréda avec sa famille et continue sa croisade politique et religieuse. Ses Intrigues dévoilées, ou Louis XVII, dernier roi légitime de France, décédé à Delft, le 10 août 1845 (1846-1848) défendent une partie des positions religieuses de Naundorff (pluralité des mondes, infusion des âmes dans les corps à la naissance, transmigration des âmes jusqu'à ce qu'elle soient purifiées, non-divinité du Christ, non-résurrection de la chair, perversion de l'enseignement de Jésus par le sacerdoce romain). Sous le pseudonyme d'Eliakim (selon 0. Lorenz ; crédible en raison de l'identité des positions avec celles de Naundorff), il persévère dans Les Visions d'Esaïe et la Nouvelle terre (1854) où il polémique vigoureusement contre la papauté (en utilisant l'Esprit des papes de J.-H. Santo-Domingo et l'Histoire de l'inquisition d'Espagne de J.A. Llorente) et réécrit et interprète le livre d'Isaïe. Les Italiens, la politique et Rome. Introduction à l' « Évangile primitif » et L'Évangile primitif (1860) poursuivent dans la même veine, ajoutant l'idée d'une régénération sociale par le retour à l'enseignement du Christ. Il se consacre ensuite uniquement à la défense des prétentions d'identité de Naundorff (livres et procès).[182]
7) Les Laprade
LAPRADE Jean-Baptiste Prêtre Catholique, Président Du Conseil De l'Eglise Catholique Evangélique (Bouresse [Vienne], 8.04.1808 - Poitiers [Vienne] 18.08.1891).
LAPRADE Xavier - Conseiller De l'Église Catholique Evangélique (Lussac-Les-Châteaux [Vienne] 22.09.1810 ? - Pau Pyrénées-Atlantiques] 1898).
LAPRADE Abel - Naundorffiste (Lussac-Les-Châteaux [Vienne] 22.09.1818 - Mazerolles [Vienne] 29.09.1897).
La famille
Laprade est légitimiste, le père est maire de Lussac-les-Châteaux.
Jean-Baptiste est prêtre en 1831. Vicaire à Saint-Hilaire de Niort, il est
ensuite aumônier des Dames du Sacré-Cœur de Niort, fondée par une des tantes de
Geoffroy, lequel conduit sans doute la famille à se rallier à Naundorff.
Xavier, avocat, voyage en Allemagne afin d'enquêter sur l'identité de Naundorff
(1833), et revient convaincu de la véracité de ses propos. Il est associé à
Gruau dans les plaidoiries pour défendre les revendications du prétendant, et
signe avec lui Motifs de conviction sur l'existence du duc de Normandie (1836).
Jean-Baptiste est à plusieurs reprises l'émissaire de Naundorff, notamment
auprès de Grégoire XVI, pour que celui-ci accepte la « croix de grâce »
sous peine de malheurs – le « duc de Normandie » lui aurait fait
miroiter la main de sa fille pour le décider à cette mission. Reçu en audience
par le pape en février 1837, il lui laisse un dossier. Alors qu'une
perquisition a eu lieu chez lui, comme chez de nombreux naundorffistes (juillet),
il attire l'attention du gouvernement (août) en faisant parvenir des fonds à
Naundorff (40 000 F). Il perd alors son poste et s'installe en Suisse avec la
famille Naundorff, cosignant tout au long de 1838 avec l'abbé Appert les
avertissement et prophéties de Naundorff (Aux archevêques de Cologne, Gnesen
et Posen ; A MM. les Archevêques et Evêques ; Au clergé catholique).
Ayant rejoint Londres, président du conseil de l'Eglise du Seigneur, il rompt
avec l'Eglise catholique (Aux catholiques d'Angleterre et d'Irlande, 24
et 31.10.1838). Xavier préface
de son côté An abridged account of the
misfortunes of the Dauphin… (1838), tandis qu'Abel est compagnon
d'Edouard, fils aîné de Naundorff, en Suisse. Persuadé d'une prochaine
régénération du monde grâce aux révélations du prétendant et d'une damnation
de Rome (Lettre de l'abbé Jean-Baptiste Laprade, 1838 ; lettre
aux évêques de Genève et Lausanne en 1839), Jean-Baptiste précise que c'est
le prophète Jean-Baptiste, ange et non homme, qui parle à Naundorff.
Accompagnant Gruau à Lyon lors du procès des éditeurs de la Doctrine Céleste,
revendiquant avec lui et l'abbé Appert la responsabilité du livre, il
aurait été soupçonné de transporter des exemplaires manuscrits du livre et
arrêté alors qu'il se rendait à Genève. De retour à Londres (1840), il est
confirmé comme président du conseil de l'Eglise catholique évangélique
(09.05.1840). Xavier, rentré de Londres, épouse Adèle de Verdelin de Générès,
et devient directeur à la « Banque des Ecoles et des Familles, Compagnie
mutuelle d'assurance sur la vie ». Xavier et Jean-Baptiste manifestent
leur scepticisme après l'échec des prédictions du prétendant (août), mais lui
conservent finalement leur allégeance. Jean-Baptiste participe avec Roydor à la
mise au clair de l'Histoire de la Création : les contradictions
avec la Doctrine céleste et les prophéties ratées lui
font signer les observations présentées au prophète (18.01.1841). Vilipendé par
Naundorff (21.01), il rompt, suivi par une partie de l'entourage du prétendant.
Revenu en France, il essaye avec Xavier de faire paraître dans les journaux une
déclaration anti-Naundorff. Ils doivent finalement se résigner à la simple
impression avec d'autres partisans déçus de la Déclaration relative au
Personnage se prétendant Duc de Normandie,fils de Louis XVI, connu sous le nom
de Naundorff, résidant à Camberwell, près Londres et se dissocient de la
polémique de Gozzoli.
Jean-Baptiste désire reprendre son ministère, mais on ne lui propose qu'un poste de professeur d'anglais. Contacté par des partisans de Vintras, d'abord sceptique, il se rallie au prophète après avoir assisté à un de ses sommeils extatiques et vu des hosties sanglantes et parfumées chez le baron de Razac. Mais il entend demeurer dans le catholicisme et se soumet à son évêque. Après une dure pénitence publique et une retraite à la Trappe de Laval (05.1840), il est curé de Mazerolles jusqu'en 1865 puis prend sa retraite. Resté en relation avec la famille Naundorff, il célèbre en Hollande le mariage de Charles-Edmond, fils de Naundorff (1867), clandestinement en raison de l'opposition de la famille du marié. Il témoigne en faveur de l'identité de Naundorff avec Louis XVII jusqu'à sa mort, défendant l'idée que celui-ci s'est réconcilié avec le catholicisme durant son agonie. Il se serait rendu à Loigny en 1888 pour visiter les Epouses du Sacré-Cœur de jésus Pénitent de M. Marchat.
Xavier, ayant
assuré sa position en vendant son poste de directeur de sa compagnie, au profit
de celui d'Inspecteur général, s'installe dans la Vienne en 1852. A la mort de
sa femme, il se remarie. Il demeure partisan politique de Naundorff. Abel,
installé avec les Naundorff à Londres, est rappelé en France sans doute en 1841
et perd tout lien avec eux. Marié, il est veuf en 1872. Lors du procès de 1873
intenté par les enfants Naundorff au Comte de Chambord, il reprend contact avec
Amélie (1819-1891), fille aînée de Naundorff et l'épouse à Bréda (15.07.1876).
Il participe à son combat survivantiste réorienté dans une perspective
apocalyptiste (apposition du sacré-cœur sur le drapeau fleur-de-lysé).[183]
8) L’affaire du
« Cantianillisme »[184]
A partir de 1866, l'affaire du « Cantianillisme », traduit les dérives hétérodoxes qui accompagnent le développement des lieux prophétiques. Arrivée en Savoie en compagnie de l'abbé Thorey, prêtre interdit du diocèse de Sens, Cantianille Nicout-Bourdois se prétend l'objet d'expériences mystiques qui la mettent en relation avec l'au-delà. Prétendant avoir le pouvoir de libérer plusieurs millions d'âmes du Purgatoire et annonçant son rôle dans la consommation des temps, cette dernière est dénoncée par certains clercs et certains fidèles, inquiets de l'empire qu'elle exerce sur le vieil évêque mauriennais Vibert et sur ses proches collaborateurs. L'affaire est relancée en août 1873, avec les apparitions de la Vierge dont une domestique, Théotiste Covarel, se dit témoin après avoir fait un pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de La Salette. Le contenu du discours rapporté par la voyante traduit une forte dimension anticléricale, dans la lignée du secret de la bergère de La Salette qui commence alors à circuler. Dans le rapport consacré aux faits allégués, le chanoine Albrieux, homme de confiance de l'évêque, décrit ainsi les paroles de la Vierge :
« La très-sainte Vierge, dans presque toutes les apparitions que nous venons de décrire, a exprimé avec douleur le malheur de ses prêtres [...] Dans son apparition du Samedi-Saint, dont nous avons déjà parlé, lorsqu'elle tenait le saint-Enfant Jésus mort entre ses bras, elle déclara à la Voyante que c'étaient les péchés des prêtres qui l'avaient réduite, avec son divin Fils, dans ce déplorable état; le mal, disait-elle, était si grand, qu'il était presque sans remède et qu'elle se voyait forcée de laisser éclater sur eux la colère céleste. »
Echo direct des paroles attribuées à la Vierge sur la montagne de La Salette, cette dernière parole traduit les jeux d'emprunt existant entre les mariophanies de la période. A la demande de Mgr Billiet, archevêque de Chambéry, l'affaire est instruite par le Saint-Office et conduit à la mise au pas de Mgr Vibert, contraint de se démettre en 1876. Instance suprême de régulation du dogme, la congrégation romaine mesure, dans le cas présent, les périls que peut entraîner pour l'unité religieuse les phénomènes d'allégeance et de clientélisme perceptibles dans l'imbroglio mauriennais. A ce choix dogmatique et ecclésiologique s'ajoutent en outre des considérations d'ordre politique, dans la mesure où les partisans de Vibert, notamment l'avocat naundorffiste Benjamin Daymonaz[185] (1837-99), excipent un projet de suppression du diocèse mauriennais à la demande du député gambettiste Paul Bert[186]. En d'autres termes, le fait d'écarter un évêque vieilli, pris par une fièvre insatiable de prodiges, obéit aussi à une logique politique.
C'est à Paray-le-Monial, centre des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Marguerite Marie Alacoque (1647-1690) qu'à l'issue du conflit franco-prussien de 1870 un jeune aristocrate russo-espagnol allait créer à partir d'une réinterprétation des écrits mystiques de la sainte, un centre d'ésotérisme chrétien destiné à régénérer le monde.
« Cet orphelin à l’enfance cahotée, élevé dans un semi-abandon, mais lié par sa mère à la Cour impériale de Russie et apparenté par son père à sainte Thérèse d’Avila, hérita d’une grande fortune au pays basque et du sentiment de la profonde perversion de ce monde. Marin d’occasion et fonctionnaire aux Affaires étrangères à Madrid, il entra dans la diplomatie à Paris, où la cause naundorffiste l’enthousiasma, puis à Saint-Pétersbourg où la découverte d’un enfant mort de froid sur son seuil, décida de ses choix définitifs : assurer le triomphe du règne du Sacré-Cœur de Jésus-Hostie. Cette véritable transfiguration de la société qui devait aller jusqu’à celle des lois de la nature, correspondait à la réalisation des prophéties par le décryptage des signes visibles des desseins de Dieu. Il se rendit donc à Paray-le-Monial où le culte de Marguerite-Marie Alacoque connaissait un regain de popularité. »[187]
Alexis de Sarachaga (1840-1918), est né Alexis-Florentin-Séverin de Sarachaga le 8 novembre 1840 à Bilbao (Espagne). Fils du baron Maffarando de Sarachaga Y Uria apparenté à sainte Thérèse d'Avila, et de madame née Ru Cheleff de Lobanoff de Rostoff, grande maîtresse de l'impératrice de Russie ; frère de la baronne de Truchness établie au château de Wezthausen (Bavière). Polytechnicien diplômé de Fribourg, il sert d'abord comme secrétaire aux Affaires étrangères de Madrid avant d'être affecté à Paris où il se révèle partisan de la cause naundorffiste. Au moment des événements de 1870 il est envoyé à la Cour de Russie. Converti sous l'effet d'une image du Sacré-Cœur contemplée dans l'église des dominicains de Moscou, il réintègre peu après la France.
Il créé alors, en collaboration avec le Père jésuite Victor Devron, l’Institut des Fastes eucharistiques, en 1883. Cet Institut était installé dans un temple-musée, le Hiéron.
Dès lors
installé à Paray-le-Monial et entouré du baron Félix de Rosnay, du comte
d'Alcantara, de madame Bessonet-Favre etc., il nourrit le projet d'une
« reprise de la révélation primitive sous la royauté du Christ » et
fonde à cette fin l'Institut des Fastes eucharistiques approuvé par S.S.
Léon XIII « d'où devait rayonner pendant quarante années la plus curieuse
des doctrines » désignée aussi sous le nom de « franc-maçonnerie
chrétienne du Grand-Occident ». A cette fin le baron de Sarachaga donne le
jour à un cycle de publications dont le changement de titre et de caractère
tous les six ans donne à penser que le tout devait s'inscrire dans le cadre
d'un « plan préétabli de vaste envergure » : le Règne Social de
Jésus-Christ Hostie (1883-1888), dans le bulletin de la Fédération
eucharistique internationale du Sacré-Cœur pour la restauration chrétienne de
la société : la doctrine; l'Institut des Fastes Eucharistiques (1889-1894)
l'économie catholique de l'histoire, éclairée et revivifiée à sa source
primitive ; le Novissimum Organon (1895-1900) où l'origine et
l'histoire des mondes concordent avec le développement des sciences, lettres
et arts à toutes les époques pour démontrer l'unité tangible du Plan-Divin de
la Création en vue de l'exaltation du Verbe-Hostie : le Palaïos-Logos,
principe et fin de toute l'ordonnance magistrale du Cosmos ; le
Politicon (1907-1912) pour l'Instruction supérieure Diplomatique,
suivant les règles et disciplines du Sacré-Cœur en faveur du plus grand développement
du génie chrétien ; le Pam-Epopeïon (1907-1912) annales de l'école
bardique et de l'école diplomatique internationales sous les auspices et la
conduite de l'Aréopagie Auréolée Mariale ; et enfin l'Egide (1913-1915)
annales bardiques et travaux pour le Saint Graal.
Il s'avéra
que les thèmes prônés par l'ancien diplomate et ingénieur se révélèrent de
plus en plus inspirés par l'hermétisme au détriment du dogme chrétien et
donnèrent même lieu à quelque obsession millénariste au point que, à l'orée du
conflit de 1914-1918, le baron en vint à croire et à écrire que « les
apôtres des derniers temps seront seuls épargnés dans la tourmente qui se
prépare » ; une fin des temps bien relative puisque l'hermétiste
préparait pour l'an 2000 « le cycle du saint Graal ». Marié depuis
peu avec sa jeune femme de chambre mademoiselle Eugénie Champion, cette union
mal assortie n'alla pas sans provoquer le scandale à Paray-le-Monial. Le couple
Sarachaga prit donc le chemin de l'exil abandonnant l'œuvre du Hiéron réorienté
dans une perspective plus orthodoxe par Gabriel et Marthe de Noaillat, apôtres
du règne social de Jésus-Christ et incitateurs de l'encyclique Quas Primas (1925)
qui allait amener S.S. Pic XI à établir officiellement la fête du Christ-Roi.
Le flambeau ésotérique inspiré du Palaïos-Logos et de Aor-Agni allait
être repris plus tard par le groupe Atlantis à l'initiative de Paul Le
Cour. Commandeur de l'ordre de S.S. Pie IX, chevalier de l'ordre de Charles
III d'Espagne et membre de l'Académie du Cœur du Christ d'Espagne, le baron
Alexis de Sarachaga s'est éteint à Marseille le 4 mai 1918.[188]
10) Grémillon
GREMILLON Henri, dit Henry MARIAVE - Médecin militaire, salettiste (Bar-sur-Seine [Aube],24.03.1865 - Saint-Gervazy [Gard], après 1940).
Militaire depuis 1885, médecin en 1889, il se convertit vers 1900, se marie et a trois fils. Affecté aux hôpitaux militaires de la division d'Oran, il est chevalier de la Légion d'honneur en 1909. Il participe à la première guerre mondiale (médecin-chef des brancardiers de la 31e division) en dévot du Sacré-Cœur. Soignant des prisonniers allemands à l'hôpital d'Ypres, il échappe à la mort lors d'un bombardement allemand - mais l'annonce erronée de son décès est exploitée par la presse contre la « barbarie boche ». Il obtient la croix de guerre, mais son refus d'abandonner son sacré-cœur le conduit à être exclu de l'armée après avoir été mis aux arrêts et interné.
Il se lance alors dans une propagande mélaniste (Mélanie Calvat) et rénovationiste (accessoirement naundorffiste), adressant ses ouvrages gratuitement aux intellectuels et journalistes. La Leçon de l’hôpital Notre-Dame d’Ypres. Exégèse du secret de La Salette (1915) et Pour La Salette contre nos princes (1916) contiennent l'ensemble de ses positions ultérieures. Refusant de se situer au sein du catholicisme intransigeant et de ses différenciations, voulant réaliser une synthèse fondée sur Jésus seul et l'amour des ennemis, il rejette toute métaphysique au nom du primat du cœur qui doit guider l'intelligence. Critiquant toute forme sociale autre que celle qu'inaugurera Jésus lors de la Rénovation, il dénonce la perversion de l'amour des ennemis par l'Eglise qui s'est engagée dans le temporel, et a ainsi suscité l'athéisme généralisé et 1789. Mais la trilogie « liberté, égalité, fraternité », passée dans l'Etat, ne peut être appliquée car les intérêts de la société sont fondés sur la force assumée par l'Etat depuis le péché originel. De cette contradiction va surgir la conflagration finale promise par La Salette pour la purification de l'Eglise (il est anti-clérical, virulent), l'avènement du Grand Monarque, le retour de la trilogie dans l'Eglise, et la Rénovation. La Leçon est mise à l'index (12.04.1916) après que Mgr de Cabrières a fait connaître son désaccord avec ses thèses (Semaine religieuse de Montpellier, 21.06.1915). Il est excommunié, ce qui entraîne ultérieurement une crise familiale. Son fils, qui ne peut réaliser son projet de mariage, s'engage dans l'armée et se suicide. Sa femme rompt la vie commune, la reprend et le persécute.
En 1922, il
semble qu'il trafique nombre d'exemplaires de la réédition du secret de La
Salette ayant l'imprimatur du père Lepidi o.p. (1922), y ajoutant une lettre
violemment anticléricale. L'ouvrage est mis à l'index (05.1923). Il lance une
série de tracts jusqu'en 1925 (Le Cœur et ses faux prophètes ; Lettre
ouverte à MM. les Professeurs de philosophie ; Aux pacifistes de Moscou et
de Calcutta, de Genève ou d'Amérique. Aux idéologues de la paix ou de la
guerre, salut !; Lettre circulaire aux Evêques ; Lettre aux Sénateurs
et aux Députés ; Nouvelle lettre aux Evêques ; Aux Amis de Han Ryner).
Il systématise sa pensée dans Le Philosophe Suprême. Tome 1 Jésus-Liberté,
Tome 2. Jésus-Roi (1924-1926), dont il tire par la suite, en les réaménageant
ou en les développant, la matière de ses publications. Ses libelles se
succèdent tout au long des années 1920, tant sous son pseudonyme que sous son
nom (Un cordinhore, un libéral excommunié par le cardinal de Cabrières, La
restitution de l'amour pur. Le peuple de Dieu conduit par le message de
l'esprit, sa mission. Le secret de La Salette… voyage à travers l'hypothèse de
l'homme, un en trois personnes, s.d. ; Les prêtres ont-ils le droit de
tuer ? Le Prêtre-Soldat jugé par le Décalogue, l'Évangile, les Pères de
l'Église et par le Secret de La Salette, 1925 ; Un catholique clame
justice. Notre Seigneur Mignen nous divise et nous abêtit. Le Mystère de
l'Action Française. Le Sens de l'État. Le Sens de l'Église. Un anticléricalisme
constructeur peut-il être substitué à l’anticléricalisme destructeur ?
L'humanité et son avenir, 1925 ; Position du spiritualisme scolastique.
Étude de psychologie gnoséologique. Rapports du cœur et de l'intelligence. Par
de faux principes philosophiques, n'ayant aucune valeur positive, condamnés par
la science et la conscience, le pagano-christianisme fortifie l'État et le tue
en même temps. Le Secret de notre dépérissement. Enquête du Figaro sur science
et religion, 1926 ; Le Sens de l'Etat ou le Mystère de l'Action Française.
Réplique à la Correspondance catholique franco-allemande de l'Abbé Démulier
[1927] ; Deux épîtres dédiées à Notre Seigneur Migne, adressées à M. A.
Lapeyre, Directeur de Lucifer et à Mme Ziarowska, Directeur du Végétalien, Un
Clergé sans pudeur, les évêques de France au cinquième centenaire de femme la
Pucelle. Le péché contre l'esprit est irrémissible ; Qu'est-ce que
Dieu ? Dieu est Amour, Dieu est Lumière. Tous les restes :
1Mysticisme ! Fantasme ! Folie ! [1929] ; La Prostitution
de l'amour pur : le peuple de Dieu, conduit par le message de l'Esprit
[vers 1930] ; La Grande nouvelle, le message de l'Esprit ou le troisième
Testament : en l'honneur du Dieu souffrant, doctrine des apôtres des
derniers temps [vers 1932] ; Le retour à l' Héden, 1932-1933). Il
lance une publication mensuelle, L'Écho de la Grande nouvelle, qui
paraît au moins de 1932 à 1939. Tout en perpétuant ses analyses, il y rejette
les sacrements car seul le cœur permet le pardon. Ne demeurent que le baptême
et l'eucharistie, qui libèrent le cœur et le nourrissent.
Entré en relation en 1933 avec Jacques Marcireau, il l'autorise à exploiter ses textes traitant de la sexualité. Des ouvrages paraissent alors sous son nom (La Vérité sur l'Orgasme vénérien chez la femme par un médecin, augmenté dans La Vérité sur l'Orgasme vénérien chez la femme par un médecin. La femme devant le plaisir sexuel. Nouvelle édition augmentée d'une réponse au livre du Dr Stekel : la Femme frigide et La conception n'est possible que 60 jours par an. Découverte médicale ? Ou fumisterie ? Suivi d'une étude sur le « coïtus interruptus », 1938, repris et enrichis dans La Femme et l'amour. Étude médicale et morale, 1939, réédité et aménagé en 1940, 1945,1952 et 1967 par Marcireau). La femme, vivant du Cœur, fut pervertie au Paradis par Satan en choisissant l'Intelligence. Devenue un objet pour l'homme, celui-ci l'exploite et la dresse pour en tirer du plaisir et lui l'orgasme, alors que seule la maternité lui convient. Tout mariage est une prostitution car l'amour n'y est pas pratiqué. La prostitution généralisée dans les sociétés dites chrétiennes manifeste leur perversion foncière. Un certain flou demeure : justifiant implicitement toutes les pratiques sexuelles pratiquées par l'amour (le coït est un acte a-moral car déterminé par la nature), il dénonce aussi les perversions inventées par l'homme, condamne médicalement le coïtus interruptus et défend l'éducation sexuelle féminine.
Atteint de
brightisme, il décède isolé.[189]
11) Le Comte de
la Thibauderie
En 1943, le comte Yvan Drouet de la Thibauderie fonde à Bordeaux, dans la clandestinité, un hebdomadaire, le Courrier Blanc, « spécialisé dans le cas Louis XVII ». Cette revue se rallie, aux environs de 1951, aux Bourbons de la Survivance et entretient des rapports avec l’organe trimestriel parisien de la même tendance, Flos Florum, dont elle insère maint communiqué.
Dans la même ville de Bordeaux, un petit groupe, autour de M. Guy Truchemotte s’intitule « Les amis de la Légitimité », et possède un bulletin intérieur, le Courrier de la Légitimité.
Or, sous le nom de Mgr Gabriel de Saint-Martin, le Comte de la Thibauderie est, depuis le 29 avril 1956, évêque régent de l’Eglise catholique française. Cette petite communauté dérive des initiatives de Joseph-René Vilatte, prêtre vieux-catholique qui alla chercher l’épiscopat dans la succession syro-jacobite.
De son côté, M. Guy Truchemotte, ordonné prêtre sous le nom de Père Patrick pour la Pentecôte de 1953, se trouve alors à la tête de la paroisse que cette minuscule église possède à Bordeaux.[190]
12) Rennes le
château
En ce qui concerne l’affaire de Rennes le Château, l’un des premiers auteurs a avoir parlé de cette histoire est Gérard de Sède, auteur ésotériste. Or dans ses ouvrages, l’auteur semble naundorffiste.
Voici quelques extraits de cet auteur :
« Plutôt qu'à la négociation d'un hypothétique trésor, le curé de Rennes le Château fut sans doute mêlé à la négociation de documents pouvant intéresser à la fois les Habsbourg et le Vatican, ce qui explique la présence insolite de l'archiduc sous son toit.
Si Saunière
était en possession de documents prouvant de façon irréfutable que Naundorff était bien Louis XVII, il est évident qu'il pouvait
en tirer une fortune, soit en les vendant, soit en se faisant payer son
silence, selon la position des hauts personnages intéressés par cette énorme
affaire. » (Le Monde Inconnu N°98, Oct. 1988, Rennes Le Château, Gérard de Sède)
« - 1891 : Péladan fonde l'Ordre du Temple et de la Rose-Croix Catholique. Saunière en devient membre et le fait savoir allusivement en ornant son église de symboles rosicruciens.
- 1903 : le pape Léon XIII meurt. Utilisant pour la première fois depuis le moyen âge le droit de veto du Saint Empire, l'empereur François Joseph de Habsbourg impose Pie X comme successeur à la place du cardinal Rampolla décidé par le conclave. Pie X était pape intégriste, ennemi juré de la franc-maçonnerie.
- 1914 : Benoît XV succède à Pie X et renoue avec la politique de Léon XIII et de Rampolla. Le Vatican acquitte Bérenger Saunière. Plutôt qu'à la négociation d'un hypothétique trésor, le curé de Rennes le Château fut sans doute mêlé à la négociation de documents pouvant intéresser à la fois les Habsbourg et le Vatican. Péladan et son disciple Saunière avaient fini par se convaincre que Louis XVII n'était pas mort dans sa prison du Temple et était réapparu sous l'identité de Naundorff ; les papes Léon XIII et Benoît XV partageaient cette conviction comme en témoignent quelques unes de leurs lettres, et c'était aussi, sur ses vieux jours, celle du compte de Chambord lui-même qui, pour cette raison, laissa passer volontairement les occasions de s'asseoir sur le trône de France, car il doutait de sa légitimité. 1ère hypothèse : Si Saunière était entré en possession de documents prouvant de façon irréfutable que Naundorff était bien Louis XVII, il est évident qu'il pouvait en tirer une fortune, soit en les vendant, soit en se faisant payer son silence, selon la position des hauts personnages intéressés par cette énorme affaire. 2ème hypothèse : L'archiduc qui vint à Rennes Le Château était celui que l'Histoire connaît sous le nom roturier de Jean Orth. S'il était Jean de Habsbourg-Toscane, déclaré mort à sa naissance et élevé par une famille Orth, ses droits sur l'Empire d'Autriche étaient plus légitimes que ceux de la branche régnant à Vienne. Les Habsbourg avaient donc avec Jean Orth le même problème que les Bourbons avec un Louis XVII éventuellement survivant. Si Saunière possédait les preuves de la véritable identité de Jean Orth, ... Version la plus vraisemblable : Les parchemins trouvés par Béranger Saunière étaient des documents rosicruciens de la famille d'Hautpoul et datant probablement du XVIIIème siècle, ce qui explique son introduction dans le milieu occultiste. Des gens appartenant à ce milieu conçurent, avec la complicité du curé, l'idée de fabriquer de faux documents historiques et généalogiques crédibles puisqu'en s'inspirant de faits réels, et susceptibles d'intéresser au plus haut point le Comte de Chambord et les Habsbourg, ce qui explique le don de la comtesse et la présence de l'archiduc à Rennes Le Château. Dans cette vaste partie d'échecs mettant en jeu d'énormes sommes, Saunière n'était qu'un intermédiaire, certes grassement rémunéré mais bientôt dépassé par les évènements et solidement tenu en laisse, ce qui explique pourquoi il devait céder à d'autres une grande partie de ses ressources. Les relations changeantes du Vatican et des Habsbourg expliquent enfin l'intervention changeante et les variations de la Papauté dans l'affaire. {Magazine, Le Monde Inconnu, No 9, 10/1988, Rennes le Château, Gérard de Sède}
« Von
Rochow, ministre de l'Intérieur du roi de Prusse a
déclaré : Je suis sûr que Louis XVII a
survécu, mais si cela se savait, ce serait le déshonneur de toutes les
monarchies européennes... Les documents en possession de l'abbé Saunière
pourraient prouver la survivance de Louis XVII. » (Rennes Le Château, Gérard de Sède)
Il en est de même pour l’auteur ésotériste Serge Hutin, extrait :
« La fameuse énigme de Louis XVII constitue un secret d'Etat de l'époque révolutionnaire. De nombreux indices dans l'affaire Naundorff laissent entrevoir que l'identification était réellement vraie. »
(Gouvernants
invisibles et sociétés secrètes, Serge Hutin, J'Ai Lu)
13) Michel Morin
Voici un exemple de catholique « ésotérisant » : Michel Morin. Son dernier ouvrage s’intitule : Le Grand Monarque selon les prophéties (Louise Couteau éditrice, 1995).
Michel Morin, né à Paris le 2 octobre 1945, vit au Québec depuis de nombreuses années. L’auteur est un astrologue renommé tant en Amérique qu’en Europe. Il a écrit par exemple des ouvrages comme : Nostradamus, Lire dans les lignes de la main, le Tarot de Marseille, etc.
Sous le pseudo de Michel Wartelle, il a écrit : Louis XVII ou le secret du roi (Editions de Mortagne, 1990).
Ancien naundorffiste, cet auteur est devenu richemontiste, mais avec une thèse originale :
1° La survivance du premier dauphin
2° Une double identification de Naundorff au premier dauphin et de Richemont au Duc de Normandie.
Cette thèse n’est pas soutenable.[191]
De la part d’un « ésotérisant », nous avons d’ailleurs droit à quelques « perles », par exemple il écrit dans son livre Le Grand Monarque selon les prophéties, page 140 :
« Il y a des hommes d’exception sur la Terre, comme Jean-Paul II, Nelson Mandela, le roi Hassan II du Maroc, etc., qui retiennent, de par leurs charismes personnels, le ciel de nous tomber sur la tête. Après eux, viendra un déluge d’eau ou de feu. »
Sans commentaire…
Michel Morin écrit page 89 :
« La descendance mâle du premier dauphin, celle de Charles Naundorff, est assurée à travers la branche aînée (française) et la branche cadette (canadienne). Par contre, la descendance mâle du deuxième dauphin, celle de Richemont, est inconnue à ce jour.
On sait que Richemont eut un fils durant son séjour aux Etats-Unis en 1810. Il en parle au cours de son procès de Rouen en 1818.
Je n’en ai malheureusement pas pu trouver la trace. Par contre, sa descendance féminine est importante et connue à ce jour. Parmi cette descendance, il y a, entre autres, une religieuse française décédée il y a quelques dizaines d’années. Cette sœur, véritable sainte, portait les stigmates du Christ. Elle a prophétisé sur l’avenir de la France et sur l’arrivée du Grand Monarque. Ses écrits sont connu du Vatican, mais n’ont jamais été publiés à ce jour.
Le baron de Richemont allait souvent en pèlerinage à la Salette et a rencontré Maximin Giraud plus d’une fois. »
Sic, en fait Maximin ne l’a vu qu’une fois.[192]
On sait que Richemont n’eut pas de descendants légitimes. Or, pour que la thèse de Michel Morin ait un intérêt, il faut que le baron de Richemont ait un descendant légitime. Michel Morin, reprenant la thèse de Xavier de Roche, mais l’attribuant à son Richemont, nous explique que « Richemont pourrait s’être marié fort jeune, contre son gré, à une princesse portugaise du nom de Maria de Vasconcelos, lors de son passage à la cour du Portugal. Elle lui aurait donné un fils, Luis Capeto, que l’on a retrouvé aux Açores. Il pourrait s’agir du Louis des Seychelles, mort à Mahé en 1865.
Michel Morin a bien connu le marquis André Lesage de la Franquerie, d’abord à travers ses œuvres inspirées, puis personnellement quelques années avant sa disparition.
Voici une photo, extraite du livre de Michel Morin : Le Grand Monarque selon les prophéties, page 9 :

Comme il le raconte lui-même, Michel Morin a « eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire, Maurice O., ami du marquis de la Franquerie, qui m’a définitivement éclairé sur le mystère Louis XVII.
C’est lui aussi qui découvrira vers 1982, sur le suaire de Turin, la tache de sang à l’effigie de Louis XVI.
Maurice O. m’expliqua alors comment prendre la piste Louis XVII et où se trouvaient certains documents. »
Dans son livre : Les ascendances davidiques des rois de France, le marquis de la Franquerie écrit page 15 : « Le 19 août 1983, j’ai reçu une lettre d’un ami, Monsieur M… O…, ancien élève de Polytechnique ».
Le marquis de la Franquerie d’abord « légitimiste », est très vite devenue survivantiste, mais sans se prononcer pour où contre Naundorff, Richemont, etc.
Tout simplement parce qu’il n’a pas lu toute la littérature naundorffiste. Et enfin, à propos de certaines voyantes, il n’a pas du lire leurs écrits ou le récit de leurs vies jusqu’au bout.
Par exemple, nous savons que Mélanie était naundorffiste, Dieu lui ayant révélé que Naundorff était bien Louis XVII. Le marquis de la Franquerie n’a pas dû lire le Journal de l’abbé Combe. Le marquis de la Franquerie cite Martin de Gallardon, mais insuffisamment renseigné, il ne sait pas que celui-ci a reconnu en Naundorff le fils de Louis XVI. Dernier exemple, le marquis de la Franquerie donne des extraits des écrits de la voyante Marie-Joseph Lavadoux. Or, dans ses écrits, la voyante a affirmé sa conviction que Naundorff était Louis XVII.
Pour terminer ce chapitre, citons encore ces trois auteurs naundorffistes ésotéristes :
_ Le docteur Rousseaux van Parys, affirme que l’énigme Louis XVII est résolue par la Radiesthésie : Naundorff est bien Louis XVII. Et cela grâce aux résultats des mêmes radiations du pendule sur différents portraits de Louis XVII et ceux de Naundorff.[193]
_ Phaneg, Georges (1867-1945) : Louis XVII et l'astrologie. (Préface de Adolphe Lanne, Paris, Dujarric, 1906).
_ Luc-Henri Clement : « Louis XVII. Descendance actuelle. Thème
astrologique. » (Chez l’auteur, Marseille, 1992)[194]
XVII] Naundorffisme et Franc-Maçonnerie
Il y a quatre sortes de francs-maçons naundorffistes :
· Il y a les vrais « initiés », ceux qui prirent part au complot de la Révolution française et qui prirent part à l’évasion du Dauphin.[195]
· Il y a les francs-maçons qui sont au courant du Secret d’Etat, par leur passage à la tête de l’Etat et au contact du Dossier Rouge.
· Il y a les francs-maçons qui s’intéressèrent à Naundorff quand il se mit à prêcher sa « Doctrine Céleste ».
· Et enfin, il y a quelques personne, perdues en maçonnerie, qui s’intéressèrent à la cause naundorffiste, par pur humanisme. C’est le cas par exemple de Boissy d’Anglas, qui était franc-maçon, ou de Jules Favre.[196]
Par contre,
s’ils sont persuadés que Naundorff est bien Louis XVII, les francs-maçons des
deux premières catégories sont des ennemis de Naundorff, et sont hostiles à une
restauration monarchique de Naundorff… Nous pouvons citer par exemple Alfred Naquet, « père du
divorce », et qui était naundorffiste et franc-maçon ; citons
également Aristide
Briand, socialiste, et qui était membre de
l’organisation para-maçonnique la « Chevalerie du Travail ».
1) Le comte de
Villiers de l’Isle-Adam, initiateur
Le second fils de Naundorff, Louis-Charles (1831-1899), qui épousa Hermine Van der Kruyff et mourut sans postérité, eut pour confident et ami le comte Auguste-Mathias-Philippe de Villiers de l’Isle-Adam (1938-1889).
Ecrivain célèbre, fier de sa pauvreté et de la gloire historique de son nom. Il fut l’ami bienveillant, l’initiateur à l’ésotérisme et à la thèse de la Survivance de Louis XVII du jeune Augustin Chaboseau, dont il fréquentait la famille originaire de Saint-Malo.
Robert Ambelain a fort bien connu Augustin Chaboseau (1868-1946), pendant plus de cinq années, et dont il a recueilli beaucoup de souvenirs sur le sujet.
Le fils d’Augustin fut un temps juge d’armes de Henri de Bourbon, duc de Bourgogne (alors à Casablanca).
Augustin Chaboseau avait été secrétaire privé de Clemenceau, et à ce titre il avait eu en main le célèbre Dossier Rouge des Affaires étrangères relatif à Naundorff, et en avait fait un digest détaillé pour son patron. Robert Ambelain a soigneusement recueilli les souvenirs et affirmations d’Augustin Chaboseau.
Robert Ambelain écrit : « J’ajoute qu’avant de me convaincre, Augustin Chaboseau avait rallié bien des noms connus des milieux martinistes : Ducormier (Phaneg) de son nom d’ordre), Mauchel (Chamuel), qui tenait une librairie spécialisée rue de Trévise, Yvon Le Loup (Sédir), V.E. Michelet, auteur des Compagnons de la Hiérophanie et du Secret de la Chevalerie. Quant à Stanislas de Guaïta (Nebo), et aux frères Péladan, Adrien et Joséphin, eux aussi avaient recueilli les confidences de Villiers de l’Isle-Adam et rallié la thèse de la Survivance.[197]
Voici maintenant quelques biographies de francs-maçons naundorffistes :
2) Les Chaboseau
CHABOSEAU Augustin - Écrivain, journaliste, homme public, martiniste et franc-maçon (Versailles 17.06.1868 - Paris 2.01.1946)
Descendant d'une famille de la noblesse française (Chaboseau de la Chabossière) dont les origines connues remontent vers 1220, il manifeste dans sa jeunesse des aptitudes exceptionnelles pour les études de lettres et de langues, des religions et de la philosophie. C'est ainsi qu'en peu de temps, ainsi qu'il le confesse dans ses écrits intimes, il apprend l'anglais, l'allemand, le latin et le grec. Il y excelle et sans effort se retrouve au plus haut niveau des étudiants de sa classe. Par la suite, il acquière sans plus de difficulté, l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais, le russe, le polonais et le slave ainsi que le provençal, le catalan, le flamand, le béarnais, le gascon. Quelques années plus tard, il possède aussi le breton, l'espéranto, le sanscrit et le pali. Ce don tout particulier, il l'exploitera au travers de ses écrits en collaborant à de très nombreux journaux et revues tout au long de sa vie. En 1886, il s'installe à Paris, entreprend des études de médecine et découvre avec un grand intérêt le Musée Guimet récemment ouvert. Sa passion des religions et des civilisations orientales le pousse à le fréquenter avec assiduité à tel point que le conservateur et bibliothécaire, Léon Milloué, lui propose une place d'adjoint qu'il acceptera avec plaisir.
Sur son chemin se trouve Pierre-Gaëtan Leymarie, le disciple d'Allan Kardec le plus entreprenant de la capitale. Celui-ci va ouvrir au jeune Augustin les portes de la recherche et des expériences psychiques, voire mystiques. Mais il semble que la rencontre qui transforma le plus sa jeune vie fut sa parente la marquise Amélie de Boisse-Mortemart. Selon A. Chaboseau, après lui avoir fait connaître les ouvrages consacrés au Martinisme dont il ignorait tout à cette époque, elle l'initia dans cette branche particulière de l'illuminisme chrétien, le plaçant à son tour au bout de la lignée partant de Louis-Claude de Saint-Martin en passant par Antoine-Marie Hennequin, Henri de la Touche, Adolphe Desbarolles et Amélie de Boisse-Mortemart. Si transmission initiatique de Science Initiatique il y eut, ce ne fut certainement pas au sein d'un ordre que Saint-Martin n'a jamais fondé, mais plutôt d'homme à homme et en l'occurrence de femme à homme, en dehors de tout groupement. Sur les conseils de Leymarie, il se rend, jeune externe, à l'hôpital de la Charité et rencontre Papus, alors jeune interne, et tous deux se lient d'amitié. L'histoire dit que lors d'une discussion entre les deux amis, se rendant compte de leur dépôt initiatique commun, ils décidèrent de se transmettre l'un l'autre ce qu'ils avaient reçu. Deux ans plus tard, l'Ordre Martiniste fut officiellement fondé et P.A. Chaboseau devint un des membres du Suprême Conseil en 1891 quand celui-ci fut créé pour diriger l'Ordre. Dans ce cadre, il collabora à L'Initiation (de 1889 à 1891), fut rédacteur en chef du Voile d'Isis, secrétaire de rédaction de Psyché et dirigea au sein du Groupe Indépendant d'Etudes Esotériques une section pour l'étude des sciences orientales. Poussé par Papus, il publie en 1891 un Essai sur la Philosophie bouddhique. En 1892, Stanislas de Guaïta le nomme membre de la Chambre de Direction de l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix.
À partir de 1893, il retire sa présence, sans démissionner toutefois, des travaux de loges et se consacre principalement à l'écriture (Les Cités Saintes en 1894) et aux conférences. Homme engagé politiquement, il milite alors pour la Ligue des Droits de l'Homme et la constitution des universités populaires et, lors de ces activités, il rencontre Rosalie Louise Napias qu'il épouse le 17 décembre 1902 et qui lui donne un fils, Jean, le 13 décembre 1903. On trouve des traces nombreuses de ses écrits rédigés sous des pseudonymes divers dans les domaines de la politique où il se fit de nombreuses relations internationales (il était proche des leaders du socialisme et fut secrétaire d'Aristide Briand de 1914 à 1917), du mouvement social, de la protection de la nature (le parc de Sceaux lui doit sa préservation). Depuis 1916, date de la mort de Papus, P.A. Chaboseau considérait que le Martinisme de 1888 avait dévié de ses bases et jusqu'en 1931, il préféra la fréquentation des loges maçonniques du Grand Orient de France et de celles du Droit Humain. Mais, sollicité par son fils Jean, il se décida à réunir ce qui pouvait encore l'être parmi les anciens et rouvrirent l'Ordre Martiniste qu'ils qualifièrent de Traditionnel. Il fut élu à la Grande Maîtrise mais préféra laisser la place à Victor-Émile Michelet, auquel il succéda en 1938 à la mort de ce dernier. En 1939, l'OMT entra dans la Federatio Universalis Dirigens Omnes Societatesque Initiationis, plus connue sous le nom FUDOSI. À cette occasion, Chaboseau fut nommé Directeur de l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix et remplaça Victor Blanchard dans ses fonctions d'Imperator de la FUDOSI qu'il partageait avec Emile Dantinne et Ralph M. Lewis. Mais la guerre menaçait et le réveil annoncé n'eut pas lieu. Replié avec sa famille près de Saint-Malo, à Saint-Servan, il poursuivit son travail d'écrivain tout en ayant confié à Jeanne Guesdon le suivi administratif de l'OMT qui, tant bien que mal, poursuivait sa route dans l'ombre. Peu avant la fin de la guerre, il quitta sa chère Bretagne et se rendit à Paris où il eut le malheur de voir les troupes allemandes piller sa bibliothèque qu'il avait eu le temps de débarrasser de ses papiers initiatiques. Il finit sa vie en ce lieu, toujours occupé à écrire et à préparer ses conférences et laissa le souvenir d'un homme doté de multiples talents et passeur de l'initiation martiniste.[198]
CHABOSEAU Jean, dit Hierax - Artiste peintre, franc-maçon, martiniste et occultiste (Paris 13e, 13.12.1903 - après 1953).
Après ses études de peinture, il épouse Madeleine Rebin, dont il aura deux enfants, s'installe au 13 rue Montmartre et connaîtra en tant qu'artiste peintre un certain succès. Si ce fils du célèbre martiniste Augustin Chaboseau ne joua pas un rôle prépondérant dans l’histoire de l'occultisme en France, sa participation ou ses diverses activités dans certains cercles ou fraternités initiatiques ou ésotériques furent tout de même remarquées. C'est ainsi qu'il est initié au grade d'apprenti le 24 mai 1932 à la Loge « Les Amitiés internationales » de la Grande Loge de France, est fait compagnon le 11 juin 1935 et est élevé au grade de maître le 30 janvier 1936 - avant d'accéder en 1939 aux ateliers du Suprême Conseil. Par la suite, on le retrouve au sein de la Franc-Maçonnerie du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dans la loge Hermès au côté de son ami et occultiste Georges Bogé de Lagrèze. Par ailleurs il est initié dans l'Ordre Martiniste (de Papus) en 1929 par son père et devient membre fondateur et secrétaire du groupe Athanor puis, en 1931, il lui suggéra « de réunir les survivants du Suprême Conseil de 1891 » à ses côtés quand ce dernier avec quelques amis voulurent revenir à un Martiniste plus conforme à celui de ses origines. « Pour le Noël 1939, Augustin et Jean Chaboseau ainsi que Georges Lagrèze étaient réunis et travaillaient à l'organisation de l'Ordre Martiniste Traditionnel qui, malgré la guerre, fonctionnait dans la clandestinité». Il est désigné en janvier 1946, par son père Augustin semble-t-il, comme Grand Maître de l'Ordre Martiniste Traditionnel (OMT) avant d'envoyer sa lettre de démission en septembre 1947, par égard - dira Robert Amadou, le spécialiste incontesté du Martinisme - à l'individualisme de Saint-Martin. Il revient dans l'Ordre Martiniste la même année, puis sollicite Robert Amadou pour une étude sur le Martinisme qui ne verra le jour qu'en 1953 grâce aux soins de Philippe Encausse. Dans les années 1930, il fréquente la Fraternité des Polaires dirigée par Victor Blanchard et qui se veut détentrice de la tradition boréale de Thulé puis adhère aussi à la Société Théosophique installée au 4 square Rapp (Paris), avant de diriger de mars 1949 à décembre 1950 - après le décès de l'occultiste H. Meslin de Campigny - la revue théosophique intitulée Le Lotus Bleu. Il reçoit aussi la consécration épiscopale des mains du même Henri Meslin de Campigny (Harmonius) à une date restée inconnue et prend le nom de Hierax. En 1937, il succède à Chamuel (Bardesane) à la tête de l'Église Gnostique de France. Cette dernière ne devait pas lui survivre et peu de choses sont connues sur la fin de son épiscopat, mais il est possible que le début de la seconde guerre mondiale soit une des causes de sa mise en sommeil car, à cette époque, Jean Chaboseau était sur le front. Ainsi s'arrêta certainement la carrière de l'adjoint de Lagrèze qui côtoya quelques-uns des plus grands occultistes de l'entre-deux-guerres. On lui doit quatre ouvrages intitulés Le Tarot, essai d'interprétation selon les principes de l'hermétisme (1946) avec une préface de son ami théosophe H.-M. de Campigny, La voyance, Comment la développer (1948), Le Tarot traditionnel, jeu complet dessiné par l'auteur, avec une notice et une méthode (1948) et La pensée, puissance inconnue (1951). Anobli sous le titre de Marquis de la Chabeaussière par Henri de Bourbon-Naundorff (Henri V), il écrivit un article en 1953 dans la Revue du Cercle Louis XVII montrant l'influence du Martinisme dans la pensée religieuse de Naundorff : La Doctrine céleste ou l'hérésie de Naundorff.[199]
3) Les Péladan
Si le premier, Louis-Adrien, est catholique légitimiste, devenu naundorffiste par la lecture des prophéties, son fils Joséphin, naundorffiste, est devenu franc-maçon.
PÉLADAN Louis-Adrien - (Le Vigan [Gard], 8.09.1815 - Nîmes, 7.03.1890).
Fils d'épiciers cévenols, il affirme d'abord sa foi dans un recueil de vers intitulés Effusions catholiques (1839) puis se fixe provisoirement à Nîmes où il ouvre un pensionnat en 1842, Après une tentative infructueuse pour entamer une carrière de journaliste politique à Paris en 1848, écarté de L’Univers par Louis Veuillot, il s'installe à Lyon où il milite pour la « décentralisation intellectuelle » en animant La France littéraire, artistique et scientifique (1856-1866), parmi les collaborateurs de laquelle on remarque Blanc de Saint-Bonnet, l'historien lyonnais Péricaud l'aîné, et surtout Augustin Bonnetty dont les Annales de philosophie chrétienne exercèrent une grande influence sur lui, Dès son retour à Nîmes (1870) commença une période d'intense activisme politique et religieux, qui lui valut de recevoir quelques années plus tard le titre de chevalier de l'Ordre de saint Sylvestre octroyé par le Saint-Siège dans le but de « récompenser les vertus et le mérite civil ». Orateur puissant, journaliste prolifique, dans son Almanach des Blancs, par un bon Français du Midi (1872) et dans l'Extrême droite (1875-1877) il défendit le légitimisme le plus « henriquinquiste » tout en poursuivant une œuvre d'infatigable compilateur de toutes les prophéties annonçant le retour du « Grand Monarque » et le foudroiement prochain de Paris-Babylone, Dans les Voix de la tombe, ou témoignages et prophéties sur l'état présent de la société (1858) et le Dernier mot des prophéties (trois parties, 1878, 1880 et 1881), il recueille et interprète celles de nombreux extatiques récents qu'il confirme par celles de Saint-Malachie et de Nostradamus, avec un pessimisme croissant auquel la mort de l'exilé de Frohsdorf ne devait que trop donner raison. Les prévisions du laboureur Martin de Gallardon, celles d'Anna-Maria Taigui, de Louise Lateau, des extatiques de Fontet et de Blain, l'apparition de la Vierge à La Salette, à Bouilleret dans le Cher (1887), etc., occupèrent ses dernières années.
De légitimiste, il devint naundorffiste convaincue.
Se situant par la candeur parfois maladroite de son style sur la limite imperceptible qui sépare l'orthodoxie de l'hérésie, il fut blâmé publiquement par l'évêque de Nîmes pour avoir essayé de lancer une dévotion nouvelle à la « sainte éclanche » du Christ, l'épaule sur laquelle avait reposé tout le poids des péchés du monde.
Il protesta dans une Lettre au pape au sujet d’une image de sainteté (avril 1879), mais n'en dut pas moins se montrer « aussi grand que Fénelon » en se rétractant. Son œuvre majeure demeure cependant les Preuves éclatantes de la Révélation par l'histoire universelle ou Monuments et témoignages païens, juifs et de tous les peuples, confirmateurs de la Bible et du Christianisme (Paris, Palmé, 1878), qui le situent à la suite d'Augustin Bonnetty dans la recherche d'une tradition primordiale par l'étude comparée des religions, Le recours à la science archéologique permet ici de retrouver les traces « dans tous les âges et dans tous les pays » d'une même parole qui, semblable aux prophéties anciennes et modernes, témoigne de la persistance avec laquelle le Dieu des Ecritures se révèle aux hommes.
PÉLADAN Joseph-Aymé, dit Joséphin - Ecrivain français, fondateur de la Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal (Lyon, 28.03.1858 - Neuilly-sur-Seine, 27 .06.1918).
Fils du précédent dont il subit fortement l'influence (dont son naundorffisme), ainsi que celle de son frère aîné l'homéopathe et occultiste Adrien Péladan fils, il s'installe à Paris en 1881 après un voyage en Italie qu'il présentera souvent comme un « Pèlerinage » aux chefs-d'œuvre. Il se fait d'abord critique d'art et s'en prend avec une violence déjà truculente aux tenants de l'art pompier ainsi qu'aux peintres réalistes et impressionnistes. Promouvoir la « mysticité » d'un Gustave Moreau, d'un Puvis de Chavannes, lui semble le meilleur moyen de lutter contre la « décadence latine » et de ramener l'époque à la religion par le moyen de l' « Art-Dieu ». Romancier lyrique et sensuel à la manière de Barbey d'Aurevilly (Le Vice suprême, 1884 ; A cœur perdu, 1887 ; Istar, 1888 ; L'Androgyne, 1890 ; La Gynandre, 1891, etc), mais également grand lecteur d'Eliphas Lévi, il se lie d'amitié avec Stanislas de Guaïta dès 1884 et fréquente les milieux de la nouvelle génération occultiste. Avec Papus et Guaïta, il fonde en 1888 l'Ordre kabbalistique de la Rose-Croix qui annonçait tenir sa légitimité initiatique de la Rose-Croix de Toulouse, à laquelle son frère était affilié ; puis s'en détache en 1890 à la suite d'une illumination personnelle. Ses romans étaient dominés depuis le Vice suprême par le personnage de Mérodack, mage moderne et prophète de la « décadence latine » ; après la découverte d'un quasi-homonyme biblique, le Sar Mérodack Baladan, Péladan prend lui-même le titre de Sar et n'épargne aucun moyen pour défrayer la chronique : procès tapageurs, excommunication d'Emile Zola et de la « femme Rothschild », publication dans la grande presse de remontrances au clergé récemment rallié au « schismatique » Lavigerie et même une mise en garde à l'évêque de Paris, coupable de profaner un animal sacré en autorisant des courses de taureaux qui insultaient aux origines « chal-déennes » de l'écrivain. Sous la bannière de sa Rose-Croix Catholique du Temple et du Graal, il organisa six salons d' « art idéaliste mystique » de 1892 à 1897 qui eurent le mérite de rassembler les tendances wagnériennes et symbolistes de la peinture fin-de-siècle. Durant ces mêmes années, il exposa dans Comment on devient mage (1892), Comment on devient fée (1893) et Comment on devient artiste (1894) une doctrine hétéroclite faisant de l'artiste un descendant de l'union des mortelles avec les anges de Lucifer-Prométhée ; et de la femme d'élite, une prostituée sacrée renouvelant les antiques traditions de Babylone au bénéfice de la Rose-Croix. A un premier succès de curiosité parisienne succéda un intérêt décroissant, jusqu'à la « mise en sommeil » de l'Ordre prononcée par le Sar en 1897. Se retournant alors sur lui-même, épouvanté du rôle étrange et peut-être ridicule qu'il s'était fait jouer, il résigna son titre et tenta de s' oublier dans un long Pèlerinage en Egypte et en Terre Sainte (1898). Plus discret après 1900, il n'en poursuivit pas moins une carrière prolifique de romancier, de critique d'art et d'éditorialiste royaliste au Soleil. Il vit en 1904 sa belle tragédie, Sémiramis, représentée aux arènes de Nîmes et semblait s'être définitivement rangé, lorsqu'un regain d'exaltation le précipita à partir d'août 1914 dans une abondante littérature « anti-boche » et lui dicta un Catéchisme du surhomme ainsi qu'une fausse Prophétie du .frère Johannès dont la supercherie fut rapidement découverte. Victime d'une intoxication alimentaire cinq mois avant l'armistice, il mourut dans l'amertume en laissant présager dans ses derniers écrits une transformation prochaine de sa pensée qui semblait devoir finalement le mener vers le nietzschéisme.[200]
4) René Viviani
Il fut tour à tour avocat, journaliste, député
socialiste, co-fondateur de l’ « Humanité » avec Jaurès,
ministre de 1906 à 1917 et président du conseil en 1914-1915.
Il appartenait à la loge parisienne
« Droit et Justice ».
Cet anti-clérical fanatique fut néanmoins un
homme d’Etat, au courant de beaucoup de choses qu’ignore le public. Voici l’article
qu’il publia dans « La Dépêche Algérienne » du 17 juillet 1891, à
l’occasion des décisions de la justice néerlandaise qui, définitivement,
rendirent le nom de Bourbon à la postérité de Louis XVII :
« Naundorff ? Ce nom obscur est cependant celui du
direct et dernier descendant du roi Louis XVI, dont les magistrats viennent de
reconstituer l’Etat-Civil dans une lointaine mairie de Hollande. Naundorff est
proclamé Bourbon.
Quelle romanesque et touchante aventure que
celle de cet horloger errant ! Cela touche à la légende et n’est point une
légende… Quelle fée enchanteresse le visitait dans un rêve ? C’était
l’espérance et un peu le souvenir. Misérable, il se rappelait que la misère ne
l’avait pas toujours courbé sous sa loi. Confusément il voyait passer devant
ses yeux, bien ouverts cependant, la vision d’un Palais doré, de domestiques
empressés, de gardes obéissants. Et puis, une voiture l’emportait avec sa mère
qui tendrement le berçait. Enfin, un tumulte populaire, une grande et triste
prison, des hommes l’arrachant aux bras de son père, un cachot.
Dernier souvenir : par une nuit noire,
de ce cachot la porte s’était ouverte et un homme l’avait emporté à demi
endormi.
Ces souvenirs passés hantaient le voyageur
intrépide. Après des jours et des jours, enfin, il entrait dans la grande
ville : c’est Paris… Il n’a pas fait un rêve, le souvenir ne l’a pas
trompé, il n’est pas fou. Il est bien le fils infortuné de l’infortuné Monarque.
Avec son père, il a bien été au Temple, il se rappelle maintenant et les
détails du passé reviennent à son esprit troublé. Il est le Dauphin –
qu’une légende a proclamé mort au Temple – le Dauphin que des amis ont ravi à
la prison et à la mort dans l’espérance de jours meilleurs. »
René Viviani évoque ensuite les efforts de
Naundorff, de ses enfants, du vieux « procureur
du roi » qu’était Gruau de la
Barre et du
jeune avocat républicain : Jules Favre ; leurs échecs ; leur obstination.
Il conclut :
« Le fils de Naundorff succomba devant la Cour de Paris. Il partit,
fort de son Droit imprescriptible. Touchante et noble obstination qui prouve
que l’homme qui ne s’abandonne pas est toujours le maître de l’insolente
Fortune.
Cette obstination vient d’avoir sa
récompense. L’Etat-Civil est reconstitué. Cet enfant n’est plus
« Naundorff », il est Bourbon. Il appartient à la
lignée légitime, il est de la branche aînée. Il est l’arrière-petit-fils de
Louis XVI, le petit-fils de ce Dauphin qu’une
légende proclamait mort au Temple, quand des mains amies l’en avaient
miraculeusement sauvé. »[201]
5) René Philipon
Occultiste en correspondance avec Henri Chacornac, il publia des articles dans l’Initiation sous le pseudonyme de Jean de Tabris en 1895. Il édita la Bibliothèque rosicrucienne, qui comporte douze titres, publiés entre 1897 et 1901, sous les auspices d’une autorité spirituelle : l’Ordre de Misraïm, dont il faisait partie. Il s’intéressait également à beaucoup d’autres choses, en particulier, à Lopoukhine, Quelques traits de l’église intérieure ; « Avez-vous lu les ouvrages de Madrolle, Naundorff, Vintras et le Père Huc ? » Pouvait-il ajouter en post-scriptum à une lettre adressée à Chacornac.[202]
6) Emile Dantinne
Plusieurs membres de la F.U.D.O.S.I. (Fédération Universelle des Ordres et des Sociétés Initiatiques) ont été des naundorffistes convaincu. Par exemple Emile Dantinne, royaliste, opposé au régime républicain.
Emile Dantinne s'inscrit dans la même filiation rosicrucienne
toulousaine, puisqu'il détient l'héritage de la Rose-Croix Catholique de
Péladan. Pythagoricien, peu enclin à maçonner,
persuadé que Louis XVII avait survécu - c'était le naundorffisme
(qu’il tient de Péladan) - et que le trône de France attendait le retour de son
roi pour balayer la démocratie, Dantinne s'aidait d'un adjoint, Jean Mallinger, facilement convaincu du peu d'importance
à allouer à la Maçonnerie trop démocratique à son goût et bon exégète du
pythagorisme contemporain.
Voici l’extrait d’un document personnel, écrit par Emile Dantinne, daté et écrit quelque part entre 1939 et 1945 :
« Il nous a été révélé que le destin de la renaissance européenne était attaché à la restauration de la monarchie française et que la branche directe des descendants de Louis XVI appelée Naundorff était élue par Dieu.
Pour remplir la mission que le Très Haut nous confie, je vous invite tous dès à présent à apporter à la restauration du Royaume de France toutes vos forces et toute votre influence.
C’est parce que le prétendant Louis de Bourbon s’offre comme le défenseur des valeurs spirituelles et le restaurateur d’une France chrétienne ; c’est parce que, en Chevalier du Christ il entend ne tenir son royaume que le Dieu seul, que nous acceptons de lui apporter notre concours sur le plan de la réalité sociale comme sur le plan de la réalité spirituelle.
Une dernière révélation nous a désigné comme le restaurateur du monde spirituel et le réalisateur de la grande réconciliation de tous les enfants de Dieu, tournés vers l’Eglise faisant appel à tous les hommes de bonne volonté, un religieux bénédictin, le R.P. Cordonnier[203], qui est appelé à jouer auprès du futur Roi de France un rôle extrêmement important et un rôle plus important encore dans la vaste réforme religieuse quand les pouvoirs lui en seront donnés.
La Providence a voulu que les plans de restauration spirituelle de ce religieux fussent en concordance parfaite avec la conception qu’en a la Rose-Croix parce que l’un et l’autre sont réellement le reflet des desseins de Dieu. »
C’est pourquoi, Chers et Illustres Frères, nous vous demandons à tous de lui apporter, comme au Roi de France, lorsque l’heure sera venue, aide et secours en toute occasion. »
Jules Bois (1868-1943)
Homme de lettres et publiciste spécialisé dans l'occultisme.
Né
Jules-Antoine-Henri Bois le 28 septembre 1868 à Marseille. Fils de
Jacques-Antoine-Michel Bois, négociant, et de madame née
Henriette-Emmanuelle-Françoise Espina. A peine âgé de dix huit ans, il est
déjà en correspondance avec Charles Maurras. Au début des années 1890, il
commence à se faire connaître dans les milieux ésotéro-occultistes et
littéraires. Il publie d'abord un mince essai Les noces de Sathan (1890)
qui révèle déjà son attrait pour l'occulte et sa passion du mystère. L'année
suivante il donne à lire un dialogue Il ne faut pas mourir (1891) et, en
avril, prononce une première conférence à Marseille qui a pour thème La
jeunesse de demain. En 1891-1892 il est secrétaire de rédaction de l'Etoile
fondée par Albert Jaunet; par la suite, entouré de Maurice Boukay, Edouard
Schuré, Charles Couïba etc., il lance sa propre revue le Cœur (1893-1895)
axée sur le thème « féminin » dans une perspective ésotérique et
prophétique. Il verra d'ailleurs à développer amplement ce thème dans de
nombreux ouvrages : L'Eternelle Poupée (1894), L'Eve Nouvelle (1896),
La Femme inquiète (1897) et Le Couple futur (1912) où, voisinant
les « utopies les plus osées », l'auteur présente des « vérités
de morale élémentaire » (compte rendu dans Romans-Revue, 1912, p.
409), qu'il paraît découvrir. Partie prenante dans la « guerre des
mages » impliquant Stanislas de Guaïta et l'abbé Antoine Boullan en 1893
il va jusqu'à accuser publiquement le premier d'avoir signé l'arrêt de mort du
second au moyen de pratiques occultes. Provoqué en duel, il fait la manchette
des journaux de l'époque. Après avoir présenté Les petites religions de
Paris (1894), aidé de Joris-Karl Huysmans avec qui il est en contact de
1893 à 1906 (Fonds Lambert, Bibliothèque de l'Arsenal), il livre tout ce qu'il
sait sur Le Satanisme et la Magie (1895). Ami de Samuel Matthers de l'Hermetic
Brotherhood of the Golden Dawn (Lettre de J. Bois dans Annales
initiatiques, juill.-sept. 1933) et partisan de la cause naundorffiste,
d'autre part il anime pendant plusieurs années des conférences bi-mensuelles
sur l'ésotérisme, l'occultisme et la magie.
Introduit
chez la duchesse de Pomar, Lady Caithness et en contact avec les milieux qui
gravitent autour de Papus, il fait la connaissance de la célèbre Emma Calvé[204]
dont il devient l'amant. Accompagné du swami Vivekananda, le couple voyage en
Grèce, en Turquie et en Egypte en 1899-1900. A son retour, Jules Bois ajoute à La
douleur d'aimer (1896), Une nouvelle douleur (1900) et Le Mystère
de la volupté (1901). La tumultueuse liaison de la cantatrice avec le « très
féminin » Jules Bois se prolonge jusqu'au début de 1903 (Gombert, P.,
« Une Diva chez les occultistes », Revue du Rouergue, juill.-sept.
1973). Après un voyage qui le mène de l'Afrique du Nord jusqu'au pays des
yogis, il publie ses Visions de l’Inde (1903) et collabore, tant comme
poète et dramaturge que comme critique, à de nombreux périodiques littéraires,
la Revue dorée, le Semeur, les Annales politiques et littéraires,
Théâtre et littérature, Heures littéraires, Isis etc. Fort intrigué par les
énigmes de l'au-de1à, en 1902 il avait vu à rassembler les diverses conceptions
et interprétations en la matière dans Le Monde invisible et L'Au-Delà
et les forces inconnues. Rédacteur au Matin au début du siècle, il
profite de l'occasion pour se livrer à une vaste enquête auprès des
spécialistes de la métapsychique dont les résultats sont rassemblés dans Le
Miracle moderne (1907) qui annonce en conclusion « la création d'une
humanité supérieure ». Son penchant romantique et spiritualiste trouve à nouveau
libre cours dans Le Vaisseau des caresses (1908), L'Humanité divine
(1910), L'Amour doux et cruel (1913) et dans L'Eternel retour (1914).
Chargé de mission par Charles Humbert, directeur du Journal, Il
s'embarque pour les Etats-Unis en février 1915. Sur le sol .américain, pendant
plus de dix ans, il s'occupe de cinéma, de littérature et d'art, fonde à New-York
une société de sciences psychiques, fait office de conférencier et pousse la
vente de ses livres - dont un Essay on Democrary. A propos of fifteen hundred
years of Europe (1924) - très bien accueillis par un certain public
(« Qu'est devenu Jules Bois? », Comoedia, 14 sept. 1923). De
retour, en 1927, il poursuit sa carrière de journaliste. Compromis au début de
la guerre dans des opérations de propagande allemande, il se réfugie à Londres
où il serait décédé en 1943, victime de la guerre.[205]
Jules Bois publiait, en décembre 1900, dans la Revue
de l’Hypnotisme du
Dr Bérillon (page 186) :
« Il y a quelques années, dans l’Isis
Moderne, je me suis essayé à présenter le
pseudo-imposteur Naundorff en
tant que fondateur du Spiritisme moderne. Bien avant Allan Kardec, il formula l’évangile de la foi spirite.
Mais comme Swedenborg, Naundorff pensait communiquer moins avec
les morts qu’avec les Anges et Jésus-Christ lui-même qu’il crut voir à Paris
dans sa chambre misérable alors que tous l’avaient abandonné. Naundorff tenait
d’ailleurs autant sa « révélation » qu’à son titre de Bourbon
authentique. Et cet étrange « imposteur » se fâcha avec les plus
riches de ses partisans plutôt que de renoncer à ses croyances. Ce qui
d’ailleurs est tout à son honneur ; car il tenait plus à ses convictions
qu’à l’argent, à la réussite et à la situation de fils de Roi. »
M. Leymarie a
inséré, vers 1895, des extraits importants des œuvres du « Duc de
Normandie » dans sa Revue Spirite et
Lady Caithness (Mlle de Mariatégui, dont le premier mari a été le général duc
de Polmar, Espagnol) qui a joué un rôle retentissant dans le spiritisme et la
théosophie à Paris, a publié une grande partie des mêmes œuvres dans son
journal : L’Aurore du Jour Nouveau.
Lady Caithness (1832-1895)
Spirite et
illuminée. Née Maria de Mariategui en 1832 en Espagne. Fille du comte
Antonio-José de Mariategui et de la petite-fille catholique du marquis de
Northampton, madame née Mary Compton. Dès l'adolescence elle est attirée par
le mysticisme et s'adonne à .l'étude de l’occulte ; il semble qu'elle
songe même à entrer dans quelque couvent. Blonde, de haute taille, d'une grande
beauté et héritière potentielle d'une fortune considérable, elle épouse un
général à la retraite beaucoup plus âgé qu'elle, le duc Manuel de Pomar dont
elle aura un fils. Sa vie se déroule alors entre les milieux mondains madrilènes
et ses domaines de La Havane. Veuve, elle quitte l'Espagne, gagne l'Ecosse et
s'installe à Windsor afin que son fils Emmanuel poursuive ses études chez les
jésuites de Beaumont Collège. Entre temps elle développe ses capacités
mediumniques et « communique » avec Marie Stuart - communications qui
auront pour premiers fruits Old Truths in a New Light (1876) et Serious
Letters to Serious Friends (1877) qui suscitent des réactions sévères du
clergé tant anglais qu'espagnol ; malgré les exhortations, la duchesse
poursuit ses pratiques spirites. En 1872 elle se remarie avec lord James
Barrogill, chef du clan Sinclair, quatorzième comte de Caithness, et s'insta11e
à Barrogill Castle. En 1876 elle s'affilie à la Société théosophique récemment
fondée par madame H.-P. Blavatsky et, l'année suivante, au cours d'une visite à
l'abbaye en ruine d'Holyrood (Une visite nocturne à Holyrood, 1884), elle
expérimente une entrevue avec la défunte reine d'Ecosse qui scelle
définitivement son destin.
Suite à la
mort de son second mari survenue à New-York en 1881 et à l'inhumation de sa
dépouille en l'ancienne chapelle royale de Marie Stuart à Holyrood, elle
s'installe entre Paris et Nice, devient dès lors la représentante de la Société
théosophique en France - s'intitulant « présidente de la Société
théosophique d'Orient et d'Occident », véritable « section
ésotérique » de la Société théosophique de madame H.-P. Blavatsky -
et finance en grande partie la diffusion de la nouvelle doctrine sur le sol
français. En mars 1884, accompagnée du baron Spedalieri, elle accueille madame
Blavatsky à son retour de l'Inde et la reçoit chez elle à Nice. Quelques mois
plus tard elle marque ses distances par rapport à l'Orient et se dirige dans
un sens plus proprement occidental, dans la ligne d'un « christianisme
ésotérique » prenant appui sur Boehme et Swedenborg et, à cette fin,
lance l'Aurore du jour nouveau (1886-1895) qui s'assure la collaboration
de Anna Kingsford, madame E. de Morsier, Edouard Maitland, René Caillié, Albert
Jounet, les abbés Paul Roca, Calixte Mélinge, J.-A. Petit etc. La duchesse n'en
continue pas moins de poursuivre la publication d'ouvrages qui se veulent
inspirés à la fois de l'Orient et de l'Occident Mystery of the Ages
contained in the Secret Doctrine of all Religions (1887), Théosophie
bouddhiste (1886), Théosophie chrétienne (1886), Théosophie
sémitique. Les vrais Israélites, l'identification des dix tribus perdues avec
la nation britannique, les suffis et la théosophie mahométane (1888) etc.
Son hôtel
privé du quartier de Wagram constitue dès lors la plaque tournante, le lieu de
rendez-vous de l'intelligentsia ésotéro-occultiste française. Tandis que le
culte qu'elle voue à Marie Stuart - elle ira même jusqu'à se considérer comme
sa réincarnation - tend maintenant à s'allier à celui de Naundorff, à l'automne
de 1888 elle suscite la création de l'Eglise gnostique en organisant une
opération spirite qui aboutit à l'investiture de Jules Doinel. L'année suivante
elle partage avec Charles Fauvety et Eugène Nus la présidence d'honneur du
Congrès spirite et spiritualiste de 1889. Amie de Georges Chamey qui signe du
pseudonyme de Léo Michel, elle préface son ouvrage consacré à La Fleur de
France (1890) et reconnaît en Jeanne d'Arc le guide caché du féminisme.
Jusqu'à sa mort survenue à Paris, des suites d'une crise d'asthme, le 2
novembre 1895, elle ajoute à ses nombreuses publications dites inspirées
« directement d'en-haut, du cercle du Christ et de l'Esprit de Vérité - le
Messie de la Nouvelle Dispensation » et dont l'objectif vise à la
constitution du « Christ social » réalisé sous l'action de l'Esprit
conçu comme le « divin féminin » Interprétation ésotérique des
livres sacrés (1891), Révélations d'en-Haut sur la science et la vie (1893),
L'ouverture des sceaux (1893), Le spiritualisme dans la Bible (1894), La
Rénovation religieuse (1895), « Je me suis éveillée ».
Conditions de la vie de l'autre côté. Communiqué par écriture automatique (1895)
et Le secret du Nouveau Testament (1896). [206]
9) Robert
Ambelain
Occultiste, historien contestataire. (1907-1997) Patriarche de l’Eglise gnostique apostolique, grand maître mondial du rite de Memphis-Misraïm et de plusieurs sociétés initiatiques.
Il fut à une époque « chancelier » des Princes de Bourbon du Canada (branche cadette des descendants de Louis XVII).
AMBELAIN Robert, dit Aurifer (Jean III, Eques a reconciliatione) - Occultiste, historien contestataire. Patriarche de l'Eglise gnostique apostolique, grand maître mondial du rite de Memphis-Misraïm et de plusieurs sociétés initiatiques (Paris, 2 septembre 1907 - 27 mai 1997).
Entré en occultisme dans les années 30, il consacre aux sciences occultes ses premiers livres : Éléments d'astrologie scientifique (1936, 1938) ; Traité d'astrologie ésotérique (1937, 1938, 1942) ; Dans l'ombre des cathédrales (1939) ; La géomancie magique (1940) ; La talismanie pratique (1950) ; Les Tarots (1950) ; La kabbale pratique (1951) ; Les visions et les rêves (1953) ; Le Dragon d'or (1958) ; Le cristal magique (1962). Il s'intéresse également au néo-druidisme, publie Aux pieds des menhirs (1945) et étudie Les triades celtiques (1948).
Constant Chevillon le reçoit maçon dans la loge La Jérusalem des vallées égyptienne (Paris, 26 mars 1939). Puis il est reçu compagnon et maître (27 juin 1940), au camp de prisonniers d'Épinal, au cours d'une tenue clandestine. Admis dans l'Ordre martiniste par Paul Laugénie (Paris, juin 1939), il reçoit des mains d'Henri Meslin l'initiation de supérieur inconnu initiateur (décembre 1940), qu'il transmet à son tour aux martinistes de la clandestinité. Puis il réveille (1942-1943) l'Ordre des chevaliers maçons élus Cohens de l'univers, fleuron de l'ésotérisme chrétien au XVIIIe siècle, après avoir reçu de Georges Lagrèze par communication, les grades de grand architecte, de grand élu de Zorobabel, et selon le cérémonial reconstitué, un grade de réau-croix (3 septembre 1943) et un grade de grand profès à partir duquel il compose une pseudo-grande profession, qui s'est aujourd'hui répandue, sous la forme d'une ordination qui puise sa source, dit-il, dans la succession apostolique de l'Église gnostique. Mais c'est en vertu d'une filiation spirituelle efficace que s'opère la résurgence des élus Cohens qui donne le jour à l'Ordre martiniste des élus Cohens (déclaration officielle le 9 décembre 1944), dont il recueille (avril 1946) la succession de Lagrèze, son premier grand maître. Sa Franc-maçonnerie occultiste et mystique: le Martinisme (1946), que corrige sur des points fondamentaux Le martinisme contemporain (1948), porte témoignage de ces expériences antérieures à la découverte de rituels originaux du XVIIIe siècle qui lui ont permis ensuite de corriger ou d'affiner sa propre reconstitution des opérations Cohens.
Dans les
conditions exceptionnelles de l'Occupation, Lagrèze lui confère également tous
les hauts grades du rite écossais ancien et accepté, dont le 33e (20 août 1942),
et les grades spécifiques du rite de Memphis-Misraïm, dont le 66e (8 août 1943)
et le 95e, avec la fonction de substitut grand maître (15 août 1944). Dans le
même temps, Lagrèze, Roger Crampon, René Wibaux et Camille Savoire, le
mandatent pour constituer la loge clandestine Alexandrie d'Egypte (mai
1943), qui se réunit à son domicile, à Paris, contribuant ainsi à préserver la
franc-maçonnerie pourchassée. Désigné par Charles-Henry Dupont pour lui
succéder à la grande maîtrise du rite de Memphis-Misraïm pour la France (13 août
1960), il le développe dans de nombreux pays, et un convent international le
porte à la grande maîtrise mondiale (1965), qu'il transmet à Gérard Kloppel (31
décembre 1984). Adoubé chevalier bienfaisant de la cité sainte (CBCS) par
Georges Lagrèze (3 septembre 1943), puis admis au Grand Prieuré de France (10 novembre
1962), il reçoit par ailleurs les grades du rite suédois. On lui doit une
édition des Cérémonies et rituels de la
maçonnerie symbolique (1957)
et un petit chef-d'œuvre sur La
symbolique des outils dans l'art royal (1965).
Il reçoit (1945) de Georges Lagrèze l'initiation dite des rose-croix d'Orient dont Templiers et Rose-Croix (1955) évoque la lignée, dont il a publié la technique, qui relève de L'Alchimie spirituelle (1961), et le Sacramentaire du Rose-Croix (1962). L'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, fondé par Stanislas de Guaïta en 1888, a souvent été conçu lui-même comme une école complémentaire de l'Ordre martiniste. En succession de Lagrèze qui le lui lègue (1946), il le réveille (déclaration officielle en décembre 1957), et publie sous son égide La magie sacrée d'Abramelin le mage (1959), qu'il expérimente lui-même, d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal.
Après avoir publié
Adam, dieu rouge (1941), il reçoit la filiation dite « spirite »
de l'Eglise gnostique de Jules Doinel, des mains d'Henri Meslin (1943). Puis
Roger Ménard l'ordonne prêtre (10 juin 1946), puis évêque de Samarie, selon la
filiation apostolique, sur une lignée antiochienne où s'inscrit Julien-Ernest
Houssay, à qui il consacre un petit livre : L'abbé Julio (1962). Après avoir lui-même constitué l'Eglise
gnostique apostolique (1954), qui se donne alors pour but essentiel « la
lutte théurgique contre la magie », il est élu patriarche par le haut
synode, sous le nom de Jean III (septembre 1958), et reçoit le pallium
patriarcal légué par Mgr Louis-François Giraud (20 décembre 1959). Parallèlement,
il hérite de Charles-Henry Dupont du patriarcat de l'Eglise gnostique
universelle (15 août 1960) qu'il fusionne avec sa propre communauté.
Encourageant la résurgence de l'Ordre martiniste, il en transmet la filiation à l'ensemble du suprême conseil réveillé par Philippe Encausse (1952) et collabore à la revue L’Initiation, qui en est l'organe, dont il devient rédacteur en chef (1957). Il est à l'origine du rapprochement entre l'Ordre martiniste présidé par Philippe Encausse, l'Ordre martiniste dit de Lyon, sous la grande maîtrise de Dupont, et l'Ordre martiniste des élus Cohens, qui signent l'accord fondateur d'une Union des ordres martinistes (26 octobre 1958). Les mêmes signataires constituent d'ailleurs sous son impulsion un Grand prieuré martiniste (décembre 1959).
L'année 1967
marque dans sa vie spirituelle et sociale une étape inattendue : il renie
la foi et la gnose judéo-chrétienne, prétend même que Jésus n'est qu'un faux
messie comme entend le montrer Jésus et
le mortel secret des templiers (1970). Désormais militant agnostique, il
publie La vie secrète de saint Paul (1971), Les lourds secrets du Golgotha
(1974), Les secrets d'Israël (1995)
et s'éloigne de plusieurs écoles. Il confie alors à André Mauer le patriarcat
de l'Eglise gnostique apostolique (1967), et à Ivan Mosca la responsabilité de
l'Ordre martiniste des élus Cohens (21 juillet 1967). Dans le même temps, il se
fait réinitier dans la filiation dite du « martinisme russe » (1968)
et fonde l'Ordre martiniste initiatique (1968), qui revendique une filiation
directe en provenance de Louis-Claude de Saint-Martin. Enfin, en vertu des
pouvoirs reçus de Dupont, il réveille une loge du Early Grand Scottish Rite, et
encourage la restauration du rite de Misraïm. Mais sa Franc-maçonnerie oubliée (1985) tantôt réhabilite et
tantôt méconnaît la réalité de la franc-maçonnerie traditionnelle.
Parallèlement, il continue de s'intéresser aux sciences occultes, ainsi qu'en témoignent ses derniers ouvrages : Le vampirisme (1977) ; Symboles et rituel de la chasse à courre (1981) ; La géomancie arabe (1984) ; Le Fal-Nameh ou Livre du sort (1985), La géomancie chinoise (1991), et particulièrement à l'astrologie traditionnelle : L'astrologie des interrogations (1984) ; Koré. La dixième planète (1991) ; Retour à Samarkande (1992) ; Retour à Alexandrie (1994).
Revendiquant la qualité d'historien contestataire, il signe par ailleurs : Crimes et secrets d'Etats (1980), Drames et secrets de l'histoire (1981), La chapelle des damnés (1983), Capet, lève-toi... (1987), Le secret de Bonaparte (1989), Les arcanes noirs de l’Hitlérisme (1990). On lui doit aussi un unique roman historique : Bérénice ou le sortilège de Béryte (1976).[207]
XVIII] Quelques fausses hypothèses
_ Louis XVII avait des marques d’inoculation sur les deux bras, alors que Naundorff n’en avait que sur un bras ? (Argument que les anti-naundorffistes sortent souvent)[208]
Au début, les anti-naundorffistes écrivirent que Louis XVII n’avait jamais été inoculé. M. de Manteyer, écrit dans Les débats le 12 mai 1912 que Louis XVII n’a jamais été inoculé. Mais l’écrivain naundorffiste Henry Provins trouve les procès-verbaux de l’inoculation signés par les médecins de la cour de Louis XVI et les publie dans l’Impartial de Paris du 25 juin 1912.
Après ce coup fatal, Manteyer change alors d’argument et affirme alors que Naundorff n’avait qu’une seule trace d’inoculation, et non deux.
L’examen post-mortem du corps de Naundorff indique en effet, comme « signes extraordinaires extérieurs » qui marque le cadavre : « … trois cicatrices d’inoculation, dans la forme triangulaire la base en dessous au côté médial du bras gauche à la supérieure et moyenne troisième partie … »
Or, Naundorff avait bien les traces d’inoculation sur les 2 bras, plusieurs de ses amis l’ont vu et écrit.
Gruau de la Barre qui, lui, a vu les traces d’inoculation sur les deux bras, l’a écrit dans ses Intrigues dévoilées, (Tome I, page 41), 60 ans avant que cette objection soit soulevée :
« Comme le Dauphin, il avait sur les deux bras des marques d’inoculation, disposées en triangle, contre l’usage, et par la volonté expresse de la Reine. Madame de Rambaud, témoin de l’inoculation faite au Dauphin, a déclaré que les cicatrices du prince qu’elle a reconnues, étaient exactement celles d’un instrument qui n’avait servi que pour le Dauphin. »
Mais il n’a pas pris soin de faire consigner par écrit ce fait, ne pensant pas à cette objection puérile : car enfin, comme l’affirment bien des médecins, les traces d’inoculations peuvent subsister sur un bras et s’effacer sur l’autre.
Madame de Rambaud (même
si, 45 ans après, elle s’est trompée sur le jour exact de l’inoculation, ce qui
est mineur – et compréhensible après un si long temps) a retrouvé sur les bras
de Naundorff les
cicatrices de l’inoculation du 15 mai 1788, avec leur location et leur forme
précise.
Voici ce qu’elle écrit à la duchesse d’Angoulème : « Le prince fut inoculé au château de Saint-Cloud, à l’age de deux ans et quatre mois, en présence de la reine, par le docteur Jouberthou, inoculateur des Enfants de France ; et de la Faculté, les docteurs Brunyer et Loustonneau. L’inoculation eut lieu pendant son sommeil, entre dix et onze heures du soir, pour prévenir une irritation qui aurait pu donner à l’enfant des convulsions, ce qu’on craignait toujours. Témoin de cette inoculation, j’affirme aujourd’hui que ce sont les mêmes marques que j’ai retrouvées, auxquelles on donna la forme d’un triangle »
Madame de Rambaud n’a cherché que la forme particulière de ces marques comme preuve d’identité et non pas leur nombre.
Nous savons que l’inoculation du Dauphin a eu lieu le 15/05/1788 à 9h1/2 du soir
suivant la méthode des piqûres sur les 2
bras
Tout cela est relaté dans les bulletins des médecins Brunyer et Jauberthou aux Archives Nationales et dans le « Journal de Paris » :
Samedi 17/5/1788 (N° 138) :
« Avant hier jeudi 15 du présent mois, Monseigneur le Duc de Normandie fut inoculé, par ordre du Roi, dans le Château de St-Cloud, à 9 heures et demie du soir, en présence de la Famille Royale, de Mme la Gouvernante des Enfants de France et des premiers officiers de santé attachés au service de Monseigneur.[209]
Le Sr Jauberthou a pratiqué, suivant la méthode des piqûres, sur les deux bras du Prince l’insertion du levain variolique……. »
Dimanche 25 Mai 1788 (N°146) :
«Au château de St Cloud à midi ce 24 Mai 1788. L’après-midi de Vendredi, Monseigneur le Duc de Normandie a plus souffert des bras que les jours précédents. Le soir sur l’un et l’autre bras les boutons des piqûres avaient considérablement grossi. La peau des environs, dans toute la circonférence, était très rouge et enflammée… »
Lundi 26 Mai 1788 (N°147) :
«Au château de St Cloud à midi ce 25 Mai 1788… dans la nuit du Samedi au Dimanche, pendant la nuit il s’est fait sur le corps une éruption de quelques nouveaux boutons varioliques, ainsi que sur les bras aux environs des piqûres »
Ainsi grâce aux bulletins des médecins nous constatons que l’inoculation a pris parfaitement sur les 2 bras.[210]
Soit les cicatrices sur le bras droit se sont altérées
avec le temps (et les aventures), soit elles étaient bien là sur le corps de
Naundorff à sa
mort, mais l’enflure des chairs empêcha de voir certains signes.[211]
Notons que les médecins de Delft (leur examen
ayant eu lieu deux jours après le décès) ont remarqué un commencement de
décomposition caractérisé par le développement des gaz, ce qui ne leur a pas
permis d’observer pleinement tous les signes portés par le corps, certains
devenant de ce fait peu connu. (Extrait de l’examen du corps de
Naundorff : « Quatrièmement à la poitrine : … les côtes ne
peuvent pas être comptées à cause de la formation de gaz. »)
Pour finir, voici ce qu’écrit Président
Berge :
« On fit au Dauphin trois
piqûres en triangle en formant un croissant, sur les deux bras.
Remarquons trois choses importantes : la
première, est que la date de naissance de Naundorff est la
même que celle de Louis XVII (L’examen des restes de Naundorff à Delft a
fait déclarer qu’il avait à sa mort soixante ans « ne pouvant être
dépassés. » Ces soixante ans nous amènent à 1785, date de la naissance du
Dauphin.) ; la seconde, c’est qu’on le voit
vacciné comme Louis XVII dans des conditions très exceptionnelles avant que la
vaccination soit vulgarisée ; la troisième est que le Dauphin a été
vacciné par trois piqûres en forme de croissant et que ce sont là les marques
que portait le cadavre de Naundorff. Ces constatations sont absolument
déterminantes !
Nos adversaires peu résignés eurent alors la
pauvre ressource, au lieu de mettre bas les armes, de vouloir faire un argument
de ce que le cadavre du prince à Delft, en 1845, ne portait les trois piqûres
en croissant que sur un bras seulement, comme si cela n’était pas déjà écrasant
pour eux !
Comme si tout le monde ne savait pas que le
vaccin peut ne subsister, surtout après des dizaines d’années, que sur un bras
seulement et que s’il y a eu un vaccin
sur un bras on a mis au début exactement le même sur l’autre !
La vérité c’est que cette inoculation si
prématurée, ayant fait époque, est une preuve certaine de plus, fondamentale,
de l’identification Naundorff-Louis XVII. »[212]
_ Les analyses ADN n’ont-elles pas prouvées que
Naundorff ne fût
pas Louis XVII ?
Non, car même si la méthode semble valide, le
matériau d’origine est plus que douteux. Par ailleurs, le professeur
Cassiman spécifie que « la carte
ADN n’est pas une carte d’identité : ce cœur analysé est celui d’un parent
de Marie-Antoinette » et donc de n’importe quel Habsbourg.[213]
A propos des résultats ADN, nous pouvons remarquer, comme l’écrit Alain Kérizo, dans Sous la Bannière :
« Que vient faire cette annonce médiatique aussi soudaine qu’inattendue, dans un monde qui se préoccupe aussi peu de la survivance de Louis XVII que de toute idée de restauration monarchique ?
Pour faire tant de tapage dans le seul but de « prouver » que Louis XVII n’a pas eu de descendance, les médias ont évidemment reçu des ordres !
Et à ces ordres il y a des raisons. La Révolution aura mis le paquet des médias pour convaincre les foules que Louis XVII est mort au Temple. Il y a donc gros à parier que c’est une imposture de plus ! »
_ D’après André Castelot et Laure de la Chapelle, Naundorff a connu le véritable Louis XVII, leurs routes se sont croisées, et à la mort du second, Naundorff s’est fait passé pour lui, fort des détails qu’il lui avait soutirés.
Il faudrait pour cela, de la part de Naundorff, une mémoire extraordinaire enregistrant les plus petits détails de la vie du dauphin. Egalement, il aurait été nécessaire de prévoir tous les pièges que lui tendraient les anciens serviteurs de la famille royale, ce qui sous-entend à la fois le don de prophétie pour lui, et pour le véritable Louis XVII une mémoire extraordinaire. Cette hypothèse est donc sans valeur historique, d’autant qu’il reste à expliquer les caractéristiques corporelles particulières, retrouvées sur Naundorff à sa mort.[214]
_ Certains affirment que Louis XVII était le fils de Fersen. La réponse est non.
Que Marie-Antoinette ait eu un attachement très profond pour Alex Fersen, ceci ne saurait être nié, mais que cet attachement ait été suivi d’une liaison adultérine, la preuve n’en sera jamais faite. Les Reines ont des devoirs d’état, une conscience professionnelle qui leur est une armure contre les pires faiblesses.
A part les révolutionnaires et quelques amis de Louis XVIII qui répandent ce bruit (mentant pour arriver à leurs buts), à la Cour personne n'y croyait.
D’ailleurs Jean Chalon a démontré, dates en mains, l’impossibilité de cette fable, et M. et Madame Girault de Coursac ont établi de la façon la plus précise qu’une telle aventure était matériellement impossible pour une Reine de France qui n’était jamais seule.[215]
_ « Une demoiselle Naundorff, au service d’un Bourbon (Prince de Condé) à la fin de l’Ancien Régime, a eu un fils naturel dont on perd la trace. Il est possible que Naundorff soit un faux-dauphin, mais un vrai Bourbon, mêlé à l’évasion du petit roi. »
La réponse est toujours la même ! Comment ce faux Louis XVII aurait-il possédé les marques corporelles et les cicatrices qui permirent d’identifier Naundorff comme étant le petit roi ? Comment aurait-il possédé autant de souvenirs précis sur sa vie à Versailles et aux Tuileries ?[216] Comment aurait-il pu répondre aux pièges que lui tendaient ses interlocuteurs, en leur fournissant à chaque fois une réponse exacte, rectifiant leur propre question ? Et où trouve-t-on trace de cette naissance d’un bâtard Naundorff-Bourbon ? Car pour répondre aux mêmes qualifications d’âge au moment des exhumations de Delft, il eût fallu que ce bâtard soit né en 1875, comme Louis XVII. Et croit-on que les registres de baptême de cette année ne furent pas explorés, tant à Versailles qu’à Paris, par les adversaires du pseudo-Naundorff, afin d’y découvrir enfin la preuve de son imposture ? Or, encore une fois, on ne nous apporte aucune pièce probatrice de cette naissance.[217]
_ La descendance de Louis XVII, très bien ? Mais si le Masque de Fer était un frère jumeau de Louis XIV, comme le pensent certains historiens ?
Cela ne changerait rien.
La bienheureuse Marguerite-Marie écrivait à la Mère de Saumaise :
« Il appelle Louis XIV le fils aîné de son Sacré Coeur. »
Or, en 1689, le Masque de Fer vivait encore. Donc, eut-il été le frère jumeau de Louis XIV, il n’était pas l’aîné.
XIX] Naundorff a-t-il perdu ses droits à la Couronne ?
1) Le
mariage de Naundorff est-il valide ?[218]
Le mariage contracté par Naundorff le 19 novembre 1818 à Spandau est absolument valide au point de vue prussien, au point de vue français, au point de vue catholique et enfin au point de vue dynastique.
1° Au point de vue prussien.
Cet acte du 19 novembre est absolument irrégulier pour les quatre raisons exposées ci-dessous, et pourtant il est valide.
Il est irrégulier parce que :
_ Naundorff s’est marié sans présenter son acte de naissance. On l’a exigé pour sa femme, Jeanne Einert, qui l’a remis au pasteur Fiedler. Par une lettre datée du 18 novembre 1834 et adressée à sa fille aînée Amélie, Naundorff demande à sa fille d’aller chercher copie de l’acte de naissance de sa mère « que son beau-père, lors de notre ban, a remis au premier pasteur Fiedler… ».
Naundorff, lui, n’a rien fourni : le pasteur Hornburg l’a écrit dans une lettre, en date du 9 juin 1836) : « On ne voit point, écrit-il, dans le livre d’église, que le sieur Naundorff, en faisant publier ses bans, ait exhibé son acte de baptême. » Et la « Gazette d’Etat » de Prusse confirme les dires du pasteur. Dans son numéro du 30 mai 1836, elle écrit : « toutes les recherches faites pour découvrir la famille et le lieu de naissance de M. Naundorff n’ont abouti à aucun résultat satisfaisant. On sait seulement… qu’il s’est marié à Spandau, en 1818, sans qu’il eut produit son extrait de naissance. »
Voilà donc une première irrégularité : pas de présentations d’acte de naissance ou d’acte de baptême.
_ Le père indiqué n’a jamais existé. S’il avait existé, nous aurions l’acte de naissance de son soi-disant fils et il n’y aurait pas de question Naundorff.
_ L’acte de mariage n’est signé ni du pasteur, ni des époux. Cet acte écrit sur les registres, l’a été par la main du sacristain de l’église Saint-Nicolas, qui s’appelait Daberkow. C’est le pasteur Hornburg lui-même qui l’écrit dans sa lettre précitée. Or, ce sacristain n’assistait pas au mariage qui a été fait « am Haus » c’est-à-dire « à la maison », et le pasteur Recke, interrogé, écrivait le 12 juillet 1909 que « l’inscription sur les registres a sans doute été faite après le mariage et en dehors de la présence des époux ». Les indications contenues peuvent donc être fantaisistes… car cet acte n’est signé ni par le pasteur ni par les époux. Une photographie donnée par la Légitimité en 1909, l’indique très nettement. Et Naundorff a toujours dit qu’il n’avait pas signé cet acte et la duchesse de Normandie, interrogée par ses intimes, a toujours affirmé la même chose.
_ Différence entre l’original et les copies. Dans l’imprimé, il est prévu deux colonnes, une pour chacun des conjoints, indiquant l’autorisation du tribunal, des parents ou du tuteur. La photographie montre que ces deux colonnes sont vides : il n’y a rien. Et pourtant Jeanne Einert, étant mineure (16 ans) devait avoir l’autorisation de ses parents ? Or, sur les extraits envoyés par les différents pasteurs de la paroisse de Saint-Nicolas, on lit ceci :
Colonne 5 : si les parents ou tuteur ont donné leur consentement.
Réponse : le tribunal de la ville.
Colonne 10 : même demande
Réponse : le tribunal de la ville à Rathenow, comme il appert par le certificat de bonne conduite et de consentement obtenu, donné par M. Ewald, intendant supérieur de cette ville.
Pourquoi ces deux autorisations ne figurent-elles pas devant les colonnes imprimées à cet effet sur l’acte lui-même. Devaient-elles rester secrètes ? Y avait-il entorse à la loi ?
Voilà quelques-unes des irrégularités qui figurent sur l’acte de mariage de Naundorff. Cet acte est donc bien annulable, mais en fait, il n’a jamais été annulé. C’est cet acte qui a constitué la famille du Prince, c’est d’après cet acte que les enfants de Naundorff, nés en Prusse, en Sax, en Angleterre, sont nés enfants légitimes et ont été inscrits comme tels dans leurs actes de naissance. Cet acte a eu sa répercussion dans les actes de décès des deux conjoints, et les enfants nés de ce mariage n’ont eu la succession de leurs père et mère qu’en vertu de cet acte de mariage.
Les deux registres de la paroisse de Saint-Nicolas et du greffe de Spandau conservaient encore ces actes avant la guerre 1939-1945. L’acte de mariage n’était ni bâtonné ni annulé. Il est donc parfaitement valable au point de vue de la loi prussienne.
2° Au point de vue français.
Si, lorsqu’il s’est marié, Naundorff avait été reconnu en France comme Français, il eut été soumis aux formalités édictées par notre Code pour les Français se mariant à l’étranger. Mais il n’était pas reconnu comme tel. Par conséquent, comme la loi française reconnaît comme valables les mariages des « étrangers » contractés dans leurs pays et suivant la loi de leur pays, celui de Naundorff est valable au point de vue français comme au point de vue prussien.
3° Au point de vue catholique.
Le Concile de Trente du XVIe siècle, a établi l’empêchement dirimant de clandestinité. Il a décrété que désormais seraient considérés comme clandestins et nuls les mariages qui ne seraient pas contractés devant le curé de l’un des époux et deux témoins. Mais il a décrété, en même temps, que la nouvelle loi ne serait obligatoire qu’au fur et à mesure de sa promulgation dans chaque paroisse. L’électorat de Brandebourg étant, à cette époque, protestant, cette loi du Concile de Trente s’appliquait donc à Spandau. Or, elle n’y a été promulguée qu’à Pâques 1908, sous Pie X. En 1818 donc, le mariage contracté par Naundorff, s’il est clandestin aux yeux de l’Eglise Catholique, n’en est pas moins valide à ses yeux, et valide canoniquement.
Ajoutons que la religion luthérienne était, en Prusse, celle de l’Etat et l’état civil appartenait au clergé luthérien, jusqu’en 1874. Les pasteurs pouvaient donc retarder à volonté, les mariages s’ils jugeaient les pièces incomplètes : ce qui n’a pas eu lieu pour Naundorff et pourtant, les pièces étaient incomplètes… et, chose fort rare à l’époque, le mariage eut lieu « à la maison » et non au Temple protestant. Toutes ces irrégularités ont donc été transgressées… sur ordre !
Cette question de mariage canoniquement valide, a été discutée par des religieux docteurs en Théologie, et tous ont conclu à cette validité religieuse.
4° Au point de vue dynastique.
Lorsqu’en 987, les évêques et barons, représentants de la France Féodale, décernèrent la couronne à Hugues Capet et à sa lignée légitime, ce mot n’avait qu’un sens : le sens canonique. A l’époque, il n’y avait pas de mariage civil, à la mairie. Etre légitime aux yeux de l’Eglise, c’est l’être aussi du point de vue dynastique, au point de vue salique. Cette loi originelle n’a subi, au cours des siècles, aucune modification. Donc le mariage de Naundorff étant valide au point de vue catholique, l’est aussi au point de vue dynastique.
On fait valoir que Mlle Einert n’étant pas de sang royal, on peut assimiler ce mariage à un mariage morganatique.
On ajoute que, pour que la postérité issue de ce mariage pût conserver ces droits, il aurait fallu que ce mariage fût accepté par le Roi de France, c’est-à-dire Louis XVIII, et que les enfants issus du mariage soient relevés par un acte formel du souverain de l’incapacité encourue, ce qui n’a pas eu lieu.
Or, le mariage morganatique n’a jamais existé en France, et il n’est nullement nécessaire d’appartenir à une famille royale pour devenir Reine de France.
La pratique de « l’autorisation du Roi » ne fut pas constante. Louis XI s’est marié contre le gré de son père. C’est pourtant lui qui, en 1463, évoquera le premier la nécessité de l’autorisation pour disqualifier les Bourbon-Busset. D’après le vicomte de Bonald, la clause du consentement royal n’a été consacrée par une loi positive qu’en 1702. Son évocation ne peut donc être que fort litigieuse.[219]
Marie Leczinska n’était que la fille d’un simple gentilhomme, roi élu et détrôné. Si Louis XIV avait épousé, comme il a bien failli le faire, la nièce de Mazarin, cela aurait-il empêché ses enfants de régner ?
Au surplus, puisque Naundorff était Louis XVII, c’est lui qui était, en 1818, chef de la Maison Royale et il n’avait d’autorisation à demander à personne. Lui seul aurait pu déclarer que son propre mariage empêchait ses futurs enfants d’être Princes du Sang et il ne l’a pas fait.
2) Naundorff a-t-il renoncé solennellement à la
Couronne ?
Certaines personnes admettent que Naundorff était bien Louis XVII, mais elles affirment qu’il a perdu ses droits car il aurait renoncé solennellement à la Couronne pour lui et ses descendants : [220]
Le fait est indéniable. Dans sa lettre au Duc de Berry, de septembre 1818, il déclare « qu’il n’a pas l’intention de troubler le Roi (Louis XVIII) dans la possession de son Trône. » En janvier 1834, il charge son ami Morel de Saint-Didier de dire à la Duchesse d’Angoulême : « qu’il a l’intention de régler les choses de façon que ses enfants n’aient jamais le malheur de monter sur le Trône », et il écrit lui-même : « Je voulais n’apporter aucun changement à l’état politique de l’Europe, et surtout ne pas troubler le repos public. Je laissais donc le Trône à qui le possédait ; je m’engageais à en garantir la survivance par un acte solennel qui serait converti en loi du Royaume, tant au Comte d’ Artois qu’aux Ducs d’ Angoulême et de Berry et aux descendants de ce Prince. »
Réponse :
a) Louis XVII-Naundorff n’avait pas le droit d’agir ainsi, les renonciations n’étant pas admises en droit monarchique.
b) Cette renonciation était d’ailleurs conditionnelle : il demandait en échange que son identité fût reconnue, ce qui n’a pas eu lieu.
c) Même si on admet la renonciation de Naundorff valable pour lui-même, cela prouve une seule chose, c’est qu’il se rendait compte que son éducation, le milieu où il avait été élevé, son mariage avec une jeune fille d’un milieu extrêmement modeste, en un mot, son « déclassement » indéniable, l’empêchait de régner, mais, de toutes façons, il ne pouvait engager sa postérité.
3) Le descendant
actuel des Naundorff est-il
marié légitimement ?
Le descendant actuel de la branche aînée des Naundorff, Charles-Louis Edmond de Bourbon, affirme avec raison :
« Le cas de mariage subséquent n’est pas prévu dans les Lois Fondamentales du Royaume.
Par contre, la position du droit canon catholique est très clair : les enfants issus de tels mariages sont parfaitement légitimes.
Or, les Lois Fondamentales du Royaume sont établies en priorité pour que la succession se fasse sans déviation possible de père en fils, c’est la loi du sang.
Dans mon cas, je suis bien légitimement et par mariages catholiques, le fils de mon père, fils de Charles Edmond, fils de Louis XVII.
C’est pourquoi le vide juridique des lois Fondamentales du Royaume devra simplement s’inspirer du droit canon catholique, juste et de bon sens, car une régularisation tardive de mariage n’a aucun rapport avec une bâtardise. »[221]
En effet, le père de Charles-Louis Edmond de Bourbon, le Prince Charles-Louis-Mathieu a épousé Marie-Flore Babron en avril 1926 à la mairie et le 1er juillet 1932 à Notre-Dame de l’Espérance à Ivry sur Seine. Le Prince Charles-Louis-Edmond étant né le 18 juin 1929, il s'agit d'un mariage subséquent, qui, d'après le droit Canon de l’Eglise Catholique actuelle légitimise absolument cet enfant.
Il en est de même pour le fils unique de Charles-Louis Edmond de Bourbon : Hugues.
Selon les termes du canon 1139 du canon du code de droit canonique promulgué en 1983 (reprenant en partie le canon 116 du code de droit canonique de 1917 ainsi que la Réponse de la Commission d’interprétation du code en date du 6 décembre 1930), l’enfant illégitime est légitimé par le mariage subséquent de ses parents pourvu que ce mariage soit valide ou putatif. Un rescrit du Saint-Siège peut aussi accorder cette légitimité.
Au regard du droit canonique, Hugues, Charles, Guy né le 29 décembre 1974 de Charles, Louis, Edmond de Bourbon et de Renée, Paulette Divoux a été légitimé par le mariage subséquent de ses parents célébré le 10 mars 1987 en l’église St Thibaut de Marly-le-Roi, au diocèse de Versailles.
On sait que selon le droit, l’enfant légitimé a tous les droits qu’à un enfant légitime.
En ce qui concerne la branche cadette des Naundorff, ils ne sont pas dynastes.
Le Prince Adelberth, puis son fils Henri-Charles-Edouard, puis son petit fils Louis-Jean-Henri-Charles et enfin le fils de celui-ci, le prince Charles-Louis, ont tous contracté des mariages protestants, ce qui les écarte de la succession.
Par contre, le prince Charles-Louis a fait un mariage subséquent par un mariage catholique en 1983 à l’Eglise des Invalides.
Mais, comme l’écrit Charles-Louis Edmond de Bourbon : « le mariage protestant étant réputé nul, Adelberth est considéré comme non marié et sa descendance n’a pas d’existence dynastique. La conversion de mon cousin Charles-Louis n’apporterait donc rien. » [222]
4) Une
descendance cachée ?
Monsieur Xavier de Roche affirme que Naundorff, sous le nom de Luis Capeto épousa en 1803 Dona Maria de Vasconcelos[223], et lui aurait donné cinq garçons.
Les descendants issus de ce mariage, comme leur parents avant leur naissance, ont vécu au Portugal continental.[224]
Il affirme de même que « Louis XVII s’est remarié (après un premier veuvage) en 1814 avec une jeune femme qui mourut à son tour un an après : sur ce point, d’importance très secondaire (il n’y a pas eu de descendance mâle de ce mariage), qu’il nous suffise de constater que le fait résulte d’un acte authentique et d’observations officielles portées sur le registre de catholicité par le curé de Saint Benoît du Hron, l’abbé Thébory, en 1815. »[225]
De cette thèse du mariage avec Dona Maria de Vasconcelos, Xavier de Roche élabore cette hypothèse : « Le Comte
de Chambord était parfaitement au
courant de l'existence de Naundorf et du fait qu'il avait eu des fils de son
mariage avec Johanna Fridericke Einert. Nous verrons bientôt que l'action judicaire qu'avait lancée
Naundorf en juin 1836 en restitution d'état-civil avait débouché sur un procès
en 1851 et un pourvoi en appel en 1872. L'existence de cette famille, déjà -
nous l'avons constaté - parfaitement connue auparavant de la famille royale,
était de notoriété publique. Pourquoi dès lors Chambord ne désigne pas tout
simplement l'aîné des fils survivants du ménage Naundorff-Einert comme le Roi de droit ? Nous voyons dans cette position
adoptée par Chambord l'avertissement qu'il existe très vraisemblablement une
branche aînée issue d'un précédent mariage de Louis XVII, branche dont il avait sans doute connaissance mais sans
pouvoir ou sans vouloir en révéler le détail. »
Thèse originale mais sans preuves sérieuses : aucun
document ne permet de dire que Naundorff aurait pu être Luis Capeto. On ne
retrouve aucune trace du soi-disant mariage de ce dernier avec une demoiselle
Dona Maria Vasconcelos, pas plus que des actes de naissance de ses enfants.
En l’absence de preuves, la seule descendance légitime de Naundorff reste celle de son mariage avec Jeanne Frédérique Einert.
Cependant, si la thèse de Xavier de Roche sur une descendance avec Dona Maria de Vasconcelos est fausse, devons nous pour autant exclure la possibilité d’une autre descendance cachée de Naundorff ?
Se peut-il que Naundorff ait eu une descendance cachée, que nous ne connaissons pas ?
Seul l’avenir nous le dira…
Dans tous les cas nous devons soutenir l’actuel chef de la branche aînée des Naundorff, et, quand le jour viendra, si une descendance inconnue existe, Dieu se manifestera…
Conclusion
Nous croyons que seul le naundorffisme providentialisme est la voie du bon sens et de la vérité.
Le Grand Monarque sera issu de la descendance connue ou cachée de Louis XVII-Naundorff.[226]
Nous appelons tous les naundorffistes, les providentialistes, les catholiques, les royalistes de tous bords, les contre-révolutionnaires, les nationalistes et tous les hommes de bonne volonté à se rassembler autour des descendants actuels de Louis XVII-Naundorff, et notamment de Mgr Charles-Louis-Edmond de Bourbon, chef de la branche aînée connue.[227]
Si nous fondons uniquement en Dieu notre espoir pour le triomphe de la cause que nous défendons, loin de nous cependant l’envie de nous croiser les bras dans l’attente du succès final. Aide-toi, et le Ciel t’aidera, dit un vieux proverbe. Voilà pourquoi nous croyons utile de combattre toujours le mensonge, afin de hâter autant qu’il est en notre pouvoir l’heure où la vérité sera enfin victorieuse, envers et contre tous.